« Différence des effets de l’éducation chez les anciens et parmi nous.
La plupart des peuples anciens vivoient dans des gouvernemens qui ont la vertu pour principe ; et lorsqu’elle y étoit dans sa force, on y faisoit des choses que nous ne voyons plus aujourd’hui, et qui étonnent nos petites ames.
Leur éducation avoit un autre avantage sur la nôtre ; elle n’étoit jamais démentie. Epaminondas, la derniere année de sa vie, disoit, écoutoit, voyoit, faisoit les mêmes choses que dans l’âge où il avoit commencé d’être instruit.
- Aujourd’hui, nous recevons trois éducations différentes, ou contraires ; celle de nos peres, celle de nos maîtres, celle du monde.
- Ce qu’on nous dit dans la derniere, renverse toutes les idées des premieres.
Cela vient en quelque partie du contraste qu’il y a parmi nous entre les engagements de la religion et ceux du monde ; choses que les anciens de connoissoient pas. »
– Montesquieu, Esprit des Lois, 1777
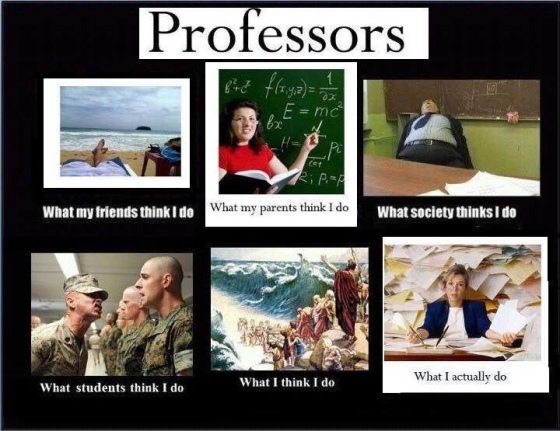
« On observe aujourd’hui trois formes de violence croissante, qui requièrent le réengagement des institutions éducatives pour réaliser un objectif éducatif poursuivi de longue date :
- doter les individus des compétences nécessaires à la paix.
Ces formes de violence sont :
1) la violence de groupes extrémistes à l’encontre d’individus ou de l’État, notamment les groupes motivés par des revendications religieuses ou culturelles ;
2) la violence exercée par l’État à l’égard de groupes ou d’autres États sur des fondements culturels, ethniques ou tribaux ;
3) la violence entre différents groupes culturels, dans les sociétés qui connaissent des flux migratoires, et où les populations sont plus hétérogènes sur ce plan.
À l’origine de ces trois formes de violence, on pourrait mentionner la notion de supériorité d’un groupe sur un autre, le manque de connaissances, de compréhension et de tolérance vis-à-vis de groupes différents, ainsi que l’insuffisance de compétences interculturelles qui rend la communication inefficace et ne permet pas aux groupes en conflit de dépasser leurs divergences.
Bien que probablement insuffisantes pour éliminer les causes de la violence, l’éducation planétaire et la préparation des étudiants au cosmopolitisme peuvent contribuer à atténuer ces formes de violence.
Dès le début de l’histoire de l’humanité,
- les hommes ont démontré leur capacité et leur propension à exercer différentes formes de violence les uns à l’égard des autres.
Je définirais la violence comme une décision ou une action délibérée d’un ou de plusieurs individus pour faire du mal à d’autres, en leur infligeant des blessures ou des douleurs psychologiques ou physiques, ou en les privant des conditions nécessaires à la jouissance d’une vie digne d’un être humain.
- Ces formes de violence peuvent se produire à un niveau interpersonnel, aussi bien qu’à l’intérieur d’un groupe ou entre groupes.
Il s’agit, par exemple, de la violence infligée par certains individus aux membres d’organisations auxquelles ils appartiennent, telles que la famille, les communautés, les associations religieuses ou le milieu de travail, ainsi que la violence exercée par certains membres d’un groupe particulier à l’égard de ceux qui n’en font pas partie. Dans ses formes les plus extrêmes, la violence dont les hommes sont capables peut entraîner la mort d’autrui. Elle peut aussi causer des dommages physiques ou psychologiques à long terme, qui handicapent gravement la qualité de vie de ceux qui y ont survécu.
Les traces retrouvées de la pratique d’un cannibalisme généralisé, il y a 7000 ans, au sud de l’Allemagne d’aujourd’hui, ont conduit les anthropologues à supposer qu’une « crise sociale et politique en Europe centrale a déclenché à l’époque différentes formes de violence », entre autres, le cannibalisme pratiqué sur des esclaves et des prisonniers de guerre.
Les crânes fracassés, rendant toute identité méconnaissable, découverts à Herxheim, « donnent à penser que l’on cherchait à détruire l’identité individuelle, qu’une forme de violence psychique était exercée à l’encontre d’autrui » (Bower, 2009).
- L’histoire des guerres s’inscrit dans la propension de longue date des êtres humains à manifester de la violence.
Il en est de même pour différents modes d’avilissement et d’exploitation de certains groupes par d’autres, comme l’esclavage ou les nombreuses formes institutionnalisées de discrimination et d’oppression :
- le sexisme,
- le racisme,
- la discrimination religieuse et ethnique,
- l’assujettissement.
La violence émanant de conflits ethniques est omniprésente dans le monde, et la plupart d’entre eux perdurent encore aujourd’hui. En 2006, on dénombrait 28 conflits armés dans le monde, et 10 autres menaçaient de se ranimer (Marshall, 2008). Selon le Center for Systemic Peace, 3 565 000 personnes auraient perdu la vie dans les 98 conflits qui ont éclaté depuis 1998 (Marshall, 2008).
- Moins d’un tiers des conflits ont été d’une durée inférieure à un an ; pratiquement la moitié ont duré trois ans ou plus ; un conflit sur quatre a duré cinq ans ou plus ; et 11 conflits ont duré plus de dix ans.
Ces chiffres ne font pas apparaître les cas de violence ethnique lorsque les troubles ne conduisent pas à un conflit manifeste généralisé. Par exemple, dans plusieurs villes d’Égypte, des tensions entre les chrétiens coptes et les musulmans mènent parfois à des épisodes de violence, comme en janvier 2010, quand des milliers de chrétiens égyptiens se sont soulevés, suite à l’assassinat de six coptes à la sortie de la messe de minuit, à Nag Hamadi.
La mondialisation a entraîné un accroissement des flux migratoires et a modifié la composition démographique de nombreuses sociétés. On estime que près de 200 millions de personnes – soit 3 % de la population mondiale – vivent hors de leurs pays d’origine, tandis que désormais, un nombre croissant de nations d’Amérique, d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Océanie génèrent et accueillent des migrants internationaux (United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, 2006).
L’augmentation des flux migratoires a multiplié les contacts entre membres de groupes culturellement différents. Selon certains auteurs, ce phénomène entraînera des conflits entre civilisations (Huntington, 1993).
Un conflit peut être engendré par l’attitude négative de certains membres de groupes culturels à l’égard de groupes différents. Selon la théorie des relations intergroupes (Allport, 1954), les attitudes négatives sont souvent dues à l’absence de relations entre des groupes différents, alors que de telles relations permettraient justement d’atténuer les préjugés négatifs.
- Cependant, tous les types de relations ne sont pas propres à réduire les comportements négatifs.
- Le statut des membres des différents groupes, et la nature des activités générant les relations, auront une incidence sur l’orientation de comportements plus ou moins positifs.
- D’après la théorie de l’identité sociale, c’est en considérant la supériorité de leur groupe sur d’autres groupes ethniques que les individus acquièrent une identité positive au sein du leur.
- Cette notion de supériorité peut conduire à des conflits ethniques, lorsque divers groupes sont en concurrence face à des ressources peu abondantes (Coenders, Lubbers & Scheepers, 2009).
Certains événements récents illustrent les tensions provoquées par les contacts entre des groupes culturellement différents. En 2004, en France, le ministère de l’Éducation a interdit le port du voile à l’école, une politique perçue par bon nombre comme une forme de violence à l’égard des étudiantes musulmanes. En 2009, la Suisse a voté par référendum l’interdiction de construire des minarets. La même année, le ministre français de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Identité nationale a organisé une série de débats dans le but de définir l’identité nationale. En 2009, l’auteur danois des caricatures du prophète Mahomet publiées en 2005, a été victime, à 74 ans, d’une tentative d’assassinat, faisant suite à toute une série d’agressions commises par des adeptes considérant ses dessins comme une offense aux musulmans.
La première décennie du XXIe siècle a été marquée par une montée en puissance du terrorisme religieux, comme en témoignent les attentats perpétrés par des membres d’Al-Qaida. Des études psychologiques des terroristes montrent que ces derniers sont persuadés de la supériorité de leurs groupes religieux ou ethniques sur d’autres groupes, et qu’ils estiment faire l’objet de menaces auxquelles ils ne peuvent répondre que par la violence (Post, 2007).
Selon certains experts reconnus, le recours à la violence – malgré la prévalence de celle-ci – est un choix, et c’est par une action individuelle et collective que l’on pourrait atténuer son incidence.
La plupart des principes religieux prônent la résolution pacifique des divergences plutôt que leur règlement par la violence.
- Les degrés de violence différents selon les cultures donnent en outre à penser que la violence est une construction culturelle.
D’après des études anthropologiques, au moins 47 sociétés seraient organisées de manière plus favorable à la paix que d’autres. Les pratiques culturelles de certaines communautés autochtones permettent de régler pacifiquement les différends, et se transmettent d’une génération à l’autre (Banta, 1993).
Parallèlement aux institutions religieuses, les institutions éducatives ont traditionnellement cherché à doter les individus des capacités qui les mettraient en position d’éviter la violence et leur permettraient d’adapter leurs différences à celles des autres. Au début du XVIIe siècle, l’évêque protestant morave et éducateur Jan Amos Comenius – qui avait fait l’objet de persécution religieuse et survécu à 30 ans de guerre civile – a avancé, dans son ouvrage Didactica Magna, que l’éducation universelle donnerait aux individus les moyens nécessaires pour venir pacifiquement à bout de leurs divergences, qu’il attribuait à la méconnaissance mutuelle de la culture de groupes différents. Ainsi, depuis son origine, l’aspiration à l’éducation de tous avait pour objectif moral la contribution à la paix. Dans sa proposition, Comenius reconnaissait également que les différences culturelles et religieuses pouvaient être source de conflits.
L’autre événement important de l’histoire de l’éducation universelle fait fond sur le même objectif de paix.
- L’intégration du droit à l’éducation dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, élaborée après la Seconde Guerre mondiale, a été à l’origine de l’évolution la plus importante de l’accès à l’éducation dans le monde en développement, grâce à l’action concertée des organisations des Nations Unies et des gouvernements.
L’objectif moral de cette évolution du droit à l’éducation est clairement exprimé dans la Constitution de l’UNESCO qui indique que, les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix (UNESCO, 1945).
- L’histoire de l’éducation regorge d’exemples de dirigeants politiques qui ont tenté d’harmoniser les pratiques scolaires avec le développement de capacités pour la paix.
- Ces efforts ont été impulsés, en partie, par des individus désireux de créer un mouvement pour la paix dans le but de contrer les guerres.
Ce mouvement pour la paix a pris naissance grâce aux responsables intellectuels et politiques en Belgique, en France et en Grande-Bretagne, qui se sont mobilisés pour s’opposer au pouvoir militaire mis en place après les guerres napoléoniennes.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, des organisations pour la paix ont été formées dans de nombreux pays d’Europe et aux États-Unis, rejointes par des associations créées par des enseignants, des professeurs et des étudiants, dans un élan général de mobilisation contre les risques de guerre.
Ces efforts pour éviter la guerre ont perduré jusqu’au début du XXe siècle.
Les œuvres de Bertha von Suttner, qui a dirigé l’Union internationale des sociétés pour la paix, dénoncent la guerre. Elle a également incité Alfred Nobel à créer un prix de la paix (Hamann, 1996).
- La relation entre le mouvement pacifiste et l’éducation est parfaitement illustrée par les différents établissements de la School Peace League, mis en place dans la plupart des États des États-Unis, au début du XXe siècle, pour défendre la justice internationale et la fraternité (Scanlon, 1959).
- La School Peace League proposait d’éduquer les enseignants aux conditions nécessaires à la paix.
Au cours de la même période, Jane Addams, une dirigeante de premier plan du mouvement pacifiste, a avancé que la paix et le refus du conflit nécessitaient l’éducation des immigrants aux États-Unis et des enfants défavorisés pour les sortir de la pauvreté ;
- elle considérait en effet que la pauvreté était l’un des facteurs conduisant à la guerre.
Elle a également lutté en faveur de l’éducation des femmes, dans le but de leur donner les moyens de s’affranchir des rôles conventionnels qu’on leur attribuait dans la société.
Elle s’est aussi engagée pour la création de la Ligue des Nations, tribune grâce à laquelle les pays allaient pouvoir régler pacifiquement les conflits.
Jane Addams s’est vue décerner le prix Nobel de la paix en 1931.
En 1928, à l’occasion d’une conférence pour l’association des directeurs d’écoles du secondaire,
Isaac Kandel, l’un des fondateurs de l’éducation comparée aux États-Unis, professeur au Teachers College, a plaidé pour que l’éducation planétaire figure parmi les objectifs du programme du secondaire, en expliquant qu’une meilleure compréhension des autres pays et régions pourrait réduire la probabilité de les entraîner dans un conflit armé.
- Kandel expose longuement que l’éducation planétaire n’est pas contraire au nationalisme et ne constitue pas un appel au socialisme (Kandel, 1930).
Peu après la Seconde Guerre mondiale, Maria Montessori a proposé de nouvelles formes d’éducation, offrant la possibilité aux élèves de choisir et d’expérimenter des méthodes pédagogiques démocratiques et respectueuses de l’être humain, propres à développer leur sens critique à l’égard de dirigeants autoritaires entraînant leurs pays dans la guerre.
- Après la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de programmes éducatifs pour la paix ont été élaborés par des individus soucieux de prévenir de nouvelles formes de violence, comme cela avait été le cas pendant la guerre.
La création de l’UNESCO a permis de développer de nombreux programmes d’enseignement aux droits de l’homme et à la paix à travers le monde.
En 1948, l’UNESCO a publié le manuel Techniques d’éducation pour la paix : existent-elles ? rédigé par Maurette (1948).
Dans cet ouvrage, Maurette dessine les contours d’un programme international qui dispenserait aux étudiants les connaissances nécessaires à l’appréciation de la diversité culturelle et des affaires internationales.
C’est sur cette base qu’a été créé le International Baccalaureat Diploma Programme. C’est aussi en 1948 qu’un programme d’études de la paix a été mis en place à l’Université de Manchester, dans l’Indiana aux États-Unis.
Dans les années 1960, un groupe d’enseignants à Genève a créé l’International Schools Examination Syndicate, qui est devenu par la suite l’Organisation du baccalauréat international (IBO). Etabli en 1968 à Genève pour promouvoir l’adoption du programme du baccalauréat international, l’IBO offre actuellement trois programmes scolaires pour les enfants âgés de 3 à 19 ans.
En 1962, Kurth Hahn, éducateur allemand, a fondé le United World College of the Atlantic, à Vale of Glamorgan dans le sud du pays de Galles. L’objectif de cet établissement était de regrouper des étudiants issus de différents pays, autour d’expériences curriculaires partagées, incluant des discussions sur des questions mondiales. À l’initiative de Lord Mountbatten, et ensuite du Prince Charles, des Atlantic Colleges ont été créés à Singapour (1971), dans le Pacifique et au Canada (1974), au Swaziland (1981), en Italie (1982), aux États-Unis (1982), au Venezuela (1988), à Hong Kong (1992), en Norvège (1995), en Inde (1997), au Costa Rica (2006), en Bosnie-Herzégovine (2006) et aux Pays-Bas (2009).
En dépit de ces efforts réalisés au cours de l’histoire pour dispenser une éducation à la connaissance planétaire et à la paix, la plupart des écoles dans le monde n’offrent pas aux étudiants de possibilités suffisantes pour devenir des citoyens cosmopolites.
Comme je l’ai indiqué par ailleurs (Reimers, 2009),
le paradoxe de l’éducation, en ce début de XXIe siècle, tient au contraste entre les capacités exceptionnelles des institutions scolaires et leur faiblesse pour préparer les étudiants à un avenir leur permettant de s’adapter aux défis et opportunités mondiaux collectifs.
- Il s’agit d’œuvrer ensemble pour
- améliorer les conditions de vie des pauvres et des plus démunis dans le monde,
- parvenir à des modes durables d’interaction entre l’homme et l’environnement, trouver des formes de commerce international équitables et durables,
- faire face aux épidémies sanitaires,
- créer les conditions favorables à une paix et une sécurité stables.
Pourtant, rares sont les écoles, aujourd’hui, à même de doter les étudiants des compétences et de la réflexion nécessaires pour collaborer, par-delà les frontières nationales, à l’élaboration de solutions durables à de tels défis.
- Sans nul doute, ces questions sont complexes,
- et les résoudre pourrait impliquer une multitude d’options,
- certaines prêtant probablement à la controverse.
Préparer les étudiants à gérer une telle complexité et les polémiques afférentes est précisément l’objectif de l’éducation planétaire : objectif aujourd’hui absent de la plupart des écoles dans le monde.
1 – Définir et mettre au point les compétences mondiales
Je définirais les compétences mondiales comme les connaissances et les compétences rendant les individus aptes à appréhender le monde ordinaire dans lequel ils vivent, aborder toutes les disciplines de manière à comprendre les affaires et les événements internationaux et pouvoir y faire face.
Les compétences mondiales sont aussi les dispositions comportementales et éthiques nécessaires à l’interaction pacifique, respectueuse et productive entre des êtres humains issus d’horizons divers.
Cette définition des compétences mondiales s’articule autour de trois dimensions interdépendantes :
- Une disposition positive à l’égard de la différence culturelle et un cadre de valeurs internationales pour affronter la différence. Cela suppose le sens de sa propre identité et l’estime de soi, mais également l’empathie pour ceux qui ont une identité différente. Cela requiert aussi l’intérêt et la compréhension des divers courants de civilisation, ainsi que l’aptitude à considérer les différences comme une possibilité d’échanges constructifs, respectueux et pacifiques entre les individus. Cette dimension éthique des compétences mondiales implique également l’engagement en faveur de l’égalité et des droits fondamentaux de tous les individus, et une disposition à agir pour faire valoir ces droits (Gutmann, 1999 ; Reimers, 2006).
- L’aptitude à s’exprimer, à comprendre et à réfléchir dans d’autres langues que la langue dominante du pays de naissance des individus.
- Des connaissances et une compréhension approfondies de l’histoire mondiale et de la géographie ; des dimensions internationales de domaines tels que la santé, le climat, l’économie ; du processus de la mondialisation lui-même (dimensions disciplinaire et interdisciplinaire) ; ainsi que la capacité à réfléchir, de façon critique et créative, à la complexité des défis mondiaux d’aujourd’hui.
2 – Comment acquérir des compétences mondiales ?
- La nature multidimensionnelle des compétences mondiales implique de passer par un processus à volets multiples pour les acquérir.
Certaines disciplines peuvent contribuer à les développer :
- histoire internationale,
- géographie et
- langues étrangères.
Mais c’est aussi par la lecture que l’on acquiert des compétences mondiales – par exemple, en lisant des textes qui illustrent la diversité culturelle – ainsi que par l’apprentissage des sciences, en menant à bien des projets qui contribuent à mettre en lumière la nature transnationale du domaine scientifique.
- Néanmoins, l’acquisition de compétences mondiales repose fondamentalement sur
- la motivation et l’intérêt suscités chez l’étudiant pour les affaires internationales.
En effet, de bonnes connaissances factuelles, et des dispositions positives vis-à-vis de l’étude ininterrompue des affaires internationales, seront plus profitables aux étudiants que l’apprentissage fastidieux d’une série d’événements, ou de programmes scolaires qui caricaturent l’histoire mondiale ou les sciences humaines.
- Si l’appropriation de chacune des trois dimensions des compétences mondiales peut faciliter le développement d’autres compétences (par exemple, la lecture de textes écrits dans une langue étrangère permet d’approfondir la connaissance de différentes cultures et sociétés, renforçant ainsi l’ouverture aux affaires internationales),
- ces dimensions touchent à des domaines distincts et, aux fins de l’élaboration de politiques et de programmes, peuvent être traitées séparément.
La première dimension concerne les comportements, les valeurs et les compétences témoignant de l’ouverture, de l’intérêt et des dispositions positives à l’égard des multiples expressions culturelles humaines observées dans le monde, ainsi qu’un cadre global de valeurs. Il s’agit essentiellement de la tolérance vis-à-vis des différences culturelles.
Ce sont ensuite les compétences permettant
- de reconnaître et de négocier les divergences dans des contextes culturels hétérogènes ;
- la souplesse et l’adaptabilité culturelles nécessaires à l’empathie, à la confiance ainsi qu’à l’efficacité des relations interpersonnelles dans des contextes culturels divers ;
- c’est aussi l’engagement à appliquer la « règle d’or » sur la façon de traiter ceux qui proviennent de civilisations ou de cultures différentes.
On peut développer ces valeurs et comportements de nombreuses façons :
- lire des livres présentant des points de vue et des valeurs cosmopolites,
- interagir avec des groupes d’étudiants culturellement différents,
- participer à des projets d’échanges scolaires internationaux,
- accéder à des disciplines comparées telles que la littérature, l’histoire ou la géographie,
- étudier des créations artistiques de différentes cultures,
- discuter à propos de films sur les droits de l’homme,
- participer à des groupes internationaux tels que le scoutisme mondial,
- à des mouvements mondiaux de jeunesse, ou à des compétitions sportives internationales.
On peut éveiller la sensibilité culturelle à tous les niveaux de l’échelle éducative et ce, dès la petite enfance, c’est-à-dire lorsque les enfants développent leurs valeurs fondamentales.
Cela peut se faire à travers diverses formes et modes d’apprentissage :
- débats, étude, simulation, apprentissage dans le cadre de projets, et éducation par l’expérience.
On peut intégrer efficacement les moyens de développer ces compétences dans les matières proposées dans le curriculum. Et cela ne requiert pas nécessairement d’y consacrer des heures en particulier, car on peut facilement inclure ces aspects dans les cadres curriculaires existants dans de nombreux pays.
Les ressources nécessaires à l’acquisition de cette première série de compétences mondiales sont le matériel pédagogique sous différentes formes médiatiques, le perfectionnement professionnel des enseignants et des administrateurs, ainsi que l’incitation à s’engager de façon responsable (normes et tests) pour consacrer des heures de cours à ces questions.
- L’apprentissage par l’expérience peut s’avérer très efficace pour acquérir les compétences en la matière, en donnant l’occasion aux étudiants d’interagir avec des étudiants d’autres cultures,
- par l’intermédiaire d’établissements scolaires culturellement différents, des études à l’étranger ou la collaboration technologique entre des écoles ayant différents types d’étudiants.
Par exemple, le réseau iEARN (Réseau international d’éducation et de ressources) regroupe des écoles depuis la maternelle jusqu’à la fi n du secondaire et soutient des projets collaboratifs entre les écoles. Grâce à ce réseau, les enseignants sont en contact avec leur pairs dans d’autres régions du monde et collaborent sous forme de projets structurés communs ou en concevant leurs propres projets.
Ceux-ci sont variés et portent, par exemple,
- sur l’étude de l’holocauste et des génocides ;
- sur l’échange de contes populaires ;
- sur l’appui à la publication, par des jeunes en zone urbaine, d’un magazine témoignant des différences et des similitudes des populations à travers le monde ;
- sur l’environnement
- ou encore sur les premières nations du monde.
La seconde dimension des compétences mondiales est la connaissance des langues étrangères. Elle permet de s’exprimer sous des formes variées avec d’autres personnes ou groupes, dans une autre langue.
Les ressources visant à l’acquisition de ces compétences sont les enseignants formés en langues étrangères, le matériel pédagogique adéquat, ainsi que les heures de cours consacrées à l’apprentissage de ces langues.
Les études à l’étranger peuvent contribuer à intégrer des compétences dans ce domaine.
L’apprentissage des langues étrangères peut également être consolidé par les programmes périscolaires et les programmes d’été, auxquels participent éventuellement des personnes parlant la langue des communautés où sont implantées les écoles.
- La technologie est une ressource jouant un rôle de plus en plus important dans cet apprentissage.
La troisième dimension couvre les connaissances dans des disciplines comparées :
- histoire,
- anthropologie,
- sciences politiques,
- économie et commerce,
- littérature,
- histoire mondiale.
Elle concerne aussi l’aptitude à réfléchir dans toutes les disciplines et à rechercher des solutions au processus de mondialisation, telles que la nature des traités pour le commerce international ; l’équilibre entre le respect des droits de l’homme et le commerce international, lorsqu’il s’exerce dans des pays qui les violent ; l’équilibre à trouver entre la participation aux institutions internationales et la réalisation d’objectifs nationaux en matière de politique étrangère, dans des délais raisonnables.
- Il est également possible d’acquérir ces compétences à tous les niveaux scolaires,
- mais il serait néanmoins préférable d’aborder ces questions dès le collège,
- et d’approfondir les connaissances au lycée et dans l’éducation supérieure.
Des compétences de ce type pourraient être, entre autres, les connaissances en histoire et géographie du monde, histoire culturelle, littérature comparée, commerce international et évolution économique.
- Certaines questions internationales nécessitent également d’aborder différents champs disciplinaires.
Les personnes instruites du XXIe siècle doivent connaître les sujets importants et, par conséquent, avoir le niveau d’éducation suffisant pour les comprendre.
Il s’agit, par exemple, de l’amélioration des conditions de santé à travers le monde, ou de la baisse des taux de natalité dans les pays développés et de leur élévation dans les pays en développement qui modifient l’équilibre démographique mondial. En conséquence, la population est vieillissante et diminue dans les premiers, alors qu’elle est en augmentation dans les seconds. Ces tendances démographiques ont des répercussions sur les schémas mondiaux du commerce et de la consommation, l’utilisation énergétique et les ressources, l’environnement et les relations internationales. Comprendre les origines de ces tendances démographiques, et les alternatives possibles pour y faire face, requiert de connaître les normes culturelles de différentes sociétés, les disparités dans la répartition des ressources, l’économie du développement, ainsi que d’avoir des connaissances en politique comparée.
Les ressources visant à l’acquisition de ce type de compétences sont les suivantes :
- des manuels scolaires adaptés,
- un matériel pédagogique complémentaire – ouvrages de références et vidéos,
- dossiers et rapports sur les événements actuels, qui peuvent être très fluctuants et nécessitent l’actualisation des connaissances – des documents d’appui pour les enseignants, le perfectionnement professionnel des enseignants, ainsi que des plages horaires dans le curriculum et le travail personnel qui seront consacrées à ces sujets.
Ces compétences peuvent être acquises par le biais d’un contenu innovant ou de nouvelles activités, à la fois dans les cadres curriculaires existants et les cours qui seront mis en place.
- Il sera en revanche beaucoup plus difficile, dans la plupart des cas, de négocier l’introduction de nouveaux objectifs scolaires ou la mise au point de nouveaux cours.
Ces compétences peuvent s’inscrire dans le cadre des programmes scolaires formels, mais aussi de projets périscolaires, de projets avec les pairs, ou de programmes d’été.
Ces compétences peuvent s’acquérir en partie également en étudiant à l’étranger et par le biais de programmes d’échanges et de projets communs de recherche, lorsque les étudiants de différents pays travaillent ensemble, à l’aide d’outils technologiques. Le projet Global Classroom de l’Association des Nations Unies aux États-Unis offre la possibilité aux élèves des écoles de centres urbains d’aborder les multiples aspects de la négociation transnationale, et de développer les capacités à s’y engager de manière éclairée, sous l’angle de différents pays ou groupes qui y sont impliqués.
C’est par des expériences authentiques que les élèves apprendront à connaître le monde.
Les moyens de les y inciter et de les motiver en ce sens varient évidemment selon le niveau scolaire.
- L’intérêt des élèves, en deuxième année du primaire, peut être suscité par des histoires bien écrites sur des enfants vivant dans différentes parties du globe, par des films de bonne qualité qui compléteront ce type d’enseignement, ou encore, par des visites et des échanges avec des élèves du secondaire ou du supérieur résidant dans d’autres parties de la planète.
Il est probable que les collégiens soient davantage stimulés par
- des projets de recherche qui les conduiront à explorer les questions qui les intéressent sous un angle comparatif, ou par des échanges électroniques avec des camarades de classe associés à des projets communs, dans des écoles semblables d’autres régions du monde.
Les étudiants du secondaire seront davantage stimulés par des sujets liés à l’histoire et la géographie mondiales, leur permettant d’acquérir des connaissances pour interpréter les événements internationaux du moment ; les conversations par vidéoconférence avec des lycéens d’autres établissements éloignés ; les voyages d’études, les échanges entre étudiants, les possibilités d’études à l’étranger, et les séminaires sur des questions ou des secteurs touchant les affaires internationales.
- Les bibliothèques contenant un grand nombre de collections et de supports audiovisuels,
- ainsi qu’une sélection judicieuse de ressources sur internet, seront indispensables
- si l’on veut amener l’étudiant à être autonome et à assumer la responsabilité de son propre apprentissage dans ce domaine.
L’association de ces trois types de compétences et leur niveau d’acquisition varieront selon les professions et les degrés, de la maternelle au supérieur.
- En partenariat avec d’autres institutions telles que
- les universités,
- les musées,
- les bibliothèques publiques,
- les maisons d’édition et les médias,
- les écoles transmettront des connaissances sur d’autres pays et cultures, et sur les processus d’interdépendance qui lient les pays entre eux aujourd’hui.
- Les écoles peuvent, tout au long de la vie, stimuler cet engagement, par la formation aux affaires internationales,
- aux dispositions propres à valoriser les différences culturelles,
- et à l’aptitude à les comprendre pour élaborer un cadre de valeurs internationales.
Ces valeurs sont la compassion, la bienveillance, le souci des autres, le respect et la réciprocité ; l’engagement au respect des droits de l’homme universels et des pactes internationaux (notamment l’élargissement des libertés et des capacités humaines, et la reconnaissance de l’égalité fondamentale de tous les peuples) ; et l’engagement à protéger l’environnement et à relever conjointement les défis mondiaux.
La connaissance, l’engagement et les valeurs sont les domaines cognitifs et comportementaux que l’éducation planétaire devrait cibler.
3 – Éducation des citoyens du monde et éducation aux droits de l’homme
Les valeurs internationales (première dimension éthique des compétences mondiales) peuvent s’acquérir en se fondant sur les connaissances essentielles en matière de droits de l’homme, en transmettant aux étudiants non seulement des connaissances sur ces droits et sur leur histoire, mais aussi en leur apprenant à les valoriser, à percevoir la façon dont ils sont respectés dans les diverses communautés d’origine des étudiants, et à agir pour faire progresser l’exercice de ces droits.
- Apprendre à comprendre l’importance des droits de l’homme et agir sur cette base
- est la pierre angulaire de la civilité et de la paix internationales.
Et, comme le stipule la première phrase de la Déclaration universelle des droits de l’homme, « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».
- L’éducation aux droits de l’homme offre un cadre à la lumière duquel peuvent être examinées les différentes formes d’intolérance conduisant à leur violation ;
- cela permet aussi d’en reconnaître et d’en combattre les formes les plus extrêmes, à savoir
- le sexisme,
- le racisme,
- l’ethnocentrisme,
- l’islamophobie,
- l’antisémitisme,
- le nationalisme agressif,
- le fascisme,
- la xénophobie,
- l’impérialisme,
- l’exploitation,
- le fanatisme religieux et
- la répression politique (Reardon, 1997).
Mais, au-delà de l’instruction en tant que telle, c’est le contexte éducatif qui primera pour l’éducation des citoyens du monde.
Le contexte comprend les possibilités offertes aux étudiants de connaître et de collaborer avec des étudiants dont la culture, la race, l’environnement socio-économique sont différents ; l’ambiance scolaire dans les relations du personnel éducatif avec les étudiants, ainsi qu’avec les parents et autres membres de la communauté ; et les normes sociales qui régissent les relations entre ces différents groupes.
C’est le contexte communautaire, culturel et social au sens large qui permettra aux étudiants d’acquérir des compétences à la citoyenneté, car c’est ce contexte qui influence leur interprétation de leur expérience scolaire et leurs choix des rôles à jouer en dehors de l’école.
- Les élèves doivent exercer leurs droits humains et leurs écoles sont censées fournir des expériences authentiques de pratique de la tolérance.
- C’est à l’école que les étudiants apprendront à respecter la dignité humaine, l’égalité des droits, et à apprécier les différences et la tolérance.
- Outre des connaissances sur les droits de l’homme,
- les étudiants doivent également acquérir des compétences intrapersonnelles et interpersonnelles pour être en mesure de régler pacifiquement les conflits, et faire face à la violence (Reimers & Villegas-Reimers, 2006).
Il est nécessaire d’élargir l’instruction sur les droits de l’homme et de dispenser une éducation au respect et à la tolérance.
Il importe de doter les étudiants des connaissances et des capacités qui leur permettront d’agir de façon moralement réfléchie, et de les encourager à le faire et à assumer la responsabilité de leurs actes dans le monde réel.
Il importe aussi de leur donner les moyens d’acquérir des compétences et de les mettre en pratique dans la vie réelle, en d’autres termes, d’établir un lien entre connaissances abstraites et action.
Les projets de formation en matière de services internationaux sont des exemples d’activités permettant de jeter un pont entre l’acquisition des connaissances et la propension à assumer ses propres responsabilités face aux besoins des communautés.
4 – Défis et opportunités de l’éducation planétaire
Puisque l’éducation aux compétences mondiales est souhaitable, et puisque nous avons les moyens de la transmettre, en partie, dans les écoles, pourquoi ne pas la dispenser à grande échelle, partout dans le monde ?
De fait, le problème réside dans l’absence de priorités politiques pour réaliser cet objectif ; dans une base de connaissances insuffisante pour appuyer efficacement l’éducation planétaire ; et dans les capacités limitées des enseignants à faire en sorte que leurs étudiants s’engagent sérieusement à acquérir de solides compétences mondiales.
Ce sont là les trois principaux défi s à relever pour que les écoles publiques se réorientent vers l’éducation planétaire généralisée. Compte tenu de ces défis, les possibilités sont les suivantes :
a) l’intégration des compétences mondiales dans le programme politique en matière d’éducation ;
b) la mise au point d’une base de connaissances solides sur les méthodes qui fonctionnent, leurs conséquences ainsi que leurs coûts ; et
c) les possibilités offertes aux enseignants de s’y préparer et de se doter d’un matériel pédagogique de haute qualité.
J’ai déjà expliqué ailleurs comment développer ces opportunités (Reimers, 2009).
5 – Conclusion
- La mondialisation a créé un contexte totalement nouveau pour nous tous.
Préparer les étudiants, et les doter des compétences et des dispositions éthiques qui leur permettront d’inventer leur avenir, tout en améliorant le bien-être des êtres humains dans ce nouvel espace, est le plus grand défi à relever pour les écoles d’aujourd’hui.
L’éducation planétaire est un objectif particulièrement pertinent pour les écoles, dont la visée, de longue date, est d’atténuer la violence et de contribuer à la paix.
Pour ce faire, nous devons nous concentrer sur trois objectifs et sur trois moyens d’action.
Ces objectifs sont le développement de valeurs mondiales, de compétences en langues étrangères, et d’expertise en matière d’affaires étrangères et de mondialisation.
Les moyens d’action consistent à
- élaborer des compétences mondiales en tant que politique prioritaire des systèmes d’éducation de masse ;
- développer la base de connaissances scientifiques permettant de déterminer les éléments qui fonctionnent, leurs conséquences et leurs coûts ;
- et continuer d’offrir des curricula de qualité, du matériel pédagogique et des possibilités de formation aux enseignants.
Le chemin est clair, et il est à la portée de tous ; et les avantages potentiels qu’il présente sont beaucoup plus importants que les approches coûteuses et compliquées que nous continuons d’adopter, dans l’espoir de parvenir à la paix et la stabilité internationales. »
– Reimers, F. (2010). Éducation au cosmopolitisme et à la paix. Dans : Abdeljalil Akkari éd., Transformations des systèmes éducatifs dans les pays du Sud: Entre globalisation et diversification (pp. 301-315). De Boeck Supérieur.

« L’éducation à la paix, pourquoi, comment, le rôle de l’école
L’année 2000 a été déclarée, année de la culture de la paix par la communauté internationale, lors de sa 53ème assemblée générale en juillet 1999, une façon d’amener les hommes à en ce début de millénaire de
- privilégier le dialogue dans la résolution des conflits,
- de développer des capacités à apprécier les différences et à entreprendre des actions constructives avec autrui pour asseoir durablement la paix, le développement économique et social.
L’école en tant qu’ institution de la société ne saurait se mettre à l’écart d’une telle réflexion, parce qu’elle subit les contrecoups de cette violence structurelle et qu’elle est un formidable laboratoire pour les idées nouvelles.
En outre la loi d’orientation de l’éducation nationale 91-22 du 16 février 1991 en son article I, alinéa 2 exprime cette éducation à la paix.
« L’éducation nationale tend à promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se reconnaît, elle est éducation pour la liberté, la démocratie pluraliste, le respect des droits de l’homme, développant le sens moral et civique de ceux qu’elle forme, elle vise à en faire des hommes et des femmes dévoués au bien commun, respectueux des lois et règles de la vie sociale et œuvrant à les améliorer dans le sens de la justice, de l’équité et du respect mutuel. «
Dans notre propos nous nous interrogerons d’abord sur la notion de paix ensuite nous examinerons la nécessité de l’éducation à la paix, son contenu, les approches et le dispositif à mettre en place à l’école pour la promotion d’une culture de paix.
A/ Qu’est-ce que la paix et pourquoi une éducation à la paix?
D’abord si l’on examine les représentations que les uns et les autres ont de la paix, l’on se rend compte que le concept recouvre des significations variées:
- Nous savons tous que pour le nourrisson, c’est l’affection, la sécurité ;
- chez l’enfant, c’est la joie, la découverte ;
- chez l’adolescent, la paix se traduit par la confiance, l’entente, un contrat avec la nature ;
- chez l’adulte, la paix se situe dans un emploi stable, au foyer, dans ses loisirs ;
- chez les personnes agées, la paix devient un sentiment affectif, un sentiment de sécurité.
Cependant, il convient de noter que ces différentes représentations de la paix illustrent une dimension de la paix c’est-à-dire la paix intérieure, un état d’esprit résultant d’une harmonie personnelle.
- D’autres conception de
- la paix évoquent les rapports avec les autres ( la paix sociale), entre états ;
- à cet égard on peut dire que la paix c’est les rapports entre personnes qui ne sont pas en conflits, rapports calmes entre deux personnes.
Le petit robert nous dit :
« C’est la situation d’une nation, d’un état qui n’est pas en guerre, ce sont des rapports calmes entre nations, c’est la concorde «
La paix est donc polysémique, c’est l’entente, la sécurité, l’harmonie avec la nature.
- La paix est en même temps
- un état d’esprit intérieur résultant d’une harmonie personnelle,
- un état d’harmonie sociale résultant d’une aptitude à la solution pacifique des conflits,
- une harmonie avec la nature.
L’on peut multiplier les définitions mais ce qu’il faut retenir c’et que la paix n’est pas seulement l’absence de conflits, ce n’est pas non plus le court intervalle qui sépare deux guerres comme le pensait Hugo de Groots car que dire cette violence structurelle, sournoise qui sévit chez les pauvres (faim, maladies , analphabétisme, injustice, destruction de l’environnement, par la faute d’un système inique etc..) et comme l’ont reconnu les rédacteurs de la charte des nations unies, le pire ennemi de la paix , c’est l’injustice.
- La paix , ce n’est pas seulement le désarmement, car s’arrêter de s’armer ne conduit pas nécessairement à la paix et cela pose encore le droit de chaque peuple à se défendre ;
- donc la paix, c’est plus que l’absence de guerre, de conflits, d’opposition,
- ce qui est une utopie car les conflits intra personnels et interpersonnels existeront toujours.
La paix doit être positive, basée sur le respect des droits de l’homme (justice, égalité, dignité etc..) C’est une relation entre individus, groupes d’états ou systèmes dans lesquels les conflits sont réglés sans violence.
Malheureusement aujourd’hui,
- la paix est menacée d’une manière sans précédent
- et cela pose la nécessité d’une éducation à la paix.
Aujourd’hui, des conflits et des tensions existent dans chaque région du monde ,nous assistons aussi à une prolifération des armes, à une violence institutionnelle qui est le résultat de la pauvreté, des inégalités sociales se caractérisent par la faim , l ‘analphabétisme ;
cette violence est caractéristique de l’état d’injustice et d’oppression qui sévit dans plusieurs états en développement et peut engendrer une autre violence que d’aucuns qualifient de juste d’autant que la résistance à l’oppression est un droit (préambule de la DUDH).
C’est d’ailleurs cet état de pauvreté qui a fait dire au Pape Paul VI dans son encyclique du 26 mars 1967 que » le développement est le nouveau nom de la paix « . Il faut citer aussi les violences psychologiques(discrimination, racisme, intolérance religieuse, injures , harcèlement sexuel etc..) ; aujourd’hui l’environnement se dégrade par la faute d’un développement anarchique, insouciant de l’avenir des générations futures. ; on assiste à un appauvrissement de la diversité biologique terrestre et marine, à l’avancée du désert, à la déforestation massive à une pollution atmosphérique sans précédent engendrant le réchauffement de la terre et la disparition de la couche d’ozone avec ses conséquences sur l’homme et son milieu.
Bref tout cela entraîne la rupture de l’équilibre entre l’homme et la nature et justement l’histoire nous rappelle que les causes des conflits peuvent résider dans la nature( volonté de domination des terres fertiles, les réfugiés écologiques dans les années 1980).
- L’ école n’est pas en reste, elle subit les contrecoups de cette violence structurelle car c’est une institution de la société et épouse ses contours, reproduit ses inégalités, ses conflits de valeurs,
- elle exclut aussi : injures , menaces , vandalisme, conflits entre élèves et enseignants, entre élèves et membres de l’administration ;
- elle transmet sans critique les héritages de discrimination ,
- elle se contente d’adapter les jeunes au monde tel qu’il est, peu démocratique;
- elle opère une sélection qui élimine une catégorie d’enfants et favorise l’élitisme au lieu d’aider à gommer sinon à réduire les inégalités sociales,
- l’école les accepte et même les renforce surtout aujourd’hui avec la crise économique(taxes d’écolage, cherté des fournitures scolaires etc…).
L’éducation à la paix apparaît donc comme une nécessité à l’école car comme le faisait remarquer Jacques Mühlethaler, le fondateur de l’EIP ( Association mondiale pour l’école instrument de paix),
l’éducation telle qu’elle est dispensée aujourd’hui a pour effet de diviser les hommes au lieu de les unir, l’accent est surtout mis sur la compétition, la performance et l’élitisme tend à glorifier l’individualisme au détriment de la coopération et la solidarité ;
- c’est pourquoi la devise de l’EIP » désarmer l’esprit pour désarmer la main » reflète bien le rôle que doit jouer l’école pour assurer une éducation à la paix..
En effet
l’école autant elle conserve la culture, autant si elle veut être démocratique doit proposer aux enfants ce qu’il y’a de mieux dans la société contemporaine, elle doit avoir une longueur d’avance sur la société, elle est à la fois un conservatoire pour les cultures et un laboratoire c’est à dire un terrain d’essai des progrès de la démocratie, du respect des droits de l’homme, c’est un terreau propice à l’expérimentation de nouvelles idées, à ce titre elle peut jouer un rôle de premier plan dans l’éducation à la paix.
B/ L’éducation à la paix, le rôle de l’école
A la lumière des éléments avancés ,
l’on peut dire que l’éducation à la paix a pour but de développer le sens des valeurs universelles et les types de comportements qui s’inspirent et fondent la paix.
Plus simplement nous dirons qu’elle a pour objectif d’
- amener les enfants à se connaître d’abord, à s’apprécier, à comprendre et à envisager avec sympathie les notions de justice, d’égalité, de liberté, de tolérance, de démocratie et de leur donner envie d’œuvrer pour un monde plus humain, plus solidaire.
A ce titre,
- elle doit développer des capacités pour apprécier les valeurs universelles que véhiculent les droits de l’homme(liberté, justice, égalité, tolérance etc…) et agir pour leur respect..
Elle doit développer les capacités suivantes :
- des capacités pour reconnaître et accepter les valeurs requises pour la vie en commun, et apprécier les autres cultures.
- des capacités de communiquer , de dialoguer, de partager, de coopérer, à travailler en groupe
- des capacités à mettre en œuvre son esprit critique, à s’ouvrir au changement, de modifier son jugement
- des capacités de participer à l’élaboration des règles de vie, à les respecter à l’école
- des capacités de comprendre la nature des conflits, les causes et les causes de la violence et de résoudre les conflits de façon constructive..
La Recommandation de l’UNESCO de 1974 sur l’éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales d’ailleurs, est on ne peut plus explicite à ce sujet puisqu’elle énonce les principes directeurs de cette éducation.
L’éducation à la paix est un ensemble de connaissances, de valeurs, d’attitudes et d’aptitudes permettant de vivre en harmonie avec soi-même , avec les autres et avec la nature.
- A l’école c’est une façon de vivre les relations avec ses pairs,
- une façon de régler les conflits,
- d’exercer l’autorité,
- et de réagir contre l’injustice.
Quel contenu associer aux compétences citées ci dessus et quelles approches ?
plusieurs disciplines permettent de développer ces compétences, nous citeront, la psychologie, la sociologie, la philosophie, la polémologie dont le fondateur Gaston Bouthoul disait pour contrer la guerre » si tu veux la paix , connais la guerre » ; l’histoire, la géographie, l’économie, l’éducation civique et morale etc…
- L’interdisciplinarité et la transdisciplinarité permettent une acquisition de ces compétences d’autant que l’éducation à la paix est globale ;
- on peut utiliser aussi l’approche culturelle avec les proverbes et dictons, la palabre, les techniques de résolution non violente des conflits ;
- mais plus que la discipline c’est la façon d’enseigner qui compte
- car elle est porteuse d’habiletés sociales.
Il faut remarquer que plusieurs cours transversaux existent et peuvent développer la culture de la paix qui est un ensemble d’attitudes et de comportements individuels et collectifs qui inspirent et fondent la paix :
–l’éducation interculturelle : elle vise à l’affirmation des cultures mais aussi et surtout à établir des liens entre les cultures à développer la tolérance active.
– l’éducation pour le développement : elle vise le développement d’un civisme global, à amener les enfants à œuvrer pour la construction de leur avenir ; elle est globale et comprend, les droits de l’homme, la résolution non violente des conflits, l’éducation environnementale.
– l’éducation environnementale : elle vise à développer des capacités pour comprendre l’environnement, les interrelations entre les éléments constitutifs et à agir pour sauvegarder cet équilibre.
–l’éducation à la démocratie : elle vise l’acquisition de compétences pour le dialogue, la négociation et la résolution non violente de conflits.
L’éducation à vocation internationale : c’est l’éducation pour la compréhension , la coopération et la paix internationales et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.
–l’éducation à la citoyenneté : elle vise à développer des capacités pour reconnaître et apprécier les valeurs requises pour la vie en commun, à opérer un choix et à agir dans ce respect.
L’éducation à la paix vient donc instrumenter l’individu pour lui permettre de vivre en harmonie avec lui-même, avec la société et avec la nature. C’est un processus et un état résultant de la pratique d’une citoyenneté démocratique et pluraliste inspirée des droits humains et orientée vers un développement durable.
Pour jacques Mûhlhethaler, le fondateur de l’Association Mondiale pour l’école instrument de paix, l’école doit jouer un rôle fondamental :
-elle doit être au service de l’humanité
-elle doit ouvrir à tous les enfants le chemin de la compréhension
-elle doit apprendrez le respect de la vie et des êtres humains
-elle doit enseigner la tolérance et doit développer chez l’enfant le sens de la responsabilité
-elle doit apprendre à l’enfant à vaincre son égoïsme
Ce rôle fondamental de l’école dans la construction de la paix est d’ailleurs précisé de façon explicite dans le préambule de l’UNESCO « la guerre prenant naissance dans l’esprit des hommes , c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. »
- Cette devise est un guide, qui doivent inspirer l’école pour une véritable éducation à la paix qui passe par l’exercice de la citoyenneté à l’école. ;
- et pour ce faire l’école doit socialiser au sens large du terme, en luttant contre les discriminations, en intégrant (école intégratrice) ;
- l’on doit y apprendre à vivre ensemble dans le respect des règles communes et dans le souci de promouvoir
- les valeurs de justice,
- de tolérance,
- de solidarité,
- les vertus du dialogue,
- l’exemplarité (l’action).
S’il est clair qu’on ne peut enseigner la démocratie que dans un cadre démocratique, que les droits humains ne peuvent s’épanouir que dans un état de droit, il est important que l’organisation scolaire (qui comprend les activités d’enseignement, la vie associative, le rôle des parents, les projets initiés par les élèves, les ressource, la bonne marche de l’établissement au plan administratif, social et éducatif) et le curriculum qui désigne l’ensemble des composantes de la vie scolaire en général notamment (les textes prescriptifs comme le régime pédagogique, les circulaires, les programmes d’étude, les matériels pédagogiques, les activités parascolaires, les tests d’évaluation formative et sommative, la réglementation scolaire, le projet éducatif de l’école) soient imprégnés des principes de droits de l’homme .
Les droits de l’homme doivent se vivre en classe et dans les autres structures de l’école comme les associations, les clubs et l’organisation scolaire doit permettre de vivre les valeurs apprises, donc de lier la pratique à la théorie. L’organisation scolaire doit être centrée sur l’enfant, branchée sur la réalité du quotidien, et fondée sur la collaboration et la coopération.
Au Sénégal, il faudra re dynamiser certaines structures qui existent déjà et en créer d’autres pour favoriser la participation des élèves et permettre la mise en pratique de certains principes démocratiques.
En particulier l’école doit :
-doit s’inscrire d’abord dans un projet qui énonce les grandes valeurs à promouvoir et le cadre de vie qu’elle voudrait créer .
-l’école doit élaborer une charte avec toutes les composantes de la communauté scolaire, fondée sur les droits de la personne et qui énonce des règles claires et des comportements souhaitées mais aussi des réparations comme conséquences aux manquements à une règle.
-Le foyer socio-éducatif ou association étudiante avec ses assemblées, ses clubs doivent permettre la libre expression des élèves. Outre les conférences, les activités récréatives , il doit constituer en son sein un comité de médiation pour résoudre les conflits.
-le conseil d’élèves : composé de délégués d’élèves dans un établissement, devrait pouvoir se réunir régulièrement et se prononcer sur les grandes questions liées à la bonne marche de l’établissement.
-la coopérative scolaire : doit jouer véritablement son rôle d’initiation des élèves des écoles primaires à l’exercice de la démocratie et à la citoyenneté en vue de la réalisation du projet d’école.
– l’ assemblée de classe ou le conseil de coopération : C’est la réunion de tous les enfants de la classe qui avec le maître , ensemble et en cercle, gèrent la vie en classe ; ce qui va bien , ce qui ne va bien, par exemple, l’organisation de la vie en classe, du travail, des responsabilités, des jeux, des relations interpersonnelles, les projets ; en somme elle tente de résoudre certains problèmes et prend des décisions pour la classe. C’est un lieu de gestion où l’on apprend entre autre à comprendre, à prévoir, à planifier, à décider, à organiser, à apporter des solutions, à évaluer, c’est un lieu où chaque enfant à sa place, où il est reconnu avec ses forces et ses faiblesses et accepté avec sa personnalité ; un lieu ou l’on accorde autant d’importance au groupe qu’à l’individu., c’et un moment d’apprentissage de l’acceptation des différences, de la compréhension , les enfants constatent rapidement qu’il y’a des droits collectifs et des droits individuels mais ils apprennent aussi que ces droits impliquent des responsabilités.
L’école doit permettre aux élèves de vivre les valeurs énoncées plus haut ,notamment par :
– l’exemplarité, c’est à dire mettre en pratique les idées que l’on prône , cela suppose que la communauté scolaire est en mesure de favoriser les expériences nouvelles.
-le dialogue , la concertation, la négociation dans la résolution des conflits :l’école doit être un espace de dialogue entre les membres de la communauté scolaire, enseignants, membres de l’administration, élèves ; faire de la concertation une règle dans toutes les structures de l’école, et en faire des lieux de parole. A ce niveau l’on peut s’inspirer de certaines valeurs éthiques Africaines et de certaines pratiques comme les règles relatives aux conflits, la tolérance religieuse, les décisions par consensus avec la palabre etc..
-la participation, qui se situe à plusieurs niveaux :
-aux activités de classe : ici il faudrait développer la pédagogie de l’expression, accorder la parole aux élèves, pendant les cours et lors des séances du Conseil de coopération, l’ enseignant doit instaurer un vrai dialogue, s’intéresser à chacun d’eux en leur témoignant une considération positive inconditionnelle, les entraîner à la réflexion, à l’autonomie , les inciter à découvrir par eux-mêmes, à s’approprier les connaissances, et à coopérer ; dans ce contexte l’enseignant devient un facilitateur d’échanges et comme le disait Galilée » On ne peut enseigner une chose quelconque à quelqu’un, on doit seulement l’aider à la découvrir » ; en définitive , l’enseignant comme l’enseigné, chacun s’implique dans le processus éducatif et comme le dit Paulo Freire dans pédagogie des opprimés » l’éducateur n’est plus celui qui simplement éduque, mais celui qui en même temps qu’il éduque est éduqué dans le dialogue avec l’élève ; ce dernier en même temps qu’il est éduqué est aussi un éducateur, tous deux deviennent des sujets dans le processus en ce sens qu’ils progressent ensemble «
-à la vie de l’école : les élèves comme dans une petite cité doivent participer à l’élaboration de la charte de l’école , des règles de vie, à participer activement aux activités du foyer socio-éducatif , à la coopérative scolaire, à prendre la parole dans les réunions mais aussi à prendre une part active dans l’organisation d’activités extrascolaires.
-à la vie de la communauté : l’école doit développer des projets d’entraide en faveur des plus démunis dans son environnement proche, protection de l’environnement, projets interculturels etc.. En d’autres termes, l’école doit s’ouvrir à la vie, mais aussi aller vers elle, s’intéresser aux problèmes de la communauté.
L’école doit lutter contre l’exclusion : Elle doit être plus intégratrice et accueillir les enfants de la rue, les enfants travailleurs, les petites bonnes, les handicapés et mettre ainsi en œuvre l’idée chère à Jacques Mûhlhethaler et à l’UNESCO d’ » une seule école pour tous « , énoncée depuis la conférence de Salamanque(Espagne) en 1994.
L’école doit lutter contre l’élitisme, la compétition en mettant en oeuvre une véritable pédagogie différenciée, en changeant de mode d’évaluation ; pour cela un véritable engagement de la communauté scolaire est exigée, mais aussi une volonté politique.
CONCLUSION :
L’école, parce qu’elle est un des lieu privilégié de formation des futurs citoyens, le vecteur des nouvelles valeurs, mais surtout parce qu’elle n’est pas non plus épargnée par la vague de violence qui sévit dans la société, elle doit éduquer à la paix.
Pour cela elle doit s’inscrire dans un véritable projet d’éducation à la citoyenneté, s’appuyant sur le dialogue, la concertation, la participation, la coopération, et lutter contre l’exclusion. »
– Saliou Sarr.

« L’efficacité de l’école se situe, aujourd’hui encore plus qu’hier, au cœur des plus grands enjeux collectifs et individuels.
Collectifs car dans une économie de la connaissance qui se mondialise, c’est à l’école que se forge la compétitivité des nations.
- Si nous voulons continuer à vendre du travail « cher » au reste du monde et à nos propres consommateurs, nous devrons le doper à l’éducation.
Individuels car, dans une économie de la connaissance, l’échec de l’école est devenu le principal facteur d’exclusion sociale.
- La situation de l’illettré illustre bien ce propos.
- Il y a cinquante ans, l’illettré souffrait d’un handicap social dans un monde où l’accès à l’information reposait principalement sur la maîtrise de la lecture, mais il trouvait sans difficulté sa place dans le système productif.
- Dans l’économie de la fin du xxe siècle, il a été exclu du monde du travail mais, dans un monde balisé par des signes, il pouvait encore ruser avec la vie quotidienne.
Dans la société de l’information qui se met en place,
- la maîtrise des qualifications scolaires de base – lire, écrire, compter – constituera un prérequis non seulement pour accéder au monde du travail et à l’information mais aussi pour participer aux nouveaux modes de consommation.
La société de l’information est porteuse d’un extraordinaire potentiel d’intégration à une échelle qui est devenue planétaire et, en même temps, d’un considérable pouvoir d’exclusion. Nous aspirons tous à une école « juste ». C’est en devenant efficace que l’école devient juste.
Or nous savons aujourd’hui, grâce aux évaluations internationales, que l’efficacité des systèmes éducatifs peut différer significativement.
- Entre certains pays d’Asie ou certains pays occidentaux comme la Finlande ou le Canada d’un côté et, la France de l’autre, les écarts sont significatifs.
- Mais nous savons aussi que les mêmes écarts se retrouvent, au sein d’un même pays, entre des écoles scolarisant des élèves comparables du point de vue de leur origine sociale.
On cite fréquemment le cas d’écoles et collèges qui obtiennent des résultats supérieurs à ceux auxquels on aurait pu s’attendre alors qu’ils scolarisent des élèves issus de milieux socialement et culturellement défavorisés. On évoque moins souvent les cas inverses – aussi nombreux que les précédents – d’établissements qui obtiennent des résultats inférieurs à ceux auxquels on pourrait s’attendre compte tenu de l’origine sociale de leurs élèves. Toutes les études conduites depuis une vingtaine d’années ont confirmé ce que les professionnels de l’éducation savent depuis toujours : il existe des établissements efficaces qui permettent à des élèves défavorisés d’obtenir des résultats supérieurs à ceux auxquels ils étaient destinés. À l’opposé, il existe des établissements inefficaces qui ne permettent pas à leurs élèves de réaliser pleinement leur potentiel scolaire. Tout le débat sur la carte scolaire relève de ce constat : au nom de quel principe supérieur peut-on imposer à une famille de maintenir son enfant dans un établissement inefficace ?
- Pourquoi une école est-elle plus efficace qu’une autre ?
La très grande majorité – des très nombreuses – études mises en œuvre pour répondre à cette question aboutit aux mêmes conclusions : c’est la qualité du management de l’école et celle de l’équipe éducative qui explique l’essentiel des différences constatées. Il n’y a d’ailleurs pas lieu de s’en étonner. L’école, unité de production du système, produit un service d’une extrême complexité et on sait que, dans toutes les organisations de ce type, ce sont les hommes et les femmes et les équipes qu’ils et elles constituent qui font la différence. Le maître dans sa classe est donc au cœur des plus grands enjeux de l’école.
- Or, en adoptant un point de vue délibérément orienté par l’analyse du fonctionnement des organisations et qui néglige donc volontairement d’autres aspects plus fréquemment abordés, on peut formuler quelques observations.
Les modalités d’exercice du métier
De manière certes caricaturale, mais la caricature n’est pas dénuée de vertus pédagogiques, les modalités d’exercice du métier d’enseignant présentent deux caractéristiques principales.
La première est qu’elles s’apparentent encore assez bien à celles d’une profession libérale en cabinet de groupe comme il en existait dans les années 1960 où des professionnels de haut niveau mettaient en commun une logistique administrative a minima et, pour le reste, géraient leurs propres clients et leurs propres dossiers sans trop se soucier de ce qui se passait dans le bureau voisin.
La seconde tient au fait que la définition de l’obligation de service est formulée en heures d’enseignement, sur une base hebdomadaire et, pour les enseignants du second degré, dans une seule discipline.
De telles modalités d’exercice entraînent plusieurs conséquences négatives. L’enseignant n’est pas seulement seul dans sa classe mais vit sa vie professionnelle dans la solitude. Cela signifie que, dans la majorité des cas, il doit affronter seul les difficultés qu’il rencontre avec ses élèves et on sait qu’il s’agit de situations de plus en plus fréquentes. Cette solitude interdit aussi tout partage d’expérience et constitue un frein très puissant à la diffusion de l’innovation. On parle aujourd’hui de learning organisations et des entreprises, singulièrement dans le secteur des services, se structurent en fonction de cet objectif.
- L’école, dont le métier est d’apprendre, se prive de cet atout dans l’exercice de son propre métier.
La présence limitée sur le lieu de travail pose évidemment celui de la disponibilité vis-à-vis des élèves et de leurs familles, dont on sait qu’elle peut se révéler décisive à certains moments clés de leur scolarité. Enfin, on sait que la rupture entre le mode de fonctionnement de l’école élémentaire, fondé sur la polyvalence du maître, et celui du collège, organisé sur la base de la monovalence du professeur, peut être source d’un véritable traumatisme pour certains élèves dont le destin scolaire peut s’en trouver irrémédiablement compromis.
Pour autant, ce professionnel de haut niveau, doté d’une grande autonomie dans l’exercice de son métier, n’est pas réellement soumis à une obligation de résultat mais, de fait, à une simple obligation de moyens. Tout se passe comme si le système auquel il appartient considérait que, au-delà d’une présence régulière, de la maîtrise de la discipline qu’il est chargé d’enseigner et de la qualité des cours qu’il délivre, le maître n’avait pas d’influence sur les résultats des élèves et ne pouvait donc pas être tenu comptable de ceux-ci.
- Le constat n’est pas nouveau et, pour autant, chaque fois qu’est évoquée la perspective de « travailler autrement » le refus est général.
À la fin des années 1980, un secrétaire général de la Fen en avait fait le thème du congrès annuel de la fédération. Il n’y a pas survécu. Il est d’ailleurs significatif de constater que l’on continue à construire ou à rénover des bâtiments scolaires sans prévoir des locaux de travail pour les enseignants hors des temps de cours, comme si le mode d’exercice actuel était immuable. Quand le béton prend le relais des statuts, il ne faut pas s’étonner de la capacité de résistance de l’institution.
L’organisation du travail
La plupart des organisations productives, même dans les activités de service, se sont structurées autour du principe de la division du travail qui a été partout à l’origine d’une plus grande productivité. L’école y a à peu près complètement échappé.
On continue à demander aux enseignants d’assumer plusieurs fonctions qui correspondent en fait à des métiers différents qu’ils maîtrisent rarement tous au même niveau :
- élaborer le contenu académique du message,
- mettre ce message en forme pédagogique,
- le transmettre,
- assurer le suivi méthodologique et le tutorat…
- et si l’on s’attache à mesurer le temps qu’un enseignant consacre aux différentes composantes de son activité, on est conduit à constater que l’essentiel est dévolu à répéter des contenus qui pourraient être accessibles, au moins pour une bonne part, sous d’autres formes et hors la salle de classe et hors de la présence du maître.
Le problème ressurgit aujourd’hui avec celui de l’encadrement du travail personnel des élèves dont on mesure que, faute d’être assuré dans l’école elle-même, il est renvoyé sur les familles qui, le cas échéant et de plus en plus fréquemment, sont elles-mêmes conduites à recourir à du soutien scolaire rémunéré.
Jusqu’à la fin du xixe siècle, cette division du travail existait au lycée au sein duquel cohabitaient des professeurs et des répétiteurs ou maîtres d’études.
- Paradoxalement, c’est lorsque la transformation de la population scolaire aurait rendu cette organisation du travail particulièrement nécessaire que le système a choisi d’y mettre fin pour des raisons qui tenaient davantage aux préoccupations du corps enseignant que de l’intérêt des élèves.
Aujourd’hui, avec l’irruption des technologies de l’information, les enseignants prennent conscience que ce mode d’organisation du travail devient particulièrement contre-productif. Ils ont vite constaté que la qualité pédagogique d’un DVD ou d’un cours en ligne s’améliorait de manière décisive avec l’intervention de professionnels : scénaristes, graphistes, informaticiens, documentalistes… C’est peut-être par ce biais, en tout cas davantage que par la voie des injonctions administratives, que les enseignants découvriront les vertus du travail en équipe.
Innovation et progrès technique
Si l’on se place dans une perspective longue, on est conduit à constater que l’école a fait preuve d’une remarquable capacité de résistance à l’innovation et au progrès technique et, de ce point de vue,
- le système éducatif justifierait l’appellation d’empire immobile.
Les méthodes d’enseignement ont, en définitive, peu évolué.
Les débats ont été très vifs – prenant parfois une tonalité quasi théologique – à propos des apprentissages du jeune enfant. Ils ont conduit le plus souvent à des excommunications qui ont permis de préserver le cœur du système de toute contamination. Freinet, Montessori et quelques autres ont inspiré un petit nombre de praticiens qui vivent sur les marges, à l’étranger d’ailleurs plutôt qu’en France.
- Les débats des années 1970 ont tourné court, victimes sans doute de leur propre dogmatisme et de leurs propres outrances, mais sans avoir inséminé la réflexion.
- Le désarroi le plus complet règne au niveau de l’enseignement secondaire qui est pourtant confronté à une transformation radicale de son public traditionnel.
Or, les systèmes éducatifs se trouvent aujourd’hui devoir faire face, pour la première fois peut-être depuis que l’on enseigne sous une forme organisée, à une révolution technique qui est de nature à modifier substantiellement la relation traditionnelle entre le maître et l’élève.
Jusqu’à présent, les seules véritables évolutions se sont manifestées à la périphérie du système, là où il est confronté à des situations inhabituelles : la prise en charge d’élèves non scolarisables dans le cadre traditionnel de l’établissement ou l’irruption du public adulte de la formation continue.
À l’opposé, les technologies de la communication touchent le cœur du système et sont de nature à affecter les logiques qui sous-tendent l’acte même d’enseigner. Et cette révolution, loin d’être achevée, s’accélère tous les jours : le plan « informatique pour tous » n’a que 20 ans et pourtant il est aux technologies d’aujourd’hui ce que les fresques de la grotte Chauvet sont à la peinture contemporaine. Vingt années sont passées qui paraissent vingt siècles.
[…] »
– Boisivon, J. (2007). Des maîtres pour une école efficace. Pouvoirs, 122(3), 91-101.
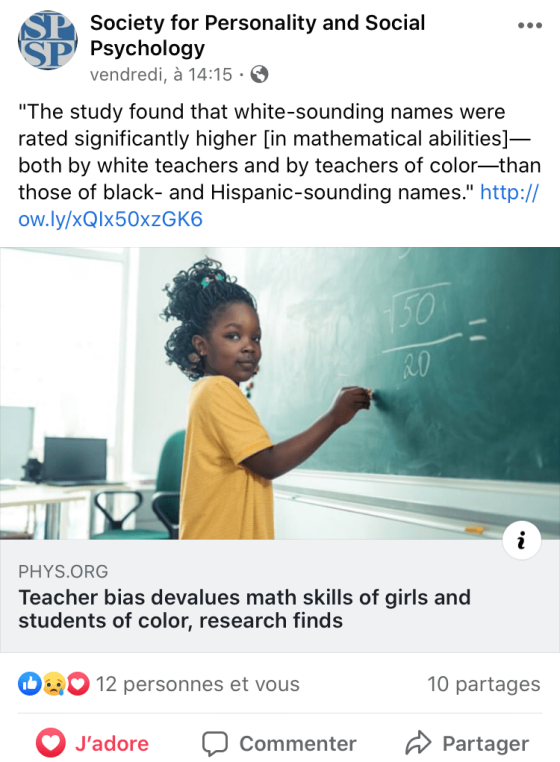
« Lorsqu’on aborde la question de la scolarité des descendants d’immigrés, c’est le plus souvent en termes d’échec, de violence scolaire, de relégation, de discriminations, de con?its culturels, de marginalisation ou encore de rapports sociaux et donc de reproduction sociale par le système scolaire. Si bon nombre de ces recherches sont nécessaires (à condition qu’elles soient posées de façon adéquate), on se penche peut-être trop rarement sur ceux qui s’inscrivent dans des trajectoires de réussite, voire de surclassement scolaire.
- Il semble pourtant tout aussi important de découvrir les processus qui favorisent le succès scolaire que de se focaliser uniquement sur les processus qui mènent à l’exclusion des possibilités de promotion sociale par l’école.
Par ailleurs, une autre inversion du regard semblait être utile, relative ici à la lexicologie.
[…]
Elles permettent aussi, comme le souligne Guénif-Souilamas 2000, d’opérer une rupture sémantique et donc un renouvellement du regard sociologique posé sur l’objet.
[…]
Scolarité des descendants d’immigrés maghrébins : entre discriminations et mobilisation
Un constat relatif aux taux d’échecs selon les origines anime diverses études tant belges que françaises :
- globalement, les enfants d’immigrés maghrébins ne se distinguent pas par des taux plus élevés que l’ensemble des jeunes dont les parents ont des statuts socioprofessionnels équivalents.
- Si bon nombre s’inscrivent dans des parcours d’échec, ceux-ci peuvent être largement expliqués par leur origine sociale et des processus de discrimination.
Ce constat mérite quelques éclaircissements.
[…]
Au bout du compte, les trajectoires de vie de ces jeunes femmes sont toutes apparues comme singulières, originales. Il est donc impossible et vain de conclure à un modèle “déterministe”, d’établir une liste de facteurs récurrents menant à la réussite universitaire. Nous avons cependant vu l’importance de considérer la mobilisation parentale autour du projet scolaire. Et puis, surtout, un point commun rassemble ces jeunes femmes, c’est l’importance de leur personnalité, laquelle leur a permis de modi?er le cours de leur histoire et de mettre à mal les logiques de reproduction sociale. Non seulement la double logique de reproduction évoquée en début d’article, à savoir, premièrement, celle qui est liée à la domination de genre : ?lles de mères éduquées dans la “tradition arabo-musulmane”, elles sont devenues des femmes revendiquant une autonomie de corps et d’esprit. Deuxièmement, celle qui est liée à la domination socio-économique : ?lles d’immigrés économiques pour la plupart illettrés et appartenant à des catégories professionnelles souvent déclassées, elles ont accompli une ascension sociale par leur réussite universitaire. Mais ces jeunes femmes mettent surtout à mal cette logique de domination sociale fondée sur une injonction paradoxale qui, d’une part, les exhorte à s’assimiler à une identité sociale féminine attendue et qui, d’autre part, les enferme dans la logique de reproduction symbolique d’une identité “immigrée”. Ces ?lles d’immigrés tendent à refuser toute assignation identitaire et sont, tant bien que mal, à la recherche de nouvelles manières d’être femmes et ?lles d’immigrés, sans l’être i.e. immigrées pour autant, et c’est sans doute ce dernier aspect qui leur pose tant de dif?cultés. La ?lle d’immigrés n’est pas une immigrée, ni d’un point de vue culturel, ni d’un point de vue socio-économique, mais elle le reste encore trop souvent d’un point de vue symbolique à travers les représentations sociales dominantes qui tendent à les con?ner à une identité stigmatisée.
Pour conclure, je laisserai la parole à cette jeune femme, ?lle d’immigrés algériens, dont les propos re?ètent l’exaspération qu’elle ressent face à cette domination symbolique : “Je dirais [que je ne suis] ni belge, ni algérienne, non, mais ?nalement un peu comme les Noirs américains, c’est-à-dire autre chose […]. [La deuxième génération] c’est une génération qui va avoir à construire autre chose […]. Ça ne m’intéresse pas de savoir si je me sens plus algérienne ou si je me sens plus belge, […] j’ai des af?nités par rapport à certaines conceptions et pas d’autres. […] pas mal de Belges me considèrent comme étant une Belge, ce que je refuse, [… il y a] cette espèce d’arrogance qui fait que dès qu’on a choisi une manière de vivre qui est autre, pour eux, on est tombé de l’autre côté, c’est-à-dire qu’on a épousé la culture occidentale […] qui d’emblée est supérieure à l’autre.” »
– de Villers, J. (2003). La reproduction impossible: Entreprendre des études universitaires lorsqu’on est descendante d’immigrés maghrébins en Belgique. Éducation et sociétés, no 12(2), 111-123.

« […]
Les composantes développementales se réfèrent aux tendances préposées à la régulation et à l’amélioration de l’équilibre que l’individu instaure avec son milieu.
Alors que les composantes biopsychiques concernaient essentiellement les équilibres organiques (santé, alimentation, hygiène, sécurité),
- les aspects développementaux désigneront, dans notre propos, les tendances à la rééquilibration psychosociale.
A – Mobiles et motivations de développement
Les composantes développementales peuvent se diviser en trois grands groupes de tendances :
- tendances à la possession,
- tendances à l’intégration,
- tendances à l’affirmation.
1 – Les tendances à la possession
Le fait de posséder confère à l’homme un sentiment de stabilité qui augmente son degré d’autonomie et contribue à la réalisation de soi.
« Outre sa maison, son lopin de terre, ses champs, écrit Paulus, l’homme possède ses meubles, ses outils, ses bibelots. Plus qu’à tout le reste, il s’attache, dans nos sociétés, à l’argent, signe universellement échangeable et symbole de puissance. »
(Paulus J., Réflexes, émotions, instincts, Bruxelles, Dessart).
2 – Les tendances à l’intégration
Outre leur aspect social, elles sont liées au besoin d’un environnement stable et harmonieux, au besoin de succès professionnel, au besoin de liberté de mouvement et de récréation.
3 – Les tendances à l’affirmation
Le besoin de réalisation de soi, de promotion et d’épanouissement est un besoin universel, mais qui se heurte souvent à des tendances analogues des autres individus du corps social.
Ces rivalités se traduisent par des conduites d’agression, de domination et de compétition qu’accompagnent, alors, d’autres conduites de rééquilibrage (apaisement, soumission, séduction).
[…] »
– Minder, M. (2008). Chapitre 2 Les variables développementales. Dans : , M. Minder, Champs d’action pédagogique: Une encyclopédie des domaines de l’éducation (pp. 101-208). De Boeck Supérieur.

« Comme d’autres champs de l’activité humaine, l’éducation est sujette de plus en plus clairement à une mondialisation de ses principes et de ses règles.
- S’il fut un temps du tout politique où elle visait à l’universel, elle ne se présente désormais plus que comme techniquement internationale.
Les politiques éducatives subissent en effet une forme de réi?cation marchande :
- leur projet, toujours particulier à une communauté qui le soutient, est soumis à la pression des logiques de gestion qui, techniciennes et mercantiles, sont, d’évidence, identiques en tout lieu.
Cette internationalisation de la gestion éducative trouve une expression dans les métamorphoses que l’Union européenne tente d’induire dans les systèmes éducatifs de ses pays membres au travers du concept de “lifelong learning”, d’éducation et formation tout au long de la vie. On n’oserait parler à leur propos de réformes ou de mesures tant les instances régulatrices semblent se tenir en retrait, ne légiférant qu’en dernier ressort et, alors, alléguant qu’elles ne font qu’avaliser et soutenir les transformations entreprises par les acteurs sociaux eux-mêmes ou rendues nécessaires par les faits. Car, en dehors des principes aussi vagues que consensuels qu’elles édictent pour l’éducation de demain, les instances européennes ne prétendent qu’à accéder à la réalité des choses, à l’évaluer et à proposer les solutions qui s’imposent d’elles-mêmes. Elles escamotent ainsi la position politique adoptée, ne laissant d’autre prise à la critique que des actes présentés comme techniques tels que la production et l’interprétation de statistiques, la création de réseaux d’échange de bonnes pratiques ou l’organisation de consultations citoyennes. Cet article tente de faire émerger le projet politique qui sous-tend le concept d’éducation et formation tout au long de la vie dans la rhétorique européenne ainsi que ses méthodes d’imposition.
L’éducation et la formation tout au long de la vie, une certaine vision du monde
La mise au jour des principes politiques sous-jacents à l’éducation et à laformation tout au long de la vie semble entravée par son ambition totalisatrice. Derrière ce vocable, la Communication de la Commission 2001 indique en effet qu’il ne faut rien entendre de moins que “toute activité d’apprentissage entreprise à tout moment de la vie, dans le but d’améliorer les connaissances, les quali?cations et les compétences, dans une perspective personnelle, civique, sociale et/ou liée à l’emploi” (Commission européenne 2001b, 11). De même, l’identi?cation de ses fondements politiques est rendue malaisée par le caractère consensuel du concept. Il est de ces notions aux contours ?ous que mobilisent des acteurs aussi divers que les projets qu’ils défendent.
En dépit de sa plasticité, ce concept n’est pas neutre politiquement. Il est le résultat d’une histoire qui commence dès les années 1920, le produit de choix entre différentes conceptions du bien commun.
Par ailleurs, les discours de ses principaux chantres, l’UNESCO, l’OCDE et l’Union européenne, se différencient sensiblement.
- Une perspective historique et institutionnelle aide à le resituer dans le temps de même qu’elle souligne les particularités de la rhétorique de l’Union européenne.
Elle véhicule une palette importante de présupposés idéologiques qui acquièrent, avec le temps, au même titre que certains axiomes de l’économie, l’évidence d’une loi naturelle. Cet allant-de-soi dans la dé?nition d’une situation pourtant complexe explique partiellement l’aisance avec laquelle cette “nouvelle politique éducative intégrée” s’impose dans les paysages nationaux.
Examinons d’abord le contenu de l’éducation et la formation tout au long de la vie avant d’en exposer la technique d’imposition douce, la méthode de bonne gouvernance, utilisée par l’Union pour les faire pénétrer dans les politiques des États membres ou associés.
[…]
Et tel est bien l’enjeu à moyen terme. Les politiques nationales de l’éducation semblent appelées à quitter le giron de l’État pour gagner, comme l’accordgénéral sur le commerce et les services négocié à l’OMC invite à le faire, la sphère privée, plus apte à les gérer souplement et ef?cacement par rapport à une demande du marché. Il n’est plus alors question d’une éducation pour se grandir mais d’une formation ou d’un apprentissage pour servir.
- Ainsi, les mécanismes de certi?cation et validation constituent les modi?cations principales engagées par les politiques européennes.
D’une admirable ef?cacité pratique, ils ne représentent que peu d’intérêt pour les objectifs de citoyenneté et de développement de soi, ils assoient surtout la vocation professionnelle de la formation et préparent un avenir où les usagers, ultimes béné?ciaires responsables de celle-ci, paieront eux-mêmes et selon des modalités à dé?nir — l’intervention de l’État n’étant pas totalement exclue mais sous une forme davantage contractuelle qu’universelle— leur formation.
La finalité réelle des politiques éducatives, en s’inscrivant dans l’individu agent de son propre parcours, substitue à l’épanouissement individuel par le savoir l’insertion sociale d’un agent utile à la production.
- La gestion prend dans ce champ aussi le pas sur une dé?nition sociale du bien collectif.
Comme un monstre de Frankenstein, la créature prend le pas sur son créateur, l’économie envahit le politique. »
– Mahieu, C. & Moens, F. (2003). De la libération de l’homme à la libéralisation de l’éducation. Éducation et sociétés, no 12(2), 35-55.

« […] Ce livre présente une multitude de résultats et constitue un intéressant portrait des jeunes contemporains. Sa lecture soulève néanmoins trois grandes questions.
Primo : que mesure-t-on, lorsque l’on se réfère aux valeurs ?
Il faut partir de ce constat : les valeurs ne pouvant pas être observées, il est nécessaire de multiplier les indicateurs censés les approcher et de parier sur la proximité conceptuelle entre ce qui se cache à l’observation et ce qui est observable. Cette démarche est au cœur de tout raisonnement explicatif s’appuyant sur un recueil de données par questionnaires, la multiplication des domaines d’investigation s’inscrivant dans la visée même d’objectivation.
- Pourtant, lorsque l’on souhaite approcher les valeurs partagées par un groupe social, cette question devient d’autant plus épineuse que celles-ci sont approchées par des indicateurs disparates.
- On remarque en effet, sous la plume des auteurs, un abondant recours à des concepts qui devraient appartenir au champ sémantique des valeurs, mais qui sont loin d’être synonymes :
- les attitudes, les opinions, les préférences, les valorisations, les attachements, les appartenances, les croyances, les prises de position, etc.
- Le lecteur peut alors avoir le sentiment que les auteurs ont examiné des éléments rangés, parfois arbitrairement, sous la catégorie “valeurs”.
- L’hétérogénéité des domaines permettant d’approcher les valeurs ne constituerait pas à la rigueur un problème si les chercheurs faisaient des ponts entre eux. On aurait souhaité qu’on indique, par exemple, comment on passe des préférences aux rapports aux institutions, aux jugements portés sur des normes, etc.
Secundo, quelle image de la jeunesse les enquêtes sur les valeurs renvoient-elles ?
- L’un des paradoxes des enquêtes sur les valeurs est que souvent sont considérées comme des valeurs (ou préférences) des choses qui paraissent déjà socialement classées comme telles (famille, travail, amis, loisirs dans ce livre) ou qui appartiennent traditionnellement à la sphère de la morale et de la citoyenneté (encore, la religion et la politique).
- Ainsi, comme dans d’autres domaines de la recherche contemporaine dans les sciences sociales, le risque est grand de produire une interaction non maîtrisée entre les savoirs profanes — qui produisent et soutiennent telles ou telles valeurs— et les savoirs savants — qui dans la tentative d’objectiver les valeurs concourent à les reproduire.
Tertio, il reste le problème du pouvoir heuristique des valeurs : qu’explique-t-on par les enquêtes sur les valeurs ? Peut-on se débarrasser du problème du lien entre les valeurs et l’action si l’on dé?nit et conçoit les premières comme des “repères” qui la fonderaient ?
Le lecteur peut être d’autant plus étonné par le pari du livre de se consacrer exclusivement à l’étude des valeurs que plusieurs exemples démentent les intentions initiales. Est en effet justement pris en compte l’un des décalages les plus aigus entre les idéaux et les pratiques : l’égalité entre hommes et femmes.
- Ainsi, le temps ne serait-il pas venu de combiner différents outils de recherche — valeurs et pratiques— et différentes méthodes — questionnaires, observations, monographies— afin de mieux cerner comment il est possible qu’un tel décalage (et bien d’autres) perdure ?
Si le système normatif se modifie, pourquoi les pratiques semblent-elles souvent aller à l’encontre du changement ? »
– Cicchelli, V. (2003). Les valeurs des jeunes. Tendances en France depuis 20 ans: de Olivier Galland et Bernard Roudet (éds ), 2001, l’Harmattan, Collection débats jeunesses, 240 pages. Éducation et sociétés, no 12(2), 179-181.

« […]
Écoutons Durkheim (2007, p. XX), dans Les règles de la méthode sociologique, expliciter comment peut se produire la contrainte sociale, et quelle est l’entité théorique qui peut en rendre compte :
« Et, au fond, c’est là ce qu’il y a de plus essentiel dans la notion de la contrainte sociale. Car tout ce qu’elle implique, c’est que les manières collectives d’agir ou de penser ont une réalité en dehors des individus qui, à chaque moment du temps, s’y conforment.
Ce sont des choses qui ont leur existence propre. L’individu les trouve toutes formées et il ne peut pas faire qu’elles ne soient pas ou qu’elles soient autrement qu’elles ne sont ; il est donc bien obligé d’en tenir compte et il lui est d’autant plus difficile (nous ne disons pas impossible) de les modifier que, à des degrés divers, elles participent de la suprématie matérielle et morale que la société a sur ces membres. Sans doute, l’individu joue un rôle clans leur genèse.
Mais pour qu’il y ait fait social, il faut que plusieurs individus tout au moins aient mêlé leur action et que cette combinaison ait dégagé quelque produit nouveau. Et comme cette synthèse a lieu en dehors de chacun de nous (puisqu’il y entre une pluralité de consciences), elle a nécessairement pour effet de fixer, d’instituer hors de nous de certaines façons d’agir et de certains jugements qui ne dépendent pas de chaque volonté particulière prise à part.
Ainsi qu’on l’a fait remarquer, il y a un mot qui, pourvu toutefois qu’on en étende un peu l’acception ordinaire, exprime assez bien cette manière d’être très spéciale : c’est celui d’institution.
On peut en effet, sans dénaturer le sens de cette expression, appeler institution, toutes les croyances et tous les modes de conduite institués par la collectivité ; la sociologie peut alors être définie : la science des institutions, de leur genèse et de leur fonctionnement ».
Une telle définition de la notion d’ « institution », mot, dont, nous dit Durkheim, il faut qu’on « en étende un peu l’acception ordinaire » est pour nous essentielle, pas seulement au plan empirique, mais au plan conceptuel, puisqu’elle fait comprendre la forme d’objectivité dont relève le social.
Dans une note au sein de l’introduction de son dernier livre, Les formes élémentaires de la vie religieuse (1960), Durkheim explicite d’ailleurs très clairement la manière dont on peut considérer l’institution :
« C’est pourquoi il est légitime de comparer les catégories à des outils ; car l’outil, de son côté, est du capital matériel accumulé. D’ailleurs entre les trois notions d’outil, de catégorie et d’institution, il y a une étroite parenté » (Durkheim, 1960, p. 27).
On pourrait suivre ici un peu plus loin le fil de la pensée de Durkheim.
Celui-ci explicite en effet que les catégories peuvent apparaître « comme de savants instruments de pensée, que les groupes humains ont laborieusement forgés au cours des siècles et où ils ont accumulé le meilleur de leur capital intellectuel » (Durkheim, 1960, p. 27).
Ainsi, pour Durkheim, les outils cristallisent du capital matériel accumulé, et les catégories du capital intellectuel accumulé.
On peut alors se poser la question, que d’ailleurs Durkheim ne semble pas poser directement sous cette forme, du genre de capital que cristallisent les institutions, dans leur parenté pragmatique et pragmatiste avec les outils et les catégories, et on peut conjecturer que ce capital produit de la légitimité, de la normativité.
Je vais revenir très vite sur la question des catégories et sur celle de la légitimité, mais avant cela, je voudrais reprendre le texte de Durkheim des Règles de la méthode sociologique cité ci-dessus, qui comporte à son extrême fin une note de bas de page que je donne directement ci-dessous :
« De ce que les croyances et les pratiques sociales nous pénètrent ainsi du dehors, il ne suit pas que nous les recevions passivement et sans leur faire subir de modification.
En pensant les institutions collectives, en nous les assimilant, nous les individualisons, nous leur donnons plus ou moins notre marque personnelle, c’est ainsi qu’en pensant le monde sensible chacun de nous le colore à sa façon et que des sujets différents s’adaptent différemment à un même milieu physique.
C’est pourquoi chacun de nous se fait, dans une certaine mesure, sa morale, sa religion, sa technique.
Il n’est pas de conformisme social qui ne comporte toute une gamme de nuances individuelles. Il n’en reste pas moins que le champ des variations permises est limité.
Il est nul ou très faible dans le cercle des phénomènes religieux et moraux où la variation devient aisément un crime ; il est plus étendu pour tout ce qui concerne la vie économique. Mais tôt ou tard même dans ce dernier cas, on rencontre une limite qui ne peut être franchie ».
Durkheim, 1937, p. XX
- Sans doute cette remarque pourrait-elle couper court à certaines des critiques produites à l’encontre de Durkheim, qui considèrent que
- sa pensée réifie le monde social et se trouve incapable d’en faire comprendre le dynamisme.
On pourrait dire certes en même temps que Durkheim est encore « loin du compte » pour certains ethnométhodologues.
Mais ce que je retiendrai de ces lignes,
- c’est cette idée que l’assimilation des institutions suppose leur individualisation, d’une part, et d’autre part que « le champ des variations permises est limité ».
C’est l’une des forces du modèle du jeu que de faire saisir cela :
si je suis pris dans un jeu institutionnel, je ne peux prétendre m’abstraire de ses règles définitoires (même si je tente dans certains cas de les redéfinir), ni ignorer certaines de ses règles stratégiques. Mais dans le même temps, ma manière de jouer le jeu va provenir d’un « sens du jeu » qui me sera en grande partie idiosyncratique.
- Durkheim propose donc de considérer qu’il existe une parenté étroite entre les notions d’institution et de catégories.
Il reprend en particulier cette idée dans un texte écrit avec Mauss (De quelques formes de classification. Contribution à l’étude des représentations collectives, 1903).
Après avoir montré que, pour la connaissance commune, les facultés intellectuelles « dans leurs traits essentiels… auraient été constituées dès qu’il y a eu une humanité », les auteurs précisent ceci :
« Et cette conception n’avait rien de surprenant tant que le devenir des facultés logiques passait pour ressortir à la seule psychologie individuelle, tant qu’on n’avait pas encore eu l’idée de voir dans les méthodes de la pensée scientifique de véritables institutions sociales dont la sociologie seule peut retracer et expliquer la genèse ».
Durkheim & Mauss, 1903, p. 3
- On le voit, ici, ce sont « les méthodes de la pensée scientifique » qui constituent de « véritables institutions sociales ».
Cette perspective institutionnaliste atteint une puissance encore supérieure lorsque Durkheim, dans l’introduction aux Formes élémentaires de la vie religieuse, écrit au sein d’une note de bas de page, à propos de la catégorie de temps :
« On voit par là toute la différence qu’il y a entre le complexus de sensations et d’images qui sert à nous orienter dans la durée, et la catégorie de temps. Les premières sont le résumé d’expériences individuelles qui ne sont valables que pour l’individu qui les a faites. Au contraire, ce qu’exprime la catégorie de temps, c’est un temps commun au groupe, c’est le temps social, si l’on peut ainsi parier. Elle est elle-même une véritable institution sociale. Aussi est-elle particulière à l’homme ; l’animal n’a pas de représentation de ce genre ».
Durkheim, 1960, p. 15
- L’institution constitue ainsi une forme d’a priori,
- mieux, elle exprime, pour Durkheim, la socialité foncière de l’a priori,
- un a priori presque aussi prégnant que l’a priori kantien, toujours déjà-là, mais organiquement historique.
Au-delà de la discussion de la conception durkheimienne du temps, des catégories, et de l’institution, je voudrais souligner ce fait qu’indépendamment de ses modes de fonctionnement,
une institution atteint à une sorte de normativité fondamentale, à une production de légitimité morale, que Durkheim trouve dans « cette suprématie morale de la société sur ses membres ».
Lorsque celui-ci affirme que, dans une institution donnée,
« le champ des variations permises est nul ou très faible dans le cercle des phénomènes religieux et moraux ou la variation devient aisément un crime » (Durkheim, 1937, p. XX), il affirme la normativité foncière de toute institution.
- Agir à l’intérieur d’une institution différemment des manières communes, cela peut vite devenir fautif.
- Agir conformément aux habitudes de l’institution, c’est une sorte d’obligation morale.
C’est une caractéristique des institutions dont l’anthropologue britannique Mary Douglas, dans la filiation durkheimienne, a saisi toute la portée dans un livre essentiel (Comment pensent les Institutions).
Douglas montre ainsi qu’une institution peut être considérée comme une machine à produire des catégories affectives, perceptives, et cognitives légitimes, cette normativité provenant en grande partie des analogies fondatrices qui produisent son identité.
Dans le troisième chapitre de son livre,
- elle explicite en effet comment l’institution confère « un statut naturel à des relations sociales », en « utilisant des analogies formelles à même d’ancrer la structure abstraite des conventions sociales dans une structure appliquée à la nature » (Douglas, 1999, p. 72).
- Ces analogies permettent aux simples conventions de perdurer, puisqu’elles ancrent les rapports des humains dans leur cognition, dans leurs catégories de pensée :
- « pour qu’une convention devienne une institution sociale légitime, il faut une convention parallèle de type cognitif qui la soutienne » (Douglas, 1999, p. 66).
Au-delà de la seule question de la normativité se pose la question des catégories qui permettent l’action, et donc celle de l’attribution d’identité, puisqu’une catégorie repose d’abord sur la réunion d’éléments considérés comme identiques sous un certain point de vue.
- Il s’agit alors de savoir « comment les individus se mettent d’accord sur la ressemblance ou la dissemblance entre deux choses » (Douglas, 1999, p. 72).
À la question : en quoi consiste la ressemblance ? Douglas affirme alors que celle-ci sera « conférée au faisceau hétérogène de choses qu’on considère comme éléments d’un même ensemble. Ce sont donc les institutions qui constituent et fixent leur similitude » (Douglas, 1999, p. 72).
« Les anthropologues admettent généralement l’enseignement de Quine selon lequel c’est le fait d’être pris dans une structure théorique qui confère leur identité aux objets, ou leur similitude (sameness). Mais, comme le dit David Bloor, les théories mathématiques sont des institutions et réciproquement.
- Nous voudrions ajouter que les institutions accomplissent les mêmes tâches que les théories.
- Elles aussi confèrent leur ressemblance aux objets.
- Une fois qu’un schéma théorique a été développé, des éléments, qui, au stade pré-théorique, avaient un statut incertain, perdent leur ambigüité.
- Ils trouvent une définition quant leur place normale dans le fonctionnement du système est montrée.
La puissante attaque de Quine contre l’idée que la similarité puisse avoir un statut indépendant remonte très loin.
- La ressemblance (sameness) n’est pas une qualité qui peut être reconnue aux choses elles-mêmes.
- Elle est conférée à des éléments pris dans un schéma cohérent ».
Douglas, 1999, p. 77
Que les « institutions accomplissent les mêmes tâches que les théories », ce n’est en rien anodin. Les éléments de pratiques trouvent leur identité et donc leur ressemblance à d’autres au sein d’un voir-comme institutionnel, et les institutions didactiques fonctionnent sans doute plus que tout autre comme des théories, puisque leur fonction est précisément de familiariser leurs sujets à des « schéma théoriques » changeants, sur un arrière-fond de permanence.
- Lorsque je dis qu’un jeu est une institution, c’est donc sur cet aspect consubstantiellement cognitif, perceptif, et affectif que je veux insister.
- Décrire les activités sociales sous le modèle du jeu, ce n’est certes pas les imaginer en petits amusements légers qui n’impliqueraient pas ceux qui s’y livrent.
- Apprendre puis jouer un jeu institutionnel,
- c’est entrer dans une théorie du monde, dans « un monde de pensée », qui assigne aux objets du monde et aux relations qui les unissent une identité et une fonction précises.
Ce faisant, les institutions fournissent des styles de pensée (Fleck, 2005).
Sont donc attachés aux jeux des styles de pensées, qui, comme le dit Fleck, se caractérisent par « la disposition pour une perception dirigée et par une assimilation conforme de ce qui a été perçu » (Fleck, ibid., p. 247).
Le style de pensée s’actualise dans le sens du jeu que les joueurs mettent en œuvre, ce sens du jeu s’incarnant dans une perception spécifique au jeu, et dans « l’état d’esprit » particulier qui accompagne le style de pensée au sein d’un « collectif de pensée déterminé ».
- Si le jeu est une institution, cela signifie qu’agir dans un jeu est agir attaché à une sorte de modèle que l’institution impose à nos conduites.
Il existe une synergie étonnante, sur ce point, entre des philosophes comme Deleuze et Merleau-Ponty. Écoutons Merleau-Ponty (1962, p. 57) :
Chaque institution est un système symbolique que le sujet s’incorpore comme style de fonctionnement, comme configuration globale, sans qu’il ait besoin de le concevoir.
Les ruptures d’équilibre, les réorganisations qui surviennent comportent, comme celles de la langue, une logique interne, quoiqu’elles ne soient, à l’occasion, clairement pensées par personne.
Écoutons Deleuze (2002, p. 27) :
Toute institution impose à notre corps, même sans ses structures involontaires, une série de modèles, et donne à notre intelligence un savoir, une possibilité de prévision comme de projet. Nous retrouvons la conclusion suivante : l’homme n’a pas d’instincts, il fait des institutions.
- Il y a donc, dans les institutions et dans les jeux institutionnels, quelque chose d’objectif.
Que doit-on entendre par ce terme ?
- D’abord, sans doute, l’idée que les institutions s’inscrivent dans les choses, dans les objets.
Comme on l’a vu, elles confèrent à ceux-ci leur identité – le stylo rouge du professeur dans une classe où celui-ci « corrige les copies en rouge » est ce qu’il est parce qu’il est pris dans le schéma institutionnel cohérent dont parle Douglas, parce qu’il est partie intégrante d’un style de pensée.
En retour, les objets portent, ils offrent, ils font affordance de l’institution – considérer le stylo rouge et son usage, c’est saisir et « faire fonctionner » un système d’institutions (celle de la classe, celle de la correction, et d’autres).
Mais cette inscription de l’institution dans les objets n’est possible que parce que c’est « l’esprit de l’institution » lui-même qui imprègne les actions des individus intégrant ces objets institutionnels.
L’esprit de l’institution, c’est l’esprit objectif, au sens hégélien du terme, ainsi que le montre Descombes.
Dans cette perspective, reprenant Aron (1991), Descombes (1996, p. 289) montre tout d’abord qu’il faut ainsi distinguer l’esprit objectivé de l’esprit objectif :
On voit que l’esprit objectivé correspond au fait que nous vivons dans un monde que d’autres ont habité avant nous (ces autres nous sont d’abord étrangers).
En revanche, l’esprit objectif est le contraire : ce n’est pas la trace des absents dans notre champ de perception, c’est la présence du social dans l’esprit de chacun.
Descombes, 1996, p. 289
- Mais quel est ce social ?
- Comment se manifeste-t-il ?
- Comment l’identifier dans les conduites humaines ?
Pour répondre à cette question, Descombes (1996, p. 297) emprunte à Aron (1976) un exemple – éclairant et signifiant pour mon propos ! – utilisé par celui-ci pour donner à voir la socialité de l’action quotidienne :
- « le professeur parle lentement et détache bien ses mots de façon à faciliter le travail des étudiants qui prennent des notes ».
On voit comment le « social », ici, est réduit à deux conditions :
- la condition de la présence des autres, et
- la condition des actions.
Il faut concevoir une vision du social plus complexe, nous dit Descombes :
« il manque encore quelque chose : la complémentarité des autres.
Dans l’exemple d’Aron, ce qui fait que le professeur a une activité sociale n’est pas d’abord qu’il tienne compte des élèves dans son élocution, mais qu’il soit en train d’enseigner.
Aussitôt, un système triadique se met en place : il donne une leçon à des élèves qui la reçoivent. Sans l’activité des élèves qui étudient une matière auprès du professeur, ce dernier peut bien parler clairement et distinctement, il n’enseigne pas.
Enseigner n’est pas quelque chose qu’on peut faire tout seul rien qu’en donnant à ses faits et gestes une intention dirigée vers autrui ».
Il faut saisir tout l’intérêt des lignes qui précèdent :
- voulant saisir l’essence d’un comportement qui « réunit » professeur et élève,
- Descombes commence en fait par signifier que cette essence renvoie au jeu qu’ils sont en train de jouer,
- le jeu didactique.
Il faut regarder au bon endroit, comprendre l’essentiel, et ne pas confondre une conséquence des nécessités de la pratique avec l’identification de sa logique.
Le professeur est en train d’enseigner, nous dit Descombes,
- et c’est la grammaire de ce jeu, ses nécessités, qui nous feront comprendre le comportement étudié.
Puis il exprime, d’une manière économe et frappante, la nécessité d’action conjointe propre au jeu didactique :
- on enseigne quelque chose à quelqu’un, la relation d’enseignement est une relation nécessairement triadique.
- Ici, finalement, comprendre ce que font le professeur et les élèves, relève de la saisie de l’esprit objectif qui se manifeste dans l’enseignement.
Ainsi que l’exprime Descombes :
Quiconque accomplit une action sociale manifeste à la fois un esprit subjectif (une capacité à l’action individuelle, un visée relevant du quant-à-soi) et un esprit objectif (une capacité, définie dans le système, à coordonner son action à celle d’un partenaire).
Le professeur peut présenter une idée qui lui est propre dans son enseignement et ainsi faire preuve d’originalité.
Mais cette enseignement, et quel qu’en soit le contenu, s’il a été donné, a dû être reçu : comme tel, il est la représentation d’un esprit objectif.
Descombes, 1996, p. 308
Fixons l’attention sur la définition de l’esprit objectif presque incidemment donnée ci-dessus par Descombes :
Ce que Descombes appelle système,
- c’est bien ce que j’appelle le jeu de l’action conjointe.
Une autre manière de dire, ici, que tout jeu contient en arrière-plan un voir-comme qui est aussi un ensemble de capacités.
Cette « présence du social dans l’esprit de chacun », c’est, pour une institution donnée, ce qu’on pourra appeler l’esprit de l’institution, et, pour un jeu institutionnel donné, l’esprit du jeu.
- La notion d’esprit objectif est précieuse, non seulement parce qu’elle permet de saisir ce qui constitue la substance du jeu (l’esprit du jeu),
- mais aussi parce qu’elle permet de produire une autre distinction, fondamentale pour mon propos,
- entre significations partagées et significations communes.
Les significations partagées correspondent « aux phénomènes de consensus entre des sujets indépendants » (Descombes, 1998, p. 291), par exemple certains jugements de goût, ou le fait de se trouver à voter aux élections pour le même candidat.
En revanche, les significations communes, elles, sont produites par l’esprit objectif – par exemple celui qui est inhérent à l’institution du vote, qui fait que sous une certaine description, ceux qui votent pour des candidats différents font la même chose, ils votent.
Descombes précise ainsi le sens des significations communes
Ces représentations communes ne sont pas des « points communs » que l’on découvrirait en regardant dans les têtes. Ce sont des significations instituées, qui sont non seulement publiques, mais aussi sociales.
Elles ne sont pas identiques par une sorte de coïncidence (qu’on pourrait expliquer par la similitude des conditions de vie et d’expérience).
Elles sont inculquées aux individus de façon à rendre possible de la part de chacun d’eux des conduites coordonnées et intelligibles du point de vue du groupe.
Descombes, 1998, p. 294
- Finalement, lier « institution » et « esprit objectif » permet de saisir les manifestations du sens, dans l’inculcation première et fondamentale qu’évoque Descombes.
Où que l’on se déplace dans le monde social, on trouve des institutions, qu’elles soient spirituelles, tournées vers soi (comme l’institution du journal intime) ou sociales (organiquement produites dans le commerce avec autrui).
Dire que l’on « trouve des institutions »,
- ce n’est pas verser dans l’essentialisme
- (les institutions ne sont pas des champignons, quoiqu’il y ait une institution de la cueillette des champignons),
- c’est reconnaître que le sens est institué,
- c’est reconnaître donc des/les institutions du sens
Pour comprendre l’autorité de l’esprit objectif sur les sujets,
- il convient de concevoir tout à fait autrement [que les philosophies individualistes] la fonction du sens institué (impersonnel) dans la formation
- et la communication des pensées.
La priorité de l’impersonnel sur le personnel n’est pas du tout comme la priorité du texte sur le lecteur ou sur le copiste. Elle est plutôt la priorité d’une règle sur l’activité qu’elle gouverne.
- Ce qui fait qu’un acte dont j’ai la libre initiative détermine logiquement votre réaction, quelle qu’elle soit, comme étant votre réponse à ma sollicitation,
- ce sont les usages établis là ou ces actes ont lieu.
Ces usages sont des institutions, au sens de Mauss :
ce sont des manière de faire et de penser dont les individus ne sont pas les auteurs. Les individus sont certainement les auteurs des phrases qu’ils construisent, mais ils ne sont pas les auteurs du sens de ces phrases, et c’est précisément ce qu’on veut dire en parlant d’une signification impersonnelle des énoncés.
- Mon interlocuteur a tort s’il n’a pas compris ce que j’ai dit dans le sens que ma phrase veut dire dans le contexte.
- Moi-même, j’ai tort si je prétends qu’il a été dit par moi autre chose que ce qui a été dit par ma phrase en vertu des usages établis
- (les conventions spéciales que nous avons pu passer entre nous pour chiffrer ou pour singulariser nos échanges ayant dû elles-mêmes être passées dans l’idiome commun).
Ces usages établis permettent de décider de ce qui a été dit, et donc de ce qui a été pensé, quand quelqu’un se fait entendre de quelqu’un. Ce sont donc bien des institutions du sens.
– Descombes, 1996, pp. 333-334
- « L’autorité de l’esprit objectif sur les sujets » peut donc se comprendre et s’apprécier lorsque l’enquête permet de déterminer les « usages établis », les institutions du sens, qui donnent sa forme et sa puissance à cet esprit objectif.
La posture grammaticale, que je tente de tenir dans ce livre ressortit à cette détermination :
comprendre un jeu institutionnel, c’est comprendre l’institution du sens dans ce jeu, et donc décrire les institutions du sens présentes dans ce jeu, qui, nous l’avons dit et nous le verrons, ne sauraient se limiter à ses règles constitutives.
- Il faut insister sur le fait que les jeux institutionnels, au sein des institutions, et eux-mêmes en tant qu’institutions, confrontent les joueurs à des situations – c’est-à-dire à des problèmes – caractérisées par l’incertitude sur l’action
- (là ou l’institution est une machine à prévision, une machine à éliminer l’incertitude)
- et par la rupture de l’équilibre institutionnel.
C’est cette opération de confrontation à des situations que j’ai simplement nommée « mise en situation ».
Les institutions didactiques, comme je l’ai signifié plus haut, constituent le lieu paradigmatique d’une telle tension entre certitude et incertitude, entre rigueur et faible déformabilité des cadres d’action institutionnels et des institutions du sens sur lesquels il reposent, et nouveauté certaine fois radicale apportée par la mise en situation.
Ce chapitre sera divisé en trois parties. Dans la première, je montre comment le jeu didactique se déploie dans l’institution didactique caractérisée par un certain type de contrat, issu de la matière même du fonctionnement institutionnel. Ce fonctionnement institutionnel s’établit dans un certain milieu, dans lequel les transactions didactiques prennent leur sens. La seconde partie du chapitre est dédiée à la caractérisation de la notion de milieu. Enfin, dans la troisième partie de l’article, j’utilise de nouveau la notion de style de pensée, cette fois pour donner forme à la conception de l’apprentissage qui traversera dès lors tout l’ouvrage.
1 – L’institution du jeu : le système stratégique du contrat
On peut décrire tout jeu didactique et toute institution didactique en décrivant le ou les contrats didactiques qui régissent les transactions.
Une description de ce qu’est le contrat didactique figure dans un célèbre texte de Brousseau, Le cas de Gaël , que je citerai un peu longuement. Cette citation ne correspond pas à la volonté d’un « retour aux sources » qui garantirait la pertinence, et encore moins à une sorte de filiation aveugle à un concept particulier. La raison de l’appui sur la notion de contrat didactique, telle qu’elle est explicitée par Brousseau dans les lignes qui suivent, tient avant tout à ce qu’elle me semble présenter une épistémologie pertinente de ce qu’est la relation didactique et de la manière dont on apprend au sein de cette relation didactique :
« Au cours d’une séance ayant pour objet l’enseignement à un élève d’une connaissance déterminée (situation didactique), l’élève interprète la situation qui lui est présentée, les questions qui lui sont posées, les informations qui lui sont fournies, les contraintes qui lui sont imposées, en fonction de ce que le maître reproduit, consciemment ou non, de façon répétitive dans sa pratique de l’enseignement. Nous nous intéressons plus particulièrement à ce qui, dans ces habitudes, est spécifique des connaissances enseignées : nous appelons “contrat didactique” l’ensemble des comportements (spécifiques) du maître qui sont attendus de l’élève et l’ensemble des comportements de l’élève qui sont attendus du maître.
…ce “contrat” régit les rapports du maître et de ‘l’élève au sujet des projets, des objectifs, des décisions, des actions et des évaluations didactiques. C’est lui qui, à chaque instant, précise les positions réciproques des participants au sujet de la tâche et précise la signification profonde de l’action en cours, de la formulation ou des explications fournies ; …
Il est la règle de décodage de l’activité didactique par laquelle passent les apprentissages scolaires. On peut penser qu’à chaque instant, les activités d’un enfant dans un processus dépendent du sens qu’il donne à la situation qui lui est proposée, et que ce sens dépend beaucoup du résultat des actions répétées du contrat didactique.
Le contrat didactique se présente donc comme la trace des exigences habituelles du maître (exigences plus ou moins clairement perçues) sur une situation particulière. Ce qui est habituel ou permanent s’articule plus ou moins bien avec ce qui est spécifique de la connaissance visée ; certains contrats didactiques favoriseraient le fonctionnement spécifique des connaissances à acquérir et d’autres non, et certains enfants liraient ou non les intentions didactiques du professeur et auraient ou non la possibilité d’en tirer une formation convenable ».
Brousseau, 2009, p. 35
Je voudrais attirer l’attention sur les points suivants, que l’étude de cette définition peut mettre en évidence.
- Une telle définition, on le voit, conçoit l’action didactique comme organiquement communicationnelle, fondée sur le processus « d’interprétation » que l’élève produit de la situation à travers la perception qui est la sienne des actes professoraux, et donc des systèmes de signes qu’ils impliquent.
Même si Brousseau ne mentionne pas explicitement, dans ce texte, les systèmes de signe qui donnent forme à ces actes, il présente bien le contrat comme « la règle de décodage ». On peut donc penser qu’interpréter une situation en fonction de ce que le maître reproduit de sa pratique, s’est s’engager/être engagé dans un processus sémiotique, sur l’arrière-plan de la « règle de décodage » qu’est le contrat. On peut lire ainsi cette définition comme la description d’un sémiose d’autrui dans le savoir spécifique aux transactions didactiques : sémiose d’autrui, par l’élève, du professeur dans la situation, de la situation à travers le professeur. Cette définition permet ainsi de situer les nécessités grammaticales que le modèle du jeu a mises en évidence, l’esprit du jeu, en tant qu’esprit objectif, pour les situer dans la progression, les aléas, et les succès de l’action conjointe entre le professeur et l’élève.
Elle place au centre de l’action didactique une dialectique profonde entre répétition/habitude (« ce que le maître reproduit, consciemment ou non, de façon répétitive dans sa pratique de l’enseignement ») et nouveauté/différence apportée par la situation hic et nunc en laquelle des potentialités de savoir sont incluses (« Ce qui est habituel ou permanent s’articule plus ou moins bien avec ce qui est spécifique de la connaissance visée »).
- Étudier le contrat didactique propre à un système de transactions, c’est donc mettre au jour cette dialectique particulière entre institution (les habitudes instituées qui me permettent d’assimiler la réalité autour de moi) et mise en situation (ce qui correspond à un déséquilibre dans cette réalité, à un « problème », et qui nécessite l’accommodation du contrat).
Dans une telle perspective, on peut concevoir le contrat didactique à la manière d’un système d’habitus : si l’habitus, comme nous l’explique Bourdieu (1992), résulte de « l’institution du social dans les corps », le contrat didactique peut se penser, dans son aspect « habituel et permanent », comme un habitus didactique. En particulier, il réfère non seulement à un système de représentations collectives, mais à l’action. Un habitus, le contrat didactique, ce sont des propensions à l’action, des propensions à une action précise sous certaines conditions. Le contrat didactique est un système de capacités.
Comme l’habitus, le contrat didactique est en grande partie à la fois implicite et non conscient. L’habitus didactique que représente le contrat va être plus ou moins mis en défaut avec la mise en situation didactique, la rencontre du « problème » que l’élève va devoir résoudre pour apprendre. Il est important de rappeler ici la valeur générique du terme « problème » dans mon exposé. Trouver mentalement, au Cours Préparatoire, combien il faut ajouter à 6 pour obtenir 10 est un problème. Écrire un mot sous la dictée est un problème. Continuer de manière plausible et cohérente la première partie d’une nouvelle de Mérimée est un problème. Résoudre une équation différentielle est un problème. Réparer un siège cassé est un problème. Marquer un but au hand-ball est un problème. Modéliser un processus physique au moyen d’une équation différentielle est un problème. Lacer ses souliers est un problème. Faire en sorte que ce rosier reprenne de la vigueur est un problème. Peindre un « tableau de Raphaël où l’on pourrait mesurer la distance entre le nez et la bouche » est un problème (pour Picasso, selon Baxandall (1991)). Pour chacun des exemples pris précédemment, on peut voir comment ce « problème » peut se concevoir comme une « situation agie », comme un jeu, avec un enjeu, une façon « raisonnable » et « raisonnablement partagée » de déterminer un gain (bien entendu différente pour chacune des institutions dans lesquelles se déploie le jeu), un investissement possible, des règles définitoires, des règles stratégiques, et des stratégies, des possibilités de « tricher », etc. Aucun de ces problèmes, particulièrement s’il est rencontré dans une institution didactique, ne sera abordé ex nihilo. C’est le contrat didactique inhérent à telle ou telle situation didactique qui déterminera la manière dont le problème sera traité. Le contrat didactique pourra ainsi se concevoir, à travers la règle de décodage qu’il représente, comme un système de règles d’usages liées au problème enjeu de l’activité.
La définition de Brousseau accorde à la notion d’attente une place centrale. On retrouve ici cette force fondamentale de l’institution, qui nous donne une capacité de prévision dans le monde, en particulier dans ce que nous pouvons savoir du comportement probable d’autrui.
On perçoit alors la consonance d’une telle définition (à la différence de certaines définitions plus récentes données par Brousseau) avec la conception de l’attente sise au cœur même des activités sociales selon Mauss. Celui-ci, en 1934, réagit à un exposé de François Simiand à la Société française de philosophie. Simiand vient d’exposer ses recherches sur la monnaie en tant que « réalité sociale », et Marcel Mauss produit l’observation suivante :
« Car c’est cela au fond ce à quoi nous arrivons, vous et moi, c’est à l’importance de la notion d’attente, qui est précisément l’une des formes de la pensée collective. Nous sommes entre nous, en société, pour nous attendre entre nous à tel ou tel résultat ; c’est cela la forme essentielle de la communauté. Les expressions : contrainte, force, autorité, nous avons pu les utiliser autrefois, et elles ont leur valeur, mais cette notion de l’attente collective est à mon avis l’une des notions fondamentales sur lesquelles nous devons travailler. Je ne connais pas d’autre notion génératrice de droit et d’économie : « Je m’attends », c’est la définition même de tout acte de nature collective… ».
Mauss, 1969, p. 117
Dans cette perspective, le contrat didactique propre au jeu didactique peut alors se concevoir comme un système d’habitudes engendrant lui-même un système d’attentes, systèmes actualisés pour tel jeu particulier. On prendra note de la complexité de ces attentes. De par la nature même des transactions didactiques, le contrat didactique est destiné à être rompu, puisqu’une institution didactique, on l’a vu, est essentiellement une institution dans laquelle une bonne partie des habitudes sont « condamnées » à disparaître ou à être largement modifiées, avec l’avancée des savoirs. Dans les attentes de l’élève, il y a donc une incertitude foncière quant aux comportements du professeur.
Système d’habitudes, système de règles d’usage, système d’attentes, le contrat didactique peut aussi se décrire comme un système de normes. Si, suivant P. Livet (2006, p. 49) on se convainc que « les normes se distinguent des règles en ce qu’elles sont chargées de trancher des conflits entre règles » on appréhendera la force normative du contrat. Alors que la règle de type wittgensteinien, immanente à un usage (et à un jeu, dans la conceptualisation que j’en propose), « guide ou inspire » cet usage, la norme « est chargée de régler le conflit entre deux manières au moins de mettre cet usage en activité » (Livet, 2006, p. 49). Le contrat didactique constitue donc un système de normes, dans la mesure où « les actions répétées du contrat didactique » prennent le statut de choses que l’on doit faire, sous peine de « sanction ». Certaines de ces normes, pour la plupart génériques, peuvent perdurer, d’autres, pour la plupart spécifiques du savoir, devant être redéfinies en fonction de l’avancée du savoir.
L’étude du contrat didactique gagne à s’effectuer au sein de la grammaire de l’action dont j’ai commencé de brosser plus haut quelques aspects fondamentaux. L’implicite du contrat didactique tient à la nature même du jeu didactique :
- si le contrat didactique est en grande partie implicite, c’est précisément parce que le dialogue didactique repose sur les nécessités de réticence et de valeur perlocutoire des énoncés.
On perçoit alors comment, dans le jeu didactique, la production, par le joueur A, des stratégies gagnantes, passe par cette interprétation constante des comportements du joueur B. A (l’élève) sait (plus ou moins consciemment et clairement) qu’il va trouver dans les comportements de B (le professeur) de quoi gagner au jeu, et il sait aussi que pour qu’il puisse gagner au jeu, B doit respecter certaines règles de réticence tout en produisant des énoncés qui vont l’engager, lui, élève, à agir. L’élève, d’une certaine façon, sait qu’il doit donc consentir à être « laissé à lui-même ».
- Il est par ailleurs important de noter, tout en gardant à l’esprit l’implicite fondamental du contrat, la nécessité d’élucidation de la relation entre explicite et implicite.
- Une partie du contrat didactique est nécessairement explicite.
- Même s’il faut se garder de « prendre au pied de la lettre » l’expression de contrat, on ne peut minorer la part de ce qui est dit au sein des transactions didactiques si l’on veut en comprendre l’économie (je reviendrai longuement sur ce point décisif).
Le contrat didactique, pour un savoir et une institution donnée, exprime les significations communes de l’institution. En déterminant un système d’institutions du sens, il permet de saisir l’esprit objectif de l’institution didactique.
Dans les lignes qui précèdent, j’ai présenté alternativement le contrat didactique comme un système de règles, d’attentes, de normes, comme un système de capacités.
- Il est important de saisir qu’il ne s’agit pas ici de différentes entités conceptuellement constitutives du contrat, mais de différentes descriptions possibles des mêmes entités pratiques.
Prenons l’exemple, dans une classe de l’école élémentaire, de l’analyse grammaticale d’une phrase. Activant le contrat didactique de la classe pour ce savoir, les élèves cherchent d’abord quel est le verbe dans la phrase, en identifiant, parmi les mots de cette phrase, lequel peut se conjuguer. Cette pratique (je cherche dans la phrase le verbe en identifiant le(s) mot(s) pouvant être conjugué(s)) peut-être vue à la fois :
- comme une habitude de travail, sédimentée dans de multiples répétitions ;
- comme une règle d’usage, qui permet de « jouer le jeu grammatical », qui, selon les cas, aura le statut de règle définitoire, ou de règle stratégique ;
- comme une attente professorale qui constituera donc aussi une attribution d’attente pour l’élève (si le professeur me donne cette phrase lors d’une activité de grammaire, il attend de moi que…) ;
- comme une norme, qu’un élève pourrait opposer à l’un de ses camarades qui lui dirait avoir trouvé le verbe d’une autre manière, ou avoir produit l’analyse de cette phrase sans commencer par l’identification du verbe, et qui pourrait appeler à une sanction en cas d’infraction ;
- comme une capacité, constituée par un système de savoir-faire, de savoir-comment, de capacités d’échelle plus réduite (par exemple, savoir reconnaître que l’adjectif « présente » dans une phrase n’est pas une forme du verbe « présenter »).
Dans la définition de Brousseau, celui-ci présente le contrat comme relatif à ce qui est « spécifique de la connaissance visée ». Je pense qu’une telle conception est restrictive. Je pose plutôt que le contrat réfère à des pratiques qu’on peut déployer sur un axe générique/spécifique.
- Ainsi, la pratique qui consiste à « lever le doigt pour prendre la parole », en tant qu’elle peut influer sur la production du savoir dans l’institution, sera considéré comme un élément générique du contrat didactique.
- S’y prendre « de telle manière précise pour résoudre tel problème » sera une norme (plus ou moins) spécifique du contrat.
La notion de contrat didactique est ainsi essentielle au processus de description des transactions didactiques :
- elle fait comprendre le poids des habitudes d’action, à la fois implicites et non conscientes, dans leur formation, et incite donc à considérer des habitudes de transaction ;
- elle fait comprendre comment les transactions didactiques reposent sur les attentes, de l’élève vers le professeur, du professeur vers l’élève, et, corrélativement, sur des attributions d’attentes (l’élève agit comme si le professeur s’attendait à ceci et à cela), ces attentes et attributions d’attentes reposant pour l’essentiel dans l’implicite ;
- elle fournit un cadre à l’étude génétique de la constitution des normes et de la normativité au sein de l’institution didactique, et à la manière dont ces normes ont à être dépassées ou redéfinies dans la dialectique de l’ancien et du nouveau ;
- elle permet de comprendre comment le jeu didactique, tel qu’il est spécifié pour tel ou tel savoir, se déploie sur l’arrière-plan du contrat didactique spécifique à ce savoir.
- Cet arrière-plan est donné par les significations communes dans l’institution didactique qui structurent l’esprit objectif de l’institution en lui fournissant un système d’institutions du sens.
Si l’on veut comprendre les comportements du professeur et des élèves, la manière dont ils vont activer une stratégie donnée pour enseigner ou pour apprendre, il est nécessaire, pour le chercheur, de reconstituer ce contrat didactique.
Dans une telle perspective, il est utile de gagner une autre conception du contrat didactique, sur laquelle je vais élaborer dans ce qui suit.
Le contrat didactique propre à un savoir donné, dans un jeu didactique spécifique à ce savoir, constitue le système stratégique disponible au moyen duquel le professeur et les élèves vont jouer ce jeu.
C’est en cela, je crois, que réside le caractère décisif de la notion de contrat didactique telle que Brousseau (1999) nous l’a apportée.
Le contrat didactique, loin de n’être qu’une forme d’influence plus ou moins périphérique au processus didactique, est un système stratégique, et on pourrait dire le système stratégique déjà-là au moyen duquel Professeur et l’Élève jouent un jeu didactique spécifique.
L’être du contrat, pour se situer dans l’ontologique, c’est bien une potentialité d’action réglée, un système de capacités, qu’on peut découvrir comme tels lorsqu’il y a rupture.
Travaillons les assertions qui précèdent sur un exemple. J’utiliserai pour cela le « célèbre » problème de l’âge du capitaine.
On demande aux élèves de résoudre un problème absurde, du type « Sur un bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres, quel est l’âge du capitaine ? ». Ce type de problème, posé au début des années 1980 au sein de classes de divers niveaux (du CE2 à la cinquième), était massivement échoué, une très grande partie des élèves fournissant des réponses, plausibles (par exemple 36 ans pour l’âge du berger ci-dessus) ou impossibles (par exemple 260 ans pour l’âge du berger ci-dessus).
Cet exemple nous fait comprendre ce qu’est le contrat didactique. Chaque fois que les élèves ont eu à « résoudre un problème de mathématique » (avant de rencontrer celui de l’âge du capitaine) ils ont mis en œuvre un certain système de règles d’usages, qui peuvent être considérées comme issues d’« actions répétées du contrat ».
Ils ont eu à donner une réponse.
Pour produire cette réponse, ils ont eu à utiliser les nombres fournis dans l’énoncé du problème.
Ces nombres ont été « associés », en général grâce à la dernière « opération arithmétique » étudiée, les problèmes jusqu’ici résolus étant souvent des applications de cette opération.
On voit bien que de telles règles d’usage, qui délimitent de manière « syntaxique » le jeu du problème d’arithmétique, sont devenues des habitudes d’action, qui structurent la perception, et produisent un voir-comme spécifique : dans le problème, voir le nombre de moutons et le nombre de chèvres non comme des nombres dénotant une réalité concrète qui joue un rôle spécifique, mais comme des signes qu’il faut soumettre à un certain traitement donné par la règle d’usage.
- Ces habitudes sont aussi des normes, qui renvoient à ce que quelqu’un doit faire lorsqu’il est confronté à un problème.
Dans une étude séminale, Schubauer-Leoni et Ntamakiliro (1995) décrivent ainsi le cas d’un élève qui, après qu’on lui a dit que d’autres élèves dans la classe ont trouvé un tel problème « bizarre », s’autorise à critiquer la réponse absurde qu’il avait initialement apportée. Finalement, l’esprit objectif du jeu du problème, tel que je l’ai esquissé ci-dessus, s’impose aux élèves et dirige leur action.
Si l’on simulait le raisonnement des élèves en première personne, on pourrait obtenir quelque explicitation de ce genre :
- « le professeur m’a donné un problème à résoudre, il attend de moi que je me conduise de la même manière que d’habitude lorsqu’il me donne un problème à résoudre, donc je dois fournir une solution, en travaillant de la même manière que d’habitude ».
Cet ensemble discursif s’énacte dans une capacité.
Il faut comprendre ici que le contrat didactique est très fortement implicite. Jamais, dans aucune des classes étudiées, le professeur n’a explicité comme telles les règles d’usage utilisées par les élèves.
C’est ainsi que le contrat didactique apparaît comme un arrière-plan, qui implique, on l’a vu, un voir-comme spécifique, ce voir-comme étant porteur de capacités – ici, de capacités calculatoires.
À cet arrière-plan s’attache un système stratégique, très largement syntaxique, quasi algorithmique dans ce cas, dont le système des règles d’usage mentionné ci-dessus fournit une première description.
À la résolution de problèmes est donc attaché un style de pensée.
- Comme tout style de pensée, il suppose la reconnaissance de forme (le voir-comme) dont il faut saisir à la fois les propriétés « positives » et « négatives. »
Fleck peut ainsi déclarer :
« La perception visuelle directe d’une forme (gestalt) demande d’être expérimentée dans un domaine de pensée particulier : ce n’est qu’après de nombreuses expériences, éventuellement après avoir reçu une formation, que l’on acquiert la capacité de remarquer directement des sens, des formes, et des unités fermées sur elles-mêmes ».
Après cette caractérisation « positive » du style de pensée, Fleck poursuit avec cette remarque importante :
« Il est vrai que dans le même temps on perd la capacité de voir ce qui est en contradiction avec ces formes ».
Fleck, 2005 p. 161
C’est ce qui arrive aux élèves confrontés au problème absurde :
- les élèves sont dans le contrat, c’est-à-dire qu’ils jouent le jeu (du problème absurde) comme les amène à le faire le système stratégique qu’ils ont produit dans la fréquentation didactique des problèmes, sans voir ce qui peut contredire les formes qu’ils projettent sur la transaction.
- Ils assimilent ainsi indûment le problème absurde aux problèmes anciens.
L’institution confère aux choses leur identité, pour reprendre l’idée de Douglas (1999), ce qui peut supposer dans certains cas une « similitude » non avérée. Dans les problèmes du type de « l’âge du capitaine », le pouvoir assimilateur du contrat est trop fort.
L’apport de la notion, une fois qu’on a bien saisi son ontologie, son être stratégique, devient fondamental parce qu’il est génétique :
- en nous donnant la notion de contrat, Brousseau nous fait comprendre la genèse de l’action didactique.
Le contrat est né de l’action conjointe, il est né des signes qu’ont constitués, pour les élèves, les actions répétées (en particulier celles du professeur) au sein des situations didactiques. La sémiose d’autrui propre à l’action conjointe institue des habitudes, elle institue autrui en pourvoyeurs de signes.
- Mais ce déchiffrement ne se fait jamais ex nihilo.
- Il s’établit dans un style de pensée qui cristallise l’esprit objectif du jeu.
- Au sein du jeu didactique, dans le processus de sémiose du professeur, l’élève attribue des attentes au professeur, en suivant l’esprit du jeu (« si le professeur me donne ce problème, c’est pour que je montre que je sais résoudre ce problème, ce qui veut dire trouver une solution, utiliser les nombres, etc. ») et agit en fonction de ces attentes.
L’action didactique conjointe répond aux nécessités du jeu didactique, telles que j’en ai esquissé au chapitre précédent une première grammaire, mais il faut penser cette grammaire dans la sémiose spécifique au contrat didactique.
Celle-ci devra se penser en particulier, pour l’Élève, dans des attributions d’attente, qu’on pourrait « reconstituer » sous la forme propositionnelle suivante :
« au sein du contrat, le Professeur s’attend à ».
La sémiose d’autrui épousera alors la forme logique suivante, du côté de l’Élève :
- si/quand le professeur fait X, c’est dans l’attente que je fasse Y, et ainsi de suite.
L’ensemble constitue ainsi une structure première du comportement didactique. L’apport fondamental, au plan d’une génétique de l’action, du concept de contrat, dans la notion « maussienne » d’attente, et plus encore dans celle d’attribution d’attente, réside selon moi en ceci : il faut voir l’attente et l’attribution d’attente comme condition de possibilité et conséquence de l’action conjointe.
Notons enfin un dernier aspect : l’exemple précédent nous fait bien saisir que le contrat didactique ne saurait se limiter au hic et nunc des transactions professeur-élève.
- Dans le cas de « L’âge du capitaine », il se peut très bien que le professeur ne produise aucun comportement, il peut même ne pas être là.
- Ce qui « déclenche » le système stratégique du contrat, c’est le seul énoncé du problème.
- On voit bien qu’on peut donc distinguer deux composantes dans le contrat.
- Une composante épistémique, qui correspond au système de savoirs et de connaissances avec lesquelles l’élève traite le problème.
- Une composante transactionnelle, qui réfère aux comportements du professeur produits en vue d’orienter l’élève dans telle ou telle direction d’action.
- On saisit bien que les deux composantes sont organiquement solidaires, puisque dans le jour après jour du travail didactique les orientations transactionnelles du professeur vont façonner l’action conjointe dont la composante épistémique est le produit. Mais la composante épistémique du contrat peut se déclencher, tel l’habitus que Bourdieu (1992) compare à un ressort, si la situation l’appelle (à tort ou à raison, dans le cas de l’Âge du capitaine, c’est à tort).
Pour avancer dans l’élaboration, j’en viens maintenant à la notion de milieu, qui va entrer en dialectique avec celle de contrat.
2 – Le jeu en situation : le système stratégique du milieu
Dans cette section, je vais d’abord produire une petite étude quasi empirique, pour désigner certains enjeux fondamentaux sous-jacents à la question du milieu. Puis j’aborderai la notion d’adidacticité, que je lie à la notion de milieu.
On pourra commencer de lire les pages qui suivent en entendant le terme milieu dans le sens d’« environnement de l’action » ; ce sens sera précisé au fur et à mesure de la lecture.
[…]
Ce qui précède montre bien qu’un milieu donné est propre à une œuvre, notion qu’on peut généraliser, en suivant à la fois Meyerson (1995) et Chevallard (2008), à toute production de l’ingéniosité humaine :
- un livre est une œuvre, mais aussi un jardin, ou une rencontre sportive, ou le travail du paludier.
Lorsque l’élève entre dans ce milieu, il n’y entre jamais directement, il n’en éprouve jamais directement la cohérence et la pertinence. Son apprentissage se ramène alors à la construction d’un système stratégique qui lui permet d’entrer dans ce milieu, d’y agir avec pertinence.
- L’élève qui entre dans le milieu peut être conçu comme une instance, un Élève.
Cela signifie que le style de pensée propre à « un produit d’une création de l’esprit », pour reprendre Fleck, n’est jamais également disponible à tous les élèves.
Certains élèves peuvent être mis hors-jeu dès les premiers moments de l’activité didactique, parce que les expériences didactiques spécifiques de tel ou tel style ne pourront leur être disponibles.
- Apprendre, donc, c’est entrer dans un style de pensée,
- c’est éprouver sa cohérence, c’est faire l’expérience de ces relations « qui ne peuvent absolument pas être autrement » dès lors qu’on a accédé à la logique inhérente de l’œuvre.
Comme je l’ai précisé ci-dessus, la question de l’adidacticité n’est donc pas seulement, n’est même pas d’abord, celle de la nature des transactions entre le Professeur et l’Élève.
Elle est avant tout celle de la manière dont le Professeur, à travers l’enseignement qu’il prodigue, va permettre aux élèves de rencontrer la grammaire spécifique des œuvres desquelles ils doivent s’instruire, va permettre aux élèves une certaine expérience de l’apodictique.
- Le travail professoral sur et dans le milieu ne saura échapper au contrat didactique, en tant que système stratégique initial, au moyen duquel l’Élève abordera les œuvres.
- D’une manière très générale, on pourra ainsi considérer toute transaction didactique selon la description du contrat didactique et du milieu au sein desquels elle s’insère.
Je propose maintenant un court résumé de ce chapitre. »
– Sensevy, G. (2011). Chapitre 3. Jeu didactique, institution, situation. Dans : , G. Sensevy, Le sens du savoir: Éléments pour une théorie de l’action conjointe en didactique (pp. 89-120). De Boeck Supérieur.

« […]
Le savoir n’est pas le résultat d’un « jeu de sésame », auquel on gagne si l’on a bien répété une information transmise.
Cette ontologie propre au jeu didactique, qu’expriment les nécessités dont j’ai essayé de rendre compte, tient à l’ontologie même du savoir. Elle tient à la nature capacitaire du savoir, et au lien spécifique que les capacités produites entretiennent au langage des raisons, qui me font produire, après d’autres et avec d’autres, cette hypothèse selon laquelle le savoir suppose organiquement l’enseignement et l’apprentissage.
Cette ontologie s’actualise dans la grammaire du jeu didactique dont j’ai décrit des éléments selon moi fondamentaux.
Le Professeur joue en seconde personne, l’Élève en première personne. Les transactions sont fondées sur la réticence et la clause proprio motu.
- Le jeu nécessite la dévolution et l’institutionnalisation.
- La nature des instances du jeu détermine en partie le jeu.
Une institution didactique – où l’on enseigne et où l’on apprend – constitue un équilibre spécifique entre la certitude du savoir ancien et l’incertitude du savoir nouveau.
Le construit théorique qui permet de rendre compte de cet équilibre est le doublet système contrat/système milieu, qui fait apprécier l’adidacticité des transactions.
Le processus didactique lui-même, j’ai commencé de le montrer, peut ainsi se concevoir comme un jeu transactionnel, fondé sur l’ajustement mutuel dans la sémiose d’autrui qu’on peut penser au principe de l’action humaine.
J’ai considéré plus haut que cet ajustement se fait dans le savoir, dans la matérialité à la fois objectale et transactionnelle du savoir. Le savoir est en effet disposé dans des systèmes sémiotiques (matérialité objectale) et il est incarné dans l’action conjointe (matérialité transactionnelle) :
- sa production repose sur les relations systématiques établies entre ces deux types de matérialité.
Puisque les systèmes sémiotiques prédéterminent des formes d’action conjointe, et que l’action conjointe reconfigure la sémioticité des systèmes sémiotiques, systèmes sémiotiques et action conjointe se redéfinissent donc mutuellement, le produit de cette redéfinition étant le savoir lui-même, le savoir tel qu’il est effectivement façonné dans l’institution didactique.
[…]
On prendra donc particulièrement conscience, avec cet exemple, que le jeu didactique est conçu comme une sorte de progression d’un système de jeux d’apprentissage, producteurs de capacités spécifiques émergentes (jeu épistémique émergent), référées (par l’observateur ou par le Professeur) à un jeu épistémique source. Ainsi, la compréhension du jeu didactique joué va reposer sur la compréhension de la manière dont ce processus va s’accomplir. Cette compréhension sera elle-même avant tout tributaire de l’intelligibilité qu’on pourra produire des enjeux épistémiques qui conditionnent, de façon plus ou moins lointaine et plus ou moins consciente, l’action didactique conjointe.
[…] »
– Sensevy, G. (2011). Chapitre 4. Jeux d’apprentissage et jeux epistémiques. Dans : , G. Sensevy, Le sens du savoir: Éléments pour une théorie de l’action conjointe en didactique (pp. 121-177). De Boeck Supérieur.

« L’autonomie est devenue aujourd’hui une injonction sociale.
- Nous sommes tous censés être autonomes dans un nombre croissant de secteurs de notre vie au point qu’il est difficile d’en trouver qui échappent à cette exigence. Il n’est donc pas étonnant que l’éducation valorise l’autonomie.
Comme l’a relevé D. Glasman :
tout se passe comme si l’idée d’autonomie était aujourd’hui à ce point prégnante et structurante que toute l’éducation pouvait, par une voie ou par une autre, y être amarrée.
En d’autres temps, il en aurait sans doute été de même de l’ambition de fabriquer un enfant « bien élevé », c’est-à-dire s’intégrant harmonieusement dans une société « en ordre » où il ne lui restait plus qu’à prendre la place qui lui revenait de par sa naissance.
Orientée vers l’objectif de l’autonomie, c’est toute l’éducation qui cherche à mettre l’enfant et l’adolescent en mesure de construire plus tard sa place dans un monde qui a perdu ses certitudes.
Il vaut la peine de s’interroger sur cette omniprésence. D’où vient-elle ? Que signifie-t-elle ? Quelles conséquences a-t-elle pour l’éducation ?
- Selon le langage ordinaire, l’autonomie désigne principalement la capacité d’agir par soi-même, autrement dit d’agir sans avoir besoin des autres.
Être autonome, ce serait donc ne pas être dépendant ?
On verra plus loin que les choses sont plus compliquées. Cette première forme d’autonomie que l’on peut appeler pragmatique est répandue dans la vie sociale et doit donc être promue à ce titre. Elle peut cependant se réduire à une simple autonomie d’exécution. C’est le cas quand elle prend place dans un programme fixé par d’autres, par exemple dans les entreprises. Il en va aussi des élèves qui organisent eux-mêmes leur travail scolaire.
Cette limitation désigne donc en creux une forme plus haute d’autonomie qui porte non seulement sur l’agencement des moyens mais aussi sur la détermination des buts :
- on peut appeler cette seconde forme, autonomie morale ou capacité de choisir par soi-même.
En son sens le plus haut, cette autonomie est la capacité d’imaginer et d’agir en vue de la réalisation d’une forme de vie désirable, forme de vie qu’Aristote désigne par l’expression de la « vie bonne ». Toute personne fait des choix qui lui semblent désirables. L’autonomie se joue dans la façon dont ces choix ont lieu.
Autonomie et rationalité
Agir et choisir de façon autonome implique un usage de la raison. Cet usage est l’héritage que la présente analyse retient de Kant qui, plus que tout autre, a placé l’autonomie au centre de sa philosophie.
Que signifie le lien entre raison et autonomie ?
- Il semble que pour répondre à cette question aujourd’hui, il soit utile d’opérer un déplacement de la raisonnabilité (kantienne) à l’idée de rationalité.
- Cette idée insiste sur diverses façons de lier des représentations ; par exemple pour élaborer un projet, effectuer une opération arithmétique, construire une phrase correcte ou enchaîner des arguments dans une discussion.
- Elle renvoie au respect des normes inhérentes à un domaine d’activités et, par suite, à l’idée de résistance à l’examen, autrement dit de réflexion critique.
Comme l’écrit A. Sen, sont rationnelles les assertions « que nous pouvons maintenir de façon réfléchie si nous les soumettons à un examen critique ».
- Cette caractéristique implique le maintien d’une différence entre autonomie et indépendance.
L’indépendance n’est qu’un état négatif ; c’est le fait de ne pas être dépendant, ne pas être lié à quelque chose ou à quelqu’un.
L’autonomie implique la présence d’une réflexion (même minimale, voire incorporée, par exemple dans un enchaînement corporel).
Autonomie et socialisation
La domination actuelle d’une idéologie individualiste selon laquelle les personnes sont et doivent être maîtresses de leur sort ne saurait cependant conduire à ignorer l’ensemble de nos dépendances, tout ce qui donne forme à nos vies sans que nous le choisissions d’une façon ou d’une autre : l’identité sexuée, l’époque et le lieu de notre existence, la culture, la langue, l’inconscient, l’appartenance sociale, etc. : tout ce qui nous dépossède de nous-même et permet de contester cette idéologie en prétendant montrer son caractère illusoire ; en contestant, autrement dit, la pertinence de phrases du type : “c’est moi qui…” choisis ou agis.
- Que répondre à cette objection ?
- Est-il possible à la fois de lui faire droit sans pour autant condamner l’autonomie à être une simple illusion ?
Il ne s’agit pas de nier la réalité de ce qui nous déborde. L’éducation sert de preuve sur ce point. Chaque personne est inscrite dans un cadre qui la précède et la construit, sans que nul choix n’intervienne. Il y a donc une passivité fondamentale de toute existence humaine.
Elle concerne notre identité sexuée, notre condition historique, géographique, sociale et une grande part de notre vie affective, de nos idées, de nos croyances, de nos pratiques sociales et culturelles, de nos désirs et préférences.
Cette passivité conduit à insister sur l’articulation entre autonomie et socialisation. Opposer autonomie et socialisation, comme on pourrait être tenté de le faire, n’a pas de sens.
- L’inscription sociale de chaque personne est un fait, caractéristique de la condition humaine.
- Nous sommes tels ou tels, en relation avec d’autres, façonnés par ces relations et par toutes les dimensions caractéristiques de notre “socialité”, en particulier le langage et la culture.
De ce point de vue, l’idée d’une autonomie conçue comme une sorte d’absolu est aussi absurde que l’idée d’une personne humaine hors de toute société.
- On ne confondra donc pas autonomie et autosuffisance, ou encore autonomie et transparence à soi – d’où proviennent nos opinions ?
- D’où proviennent nos choix ?
L’autonomie ne saurait être une simple injonction à « être soi », hors de toute socialisation.
- D’un autre côté, la socialité ne signifie pas que l’autonomie serait illusoire.
- La socialité est un fait ; l’autonomie est une façon d’agir, de penser et de choisir.
- Nos appartenances sociales et les formes de dépendance qui vont avec n’annulent pas l’existence d’un sujet des actions, des choix et des pensées.
Pour le dire dans le vocabulaire au moyen duquel G.H. Mead a analysé la constitution du « soi » (self) : s’il est vrai que le « moi » (me) est socialement construit, le soi se compose aussi de ce que le « je » (I) répond au moi.
Ou encore, dans le vocabulaire moral d’H. Frankfurt, si nos volitions de premier degré souvent ne sont pas les nôtres, nous avons aussi des volitions sur nos volitions, des volitions de second degré, issues d’une réflexion sur nous-mêmes et ce qui nous meut. Ce n’est pas comme simple moi ou simple sujet des volitions de premier degré que nous pouvons être dits autonomes.
L’autonomie n’est pas une donnée immédiate de l’existence, mais le résultat d’un devenir. Elle se joue dans ce que “je” fais de ce matériau socialement constitué qu’est le “moi”. Elle se joue dans ce que “je” fais de ce que l’on a fait de “moi”.
- La passivité n’est donc pas nécessairement l’autre de l’autonomie ;
- l’autonomie n’est pas nécessairement le contraire de la dépendance.
- Parfois oui ; parfois non.
- Parfois, ce qui nous arrive, ce que nous recevons sans l’avoir choisi, nous aide à devenir autonomes.
Par exemple, l’amour parental ; ou encore les connaissances et compétences intellectuelles transmises à l’école.
Dans ces cas, le devenir autonome dépend de notre capacité à convertir une dépendance en ressources pour agir, choisir ou penser.
Mais l’exemple de l’amour parental peut aussi parler en sens contraire. Dans ce cas, il devient un poids avec lequel certains se débattront longtemps, parfois leur vie entière.
Dans tous les cas, l’autonomie dépend de la socialisation comme ensemble des acquisitions issues des interactions qui accompagnent le devenir humain.
Dire qu’autonomie et socialisation sont inséparables, c’est dire que les conditions et pratiques éducatives et sociales dans lesquelles nous sommes pris produisent à chaque fois une certaine façon singulière d’être autonome.
L’autonomie de chacun a le même visage que celui de son vécu de socialisation.
Les conditions de l’autonomie sont aussi politiques
Le lien entre autonomie et socialisation a une seconde conséquence :
- l’autonomie ne qualifie pas des personnes séparées des autres, libres de tout attachement.
- Le développement de l’autonomie ne suppose pas des individus livrés à eux-mêmes.
- Il dépend aussi de l’existence de conditions sociales et politiques favorables.
L’autonomie doit pouvoir s’appuyer sur le monde. L’autonomie pragmatique n’est pas l’autosuffisance.
Par exemple, une voiture est un facteur d’autonomie à la condition qu’il y ait des routes, des garages approvisionnés en essence, des mécaniciens pour entretenir et réparer les moteurs et un code de la route qui fait que la conduite automobile ne relève pas de la loi de la jungle.
Comme le note M.C. Nussbaum :
les diverses libertés de choix possèdent des conditions matérielles préalables, en l’absence desquelles il n’y a qu’un simulacre de choix […].
La liberté, ce n’est pas juste avoir des droits sur le papier ; elle exige qu’on soit en position d’exercer ces droits. Et cela exige des ressources matérielles et institutionnelles.
Dans le vocabulaire de Sen et Nussbaum,
on définira donc l’autonomie comme une capabilité, en entendant par là, non un simple ensemble de capacités individuelles développées par l’éducation et la pratique (les capabilités internes), mais l’ensemble constitué par ces capacités et les conditions sociales, politiques et économiques qui rendent possible leur exercice.
Pour Nussbaum, cette conception implique un État interventionniste, à l’opposé du néo-libéralisme et de la figure de l’« entrepreneur de soi-même » :
la bonne manière de protéger la liberté humaine consiste à créer les conditions dans lesquelles toutes sortes d’individus sont capables de faire de nombreux choix, tout en jouissant d’une sécurité suffisante de la part de la société.
Autonomie et but de l’éducation
Dans la vie sociale et morale, l’autonomie apparaît dans les périodes de crise des traditions, en particulier religieuses, les périodes d’affaiblissement de l’emprise des traditions sur les personnes. Elle n’est donc pas la marque d’une victoire et d’un progrès de l’histoire, mais plutôt celle d’une perte : perte des formes de vie collective dans lesquelles les « trésors de la tradition » donnaient aux gens des indications fortes sur la façon dont ils devaient conduire leur vie. Quand cet horizon s’efface, les personnes se retrouvent livrées à elles-mêmes et condamnées à faire preuve d’autonomie.
Du point de vue éducatif, dès lors qu’il n’y a plus de consensus sur le but de l’éducation, l’autonomie en devient une finalité nécessaire.
Elle n’est pas nécessairement son but le plus élevé – certains peuvent lui en préférer d’autres, par exemple des buts religieux – mais elle est son but le plus large, un but qui vaut pour tous. L’autonomie est un but nécessaire de l’éducation pour toute société qui comme la nôtre ne parvient pas à réunir un consensus sur les buts de l’éducation.
On retrouve donc d’une autre façon le lien entre autonomie et choix.
- « Il y a une grande différence », écrit Nussbaum, « entre pousser les gens dans un fonctionnement selon vos critères et leur laisser le choix » .
Être autonome, c’est pouvoir choisir.
- Cette affirmation banale a pour conséquence d’invalider les conceptions que j’appellerai « compréhensives », qui élisent un domaine de la vie censé s’imposer à tous en étant soustrait à l’éventail des choix.
Ces conceptions mettent certes l’autonomie en avant, mais une autonomie limitée puisqu’elles prétendent nous imposer un choix préalablement à l’exercice de notre capacité de choisir.
C’est le cas :
- de l’autonomie néo-libérale déjà mentionnée (celle de l’auto-entrepreneur de soi-même) qui défend le pouvoir de choisir des agents économiques tout en affirmant la priorité de l’activité économique de telle sorte que cette activité est soustraite à l’éventail des choix ;
- de l’autonomie du citoyen dans la mesure où elle prétendrait imposer une priorité du politique qui ne fait pas l’objet d’un choix ;
- de ce que j’appellerai une « autonomie pédagogique », défendue par exemple par M.-A. Hoffmans-Gosset , pour qui l’autonomie comprise comme épanouissement des personnes est dépendante de la conception d’une communauté socio-politique égalitaire et solidaire, dont la priorité est elle aussi soustraite à l’éventail des choix.
Contre ces conceptions compréhensives, l’autonomie doit être défendue d’abord comme un pouvoir de hiérarchiser les domaines de choix : vie économique, vie morale, vie politique mais aussi affective, culturelle, religieuse, sociale, etc.
- C’est ce qu’indique la notion de « raison pratique » définie comme capacité « de se former une conception du bien et de participer à une réflexion critique sur l’organisation de sa propre vie » .
Cette conception est compatible, notamment avec l’engagement des personnes dans des formes de vie non autonomes, par exemple militaires ou monacales ; ou avec des formes culturelles dans lesquelles l’autonomie n’apparaît pas comme étant une priorité ; mais elle rappelle aussi que ce choix de l’absence d’autonomie gagne à procéder, quant à lui, d’une délibération la plus autonome possible.
Éduquer à l’autonomie
Le lien entre autonomie et socialisation indique que l’autonomie n’est ni un don, ni le résultat d’un “développement naturel”, mais suppose une interaction avec l’environnement et les expériences qu’il permet, l’intégration de normes sociales, l’acquisition de connaissances scolaires, bref des ressources qui ne sont pas données d’emblée et sont fournies entre autres par l’éducation dispensée dans les familles, les écoles et les lieux associatifs.
L’autonomie appelle une prise en charge, un ensemble d’interventions éducatives.
Autonomie et dépendance
- S’il y a une “éducation à l’autonomie”, cela veut dire que l’autonomie n’est pas le contraire de la dépendance, tant il est vrai que l’éducation instaure une dépendance, une prise en charge des nouvelles générations par les adultes, à laquelle il est impossible d’échapper.
Contrairement aux apparences et à une conviction répandue, il n’est donc pas sûr que le processus par lequel on devient une personne autonome soit lui-même toujours un processus autonome. Dans un nombre non négligeable de cas au contraire, « on ne parvient pas à l’autonomie de manière autonome ».
Certaines formes de dépendance éducatives sont des appuis nécessaires pour le développement de l’autonomie. Ce sont celles qui peuvent être intériorisées sous forme de ressources pour agir, choisir et penser :
- des ressources techniques et intellectuelles sous la forme d’acquisition d’instruments d’action et de pensée. Dans la plupart des cas par exemple, les enfants deviennent des lecteurs autonomes, non pas en dépit de la prise en charge éducative et pédagogique, mais grâce à elle ;
- des ressources sociales relatives à la connaissance des codes, des attentes, des règles de conduite… ;
- des ressources morales : affirmation progressive de ses désirs, de ses préférences… ;
- des ressources affectives, pour apprendre à se passer des “proches” et nouer des liens avec d’autres.
Il ne faudrait certes pas en conclure que toute dépendance serait bonne à prendre. D’autres dépendances au contraire font obstacle.
- Par exemple, la transmission éducative fait obstacle à l’autonomie si elle n’est pas pertinente, si elle arrive trop tôt ou trop tard et glisse sur la personne sans que celle-ci ne se l’approprie.
- Elle fait obstacle aussi si elle est brutale, traumatisante. Elle rend autonome au contraire si elle débouche sur une pratique ou une expérience.
- Dans les termes de Mead, la transmission est un facteur d’autonomie si la formation du moi qu’elle permet suscite une activité du je.
Il est aussi possible que ce qui favorise l’autonomie à un moment devienne ensuite un obstacle. C’est le cas par exemple des jeunes enfants qui comptent sur leurs doigts, utilisant une stratégie qui réussit sur les petites quantités mais échoue sur les grandes. C’est le cas plus clairement encore du développement affectif dans lequel les ressources nécessaires au départ peuvent se transformer en obstacles quand il faut apprendre à quitter ses parents et créer des liens ailleurs. Le care familial englobe, écrit M. Friedman,
- « la potentialité de tout être humain à aider, s’inquiéter, donner des soins aux autres tout aussi bien que sa capacité à blesser, exploiter et opprimer les autres » .
Une hétéronomie poreuse : la part de l’expérience
Pas d’autonomie sans hétéronomie donc, mais pas non plus d’autonomie si l’hétéronomie est toute-puissante.
L’autonomie des personnes se développe aussi parce que personne n’est jamais tout à fait prisonnier de l’hétéronomie, parce que, selon une inspiration puisée dans l’œuvre de M. de Certeau, les gens – les enfants – s’arrangent pour échapper aux mailles des filets qui leur sont tendus.
Je propose d’appeler “expérience” la partie de l’éducation par laquelle les enfants échappent aux adultes et s’éduquent par eux-mêmes.
- L’expérience est ce qui fait que l’éducation est toujours pour une part une auto-éducation.
La part de l’expérience apparaît dans la transmission elle-même, dans la mesure où il n’y a jamais de transmission sans une activité personnelle d’appropriation, c’est-à-dire une possibilité de traduction et d’invention.
Mais l’expérience existe aussi en elle-même ; parce que les enfants sont souvent livrés à leurs propres activités, avec les proches, les camarades ou dans la solitude. Parce que l’éducation intentionnelle délivrée par les adultes n’est jamais ni continue, ni entièrement cohérente, mais présente des failles qui permettent aux enfants d’échapper au contrôle des adultes aussi bienveillant soit-il ; et enfin, parce que les enfants jouent : le jeu est le terrain d’expérimentation de l’autonomie.
En bref, l’éducation à l’autonomie emprunte des tours et des détours. Elle ne dépend pas seulement de l’éducation intentionnelle, mais aussi des interactions entre pairs. Elle ne dépend pas de la seule transmission éducative, mais aussi du développement (neurobiologique) et de l’expérience.
L’autonomie, une question de lieu ?
- On considère souvent que l’autonomie se développe principalement, voire exclusivement à l’école.
- Il faut interroger cette pseudo-évidence. En quel sens ce discours est-il crédible ?
Répondre à cette question implique d’être au clair sur les formes d’autonomie dont le développement peut à bon droit être revendiqué par les écoles : celle qui se présente spontanément à l’esprit est l’autonomie intellectuelle : cette dernière désigne une maîtrise suffisante des outils intellectuels nécessaire pour la vie sociale (en particulier pour la maîtrise de la langue écrite) et des connaissances sur le monde et les œuvres de l’esprit humain.
- Ces connaissances sont un facteur d’autonomie dans la mesure où elles apportent des repères qui enrichissent et favorisent la compréhension que nous avons du monde humain.
- Il y a dans toute existence une dimension de compréhension :
- compréhension du monde et de soi comme être au monde.
- L’autonomie intellectuelle est la forme moderne de cette compréhension.
Les écoles permettent certainement d’acquérir des outils intellectuels et des connaissances. C’est ce qu’elles savent le mieux faire, qui les spécifie par rapport aux autres lieux éducatifs et à quoi elles consacrent la quasi-totalité de leur temps.
Pour le reste, il ne semble pas qu’elles doivent bénéficier d’un privilège particulier ni du point de vue de l’autonomie pragmatique, ni du point de vue de l’autonomie morale. On peut même avoir de bonnes raisons de penser que non seulement les établissements scolaires n’ont pas de privilège à revendiquer sur ces deux points, mais même qu’ils sont plutôt mal placés.
Pourquoi ?
- Parce qu’il s’agit de lieux hiérarchiques contraints par les programmes et les exigences inhérentes aux études et aux apprentissages.
- Des lieux, autrement dit, où les enfants comprennent qu’ils doivent surtout faire ce que les adultes leur demandent et que pour l’essentiel, leur voix au chapitre ne sera que faiblement audible.
Si l’on accepte cette remarque, on pourrait en conclure, comme l’ont fait certains depuis longtemps, que les écoles devraient se réformer pour faire plus de place à une pratique effective de l’autonomie.
Cette position est défendue par les “pédagogies de l’autonomie” : ces pédagogies souhaitent une autre école, d’autres formes d’apprentissage, une école transformée qui serait meilleure justement pour le développement de l’autonomie.
Pourquoi pas ?
Des expériences et des résultats dignes d’intérêt en sont issus.
Une conviction difficile à réfuter aussi : si, comme l’écrit Nussbaum, l’éducation ambitionne de conduire « les étudiants à penser et à argumenter par eux-mêmes, au lieu de s’en remettre à la tradition et à l’autorité », cela implique une critique des apprentissages par cœur et du mécanisme et un éloge de toutes les formes pédagogiques qui associent les élèves à la transmission des connaissances et leur permettent de penser.
Cette tradition pédagogique n’est cependant pas exempte de critiques. Elle semble en particulier être polarisée aujourd’hui sur le problème de la dépendance et de la “passivité” à l’égard des “maîtres”. Ce point importe certainement. Les pédagogies de l’autonomie insistent sur l’autonomie pragmatique : elles invitent les enfants à agir par eux-mêmes, à apprendre par eux-mêmes, en les inscrivant dans des dispositifs conçus à cet effet.
Mais, d’une part, il serait naïf de croire que les élèves apprennent seuls. Quand un enseignant se met en “retrait”, cela peut produire une simple indépendance qui n’est pas encore de l’autonomie.
- À moins que l’on n’ait agi pour que ce retrait “responsabilise” les élèves.
- Dans ce cas, devant qui les élèves sont-ils responsables ? Devant l’enseignant ?
Dans ce cas, le retrait de l’éducateur n’en est pas vraiment un, l’enseignant reste présent d’une certaine façon et les élèves restent dans une forme de dépendance.
D’autre part, qu’en est-il de l’autonomie intellectuelle ? Les pédagogies de l’autonomie espèrent que l’autonomie pragmatique se convertira en autonomie intellectuelle, mais en est-on bien sûr ? On peut en douter si l’on remarque l’intérêt secondaire dont elles font souvent preuve à l’égard des contenus enseignés… Et qu’en est-il de l’autonomie morale ?
Sur ce point, me semble-t-il, pédagogie ou non, les limites des écoles restent prégnantes.
C’est en dehors d’elles que les adolescents sont confrontés aux choix les plus décisifs pour leur développement moral : sociabilité et amitiés, sexualité et vie affective, engagements associatifs et convictions politiques, relations aux proches (aux parents en particulier), expériences limites (alcools, drogues), etc. : sur tous ces points, les écoles jouent un rôle secondaire ; préventif souvent et peu influent.
- L’apprentissage de l’autonomie morale se fait en dehors d’elles.
De tout cela, j’en conclurai pour ma part que nous n’avons pas de raison de sur-considérer les écoles et de déconsidérer les autres lieux éducatifs : familles et lieux associatifs.
- L’autonomie se développe partout, dans et entre les différents lieux éducatifs.
Conclusion
Dans les lignes précédentes, j’ai soutenu cinq thèses :
(1) L’autonomie ne peut être conçue sans les “appuis de socialisation” qui la rendent possible.
(2) Ces appuis sont aussi nécessairement politiques.
(3) L’autonomie est un but nécessaire de l’éducation pour toute société qui comme la nôtre ne parvient pas à réunir un consensus sur les buts de l’éducation.
(4) Ce n’est pas nécessairement de manière autonome que l’on devient une personne autonome. Cela veut dire que
(a) l’autonomie passe souvent par la dépendance et l’hétéronomie (de même qu’elle repose sur la socialisation), tout en ajoutant cependant
(b) que personne n’est jamais tout à fait prisonnier de cette hétéronomie et de cette dépendance.
(5) L’éducation à l’autonomie n’a pas lieu seulement à l’école, mais en tous lieux éducatifs. C’est une erreur d’abstraire une institution éducative parmi d’autres, aussi importante soit-elle. Mieux vaut considérer l’expérience éducative de façon globale.
N’est-ce pas pour finir la vie qui nous rend autonomes ? La vie ; celle des enfants et des adolescents ?
- Certes, mais cette vie est souvent un exercice joué de l’autonomie, une simulation qui reste inscrite dans la dépendance éducative.
- La vie qui met l’autonomie à l’épreuve pour la solidifier ou la fragiliser, c’est la vie adulte, le travail, la vie affective et amoureuse, les engagements sociaux.
- C’est alors que les apprentissages éducatifs s’avèrent féconds ou insuffisants.
- C’est alors aussi que la vie achève l’apprentissage de l’autonomie.
Il y a des apprentissages que seuls les adultes effectuent ; par exemple, la soumission aux contraintes professionnelles ; les us et épreuves de la vie de famille, etc., et plus tard, le fait de faire face au vieillissement, à la maladie, puis à la mort.
L’autonomie a un sens aussi dans l’éducation que la vie donne à chacun. »
– Foray, P. (2017). Autonomie. Le Télémaque, 51(1), 19-28.

« […]
Entre autonomie et dépendance
L’autonomie est un concept clef du discours pédagogique. Ainsi, dans une salle de 5e et 6e années élémentaires, des affiches du programme d’éducation à la citoyenneté du conseil scolaire entité administrative entre le ministère de l’Éducation et les écoles –il en existe 72, dont 12 de langue française, en Ontario qui gère ses 425 écoles de langue française élémentaires et secondaires– rappellent aux élèves ce que signifient discernement, pacifisme, sympathie, réceptivité et autonomie :
“Je fais des efforts pour faire ce qui est attendu de moi, même si cela me demande parfois beaucoup de patience et d’autodiscipline. J’éprouve de la fierté pour ce que je suis capable de faire seul, sans l’aide ou la supervision d’un adulte” (affiche, salle de classe février 2009).
L’autonomie entendue ainsi est même vue comme une valeur prédictive de réussite, pilier du schéma des apprentissages moteur et cognitif, inventé dans les années 1940 et planétairement diffusé par un tableau qui présente, de mois en année, ce que devrait faire ou dire un enfant selon son groupe d’âge (Rose cité par Bloch 2006, Popkevitz 1998). Ce tableau, sous-tendu par une conception psychologique et développementale, un idéal-type d’enfant à un âge/stade donné, produit un discours normatif sur l’expérience de l’enfant normal, sans le rapporter ni le confronter à l’environnement des enfants (Woodhead 2008), à la pluralité de l’enfance (James & Prout 1997, Christensen & James 2000).
- L’autonomie est alors une fin en soi, une habileté à acquérir, individuellement, sans considération des circonstances de son émergence, notamment à l’école.
Réminiscence d’origine religieuse, Dubet (2010) rappelle que, dans l’école sanctuaire, la soumission aux règles était un gage dans la quête d’autonomie et de liberté.
Avec la massification de l’éducation, l’autonomie ne se résume plus à une compétence transversale de l’élève débrouillard qui effectue des travaux seul.
- Les trajectoires des élèves varient et dans les réformes des pays occidentaux, l’élève mis au centre est un être déjà autonome (Rayou 2000).
- L’autonomie se définit alors selon deux pôles cognitif et politique (Lahire 2001).
L’autonomie cognitive
Le pôle cognitif (Lahire 2001) suggère la capacité de l’élève à résoudre des problèmes, à effectuer des tâches sans se référer à l’enseignant. C’est l’aspect le plus valorisé par l’École même si le discours ambiant suggère un socioconstructivisme où l’éducation à la citoyenneté, l’expression de soi et l’entraide sont valorisées.
Pour Monceau (2008),
- l’autonomie se résume à l’aptitude de l’élève à travailler sans surveillance continue ou avec un encadrement relâché.
- Cette définition cognitive se rapporte, selon Bloch (2006), à un projet socio-éducatif individualiste, compétitif et productiviste.
- L’idée est d’atteindre une efficacité des apprentissages sans surveillance constante ni ressources importantes pour l’élève autodiscipliné.
- Il s’agit du même rapport que l’exigence sociale d’intériorisation de la norme, malgré une dépersonnalisation et une déterritorialisation du pouvoir.
L’individu civilisé, rationnel et autonome se gouverne et agit selon les normes convenues socialement. Selon Popkewitz (1998), ce façonnement de l’individu normal, performant, adapté et au service de la nation imaginée caractérise l’éducation moderne de masse.
Cet idéal est toujours présent mais recomposé :
- dans un monde en mutation, dans un marché incertain, l’École veut former des sujets autonomes, responsables, prêts à prendre des risques, à s’adapter (Dalhberg & Moss 2007).
Bloch (2006, 39) précise que ce discours universel et inclusif génère de fait inclusion et exclusion en termes d’identités, d’idées, d’actions s’écartant de la norme (Popkevitz 1998).
L’élève, précise Lahire (2001, 161), devenu responsable, doit assumer ses choix et s’y soumettre, en terminant une activité ou en réussissant, au risque de tomber dans le “piège pédagogique”.
L’autonomie politique
Sur le plan politique, l’autonomie est un processus de relation de soi aux autres inscrits dans des structures relationnelles. Produit de l’interaction (Élias 1991), “l’autonomie de l’élève passe […] par une bonne compréhension et une bonne gestion, par l’apprenant, des interactions avec les pairs et avec l’enseignant.
L’‘autorisation’ de l’élève (au sens d’Ardoino 1994) nécessite impérativement une bonne intelligence des interactions sociales dans la classe” (Ravenstein & Jonnaert 1999, 3).
Le pôle politique recouvre la capacité de l’élève à prendre des décisions par lui-même :
- “La capacité d’action ‘autonome’ des élèves a, de toute évidence, partie liée avec l’existence de ‘règles du jeu’ explicites qui les libèrent de la dépendance personnelle exclusive à l’égard de l’enseignant” (Lahire 2001, 155).
Selon ce scénario, codes et normes connus, établis avec les élèves sont négociables et réformables.
L’élève étant responsable de leur élaboration et de leur respect, il reconnaît la validité et l’utilité des règlements car il a une emprise sur eux. C’est le pôle le plus difficile à implanter dans la salle de classe (Lahire 2001) car cela nécessite que l’enseignant rejette la relation savoir-pouvoir traditionnelle où l’adulte instruit l’enfant. Il doit accepter d’être le facilitateur de l’épanouissement de l’enfant, citoyen de la classe à l’égal de l’enseignant.
- L’autonomie de l’élève requiert une autre relation
- à l’autorité,
- à l’enseignant,
- à la discipline.
Le métier d’élève en est transformé.
“Les stratégies qui ont fait leur preuve deviennent inefficaces, les élèves doivent en inventer de nouvelles : on leur demandait de se taire, on leur demande de s’exprimer ; on les invitait à ne s’aventurer qu’avec des certitudes, on met en valeur leurs essais et erreurs ; on insistait sur la précision et le conformisme, on vante leur imagination ; on louait le travail scolaire, on insiste sur la coopération” (Perrenoud 1994, 20).
- Dans cet environnement, des processus d’exclusion perdurent.
Cette pédagogie fondée sur l’autonomie, l’authenticité a des effets inégalitaires car ses modèles se calquent sur ceux qu’ont connus chez eux les élèves des familles les plus favorisées (Perrenoud 1994, Geay 2009).
- Castoriadis renvoie l’autonomie à notre capacité réflexive de créer collectivement les normes et obligations qui nous unissent de manière citoyenne (1999).
- On peut y voir, inspirée de Dubet (2010), confirmation de la thèse de Weber sur la guerre des dieux.
L’École n’est plus sanctuaire, elle devient multiple.
- Les établissements “organisations composites” (Derouet 1989) ne s’imposent plus par leur hétéronomie autoritaire, ils sont une des sphères de socialisation des jeunes (Bélanger & Farmer 2010, Cortesero 2010, Petitat 2003).
- Butler (2007) repense le Sujet de l’humanisme (la connaissance de soi conditionne la liberté) en le situant dans une construction historique permanente et dans son rapport performatif et inventif à autrui.
- Pour elle, le sujet gagne en autonomie et en liberté quand il invente sa vie, échappe aux normes, les subvertit ou les transforme.
- À travers ce processus, du rapport de soi à autrui, une responsabilité morale émerge.
Ambroise (2009) pourtant s’interroge : ce rapport inventif à autrui n’est-il pas une “illusion scolastique typique des intellectuels” dont ils seraient seuls à bénéficier (112) ?
Dans leur sociologie de “l’acteur faible”, Payet, Guiliani & Laforgue (2008, 12) rappellent Descombes (2004, 443) qui rejette autant la vision mécaniste de l’individu réduit à l’actualisation de règles intériorisées que l’auto-législation en soulignant que
la capacité à agir de soi-même est constituée par un arrière-plan de significations déjà instituées.
Payet & Laforgue (2008, 12) en concluent :
“On peut distinguer (au moins) deux figures de l’autonomie, l’une dans laquelle être autonome, c’est suivre librement une règle ‘déjà-là’, l’autre […] où faire preuve d’autonomie c’est modifier, voire inventer une règle”.
- Petitat (2003, 94) précise que la structuration normative du social “ne peut consister ni en autonomie ni en dépendance complète.
- Elle implique ipso facto des emboîtements et des enchevêtrements d’autonomie et de dépendance”.
En ce sens, dans les configurations présentées, l’analyse des situations garde à l’esprit cette dyade autonomie/dépendance.
L’élève en tant qu’acteur et l’arrière-plan scolaire
- Les discours sur l’enfance étaient et sont encore parfois constitués à partir d’une perspective adulte ne considérant pas l’enfant comme acteur autonome.
Ils en font un objet de connaissance (selon Foucault (2005), un élément statique observable. Pour Bloch (2006), ce discours prend l’enfant pour objet saisissable par la science, des savoirs s’y déclinent ensuite universalisables aux enfants, devenus élèves, à travers des pratiques enseignantes généralisables, exemplaires, modélisables ayant comme finalité de régler certains problèmes sociétaux par l’éducation.
- Les discours normatifs sur l’élève –retrouvés parfois en didactique et en pédagogie– en font un être qui se constitue par mimesis.
- Si ce mode était opérationnel, nous ne verrions pas de différences significatives de comportements en classe.
- Il suffirait de bons modèles à offrir aux élèves, ainsi que de bons vendeurs d’idéaux-types du bon élève pour s’assurer de la modélisation.
- Ce type de discours, centré sur le messager et les codes à transmettre, occulte le rôle de l’élève, son apport dans son propre développement et ne tient pas compte des stratégies imprévisibles des acteurs dans la salle de classe.
Pour Petitat, “la socialisation ne [peut] consister en inscriptions répétées sur la feuille immaculée de l’enfant, car elle implique le jeu avec les régularités et les règles, jeu qui s’apprend par insertion vive dans la relation elle-même” (2003, 102).
- La socialisation-intégration de l’élève à la société, mission de l’école, ne s’effectue ni contre lui ni malgré lui mais avec lui.
Si l’institution est un “déjà-là” avec lequel il doit composer, la manière dont il le fait lui appartient ; il joue avec les modèles et les codes, les accepte ou non, se les approprie ou non. Il interroge le contenu scolaire et ses normes, y adhère s’il a du sens pour lui, sinon il les refuse ou les permute à sa façon.
- L’élève navigue entre plusieurs réseaux et personnalise son comportement lors de son passage à l’école ;
- il résiste ou participe selon les situations.
- Ce qui est attendu de lui, le rôle qu’on veut lui faire jouer et l’appropriation-personnalisation qu’il s’en fait (Lefebvre 1970) diffèrent.
L’élève contribue à la conservation sociale et au changement en naviguant dans un déjà-là. La représentation de l’élève auteur de sa vie (Butler 2007), qui fait acte d’imagination radicale dans la création de soi (Castoriadis 1999), reste inspirante, mais elle repose sur “un arrière-plan de significations déjà instituées” pour reprendre Descombes (2004).
À partir de ce cadre théorique, que signifie l’autonomie dans les écoles visitées, dans quel “arrière-plan de significations déjà-là” se configure et se déploie son contenu ?
- Est-elle cognitive et/ou politique ?
[…] »
– Bélanger, N. & Farmer, D. (2012). Autonomie de l’élève et construction de situations scolaires. Études de cas à l’école de langue française en Ontario (Canada). Éducation et sociétés, 29(1), 173-191.

« […]
Or, c’est ici qu’un lieu de socialisation tel que l’école, au sein duquel la problématique de l’« autonomie » n’a cessé de croître depuis une bonne vingtaine d’années, apparaît en fin de compte – étant donné la place qu’il occupe dans la vie des enfants et des adolescents – comme un lieu central où peuvent s’observer toutes les pratiques, toutes les techniques et tous les dispositifs pédagogiques (de la simple attitude de l’enseignant à la situation pédagogique la plus outillée et la plus élaborée) mis au point ou utilisés au nom de l’« autonomie de l’élève »,
- c’est-à-dire en vue de la formation précoce et systématique d’un type d’élève particulier, différent des types d’élèves antérieurement façonnés par l’institution scolaire :
- un « élève autonome ».
En s’intéressant à la réalité scolaire sous cet angle, on renoue avec des interrogations wébériennes centrales dans sa sociologie en générale, et dans sa sociologie des religions en particulier.
En effet, attentif aux différents types d’ethos, Weber vise au fond à saisir dans ses travaux ce que
- les institutions ou les situations stabilisées en « conduites de vie » façonnent ou fabriquent comme « types d’hommes » :
« Dans la mesure où l’action sociale est “portée” par des hommes (“derrière l’‘action’, il y a l’homme”), Weber a toujours considéré que l’analyse sociale devait intégrer précisément la question de l’“homme”, ce qu’il appelle le “point de vue anthropocentrique”, en posant la question du “type d’homme” que les relations sociales sont capables, dans la durée, de façonner. »
Dans les formes de relations qui s’instaurent entre l’élève et le maître, entre l’élève et les savoirs (ou les situations d’apprentissage) ou entre élèves, on invente et tente – avec plus ou moins de succès – de transmettre ces « qualifications sociales » que Schwartz appelait de ses vœux et que sont les dispositions à l’autonomie et à la responsabilité.
Rapport au savoir, rapport au pouvoir
L’autonomie et le manque d’autonomie sont aujourd’hui fréquemment évoqués par les enseignants pour qualifier l’attitude des élèves en « échec » ou en « réussite » :
autonomie comme autodiscipline corporelle (contenir ses désirs, « se tenir », écouter, lever le doigt avant de parler ou se mettre au travail par soi-même, sans que l’enseignant ait besoin d’intervenir) et comme autodiscipline cognitive (savoir faire un exercice tout seul, sans l’aide du maître, sans poser de questions, avec les seules consignes écrites indiquées, savoir lire en silence et résoudre par soi-même un problème, etc.).
- Le terme d’« autonomie » cristallise donc un ensemble de caractéristiques scolairement valorisées.
Pour comprendre les raisons d’une telle insistance, il faut souligner le fait que
l’école n’est pas un simple lieu d’apprentissage de savoirs mais, tout autant, un lieu d’apprentissage de formes d’exercice du pouvoir et de rapports au pouvoir.
Inventée et diffusée sous le régime d’une monarchie absolue (les collèges et les petites écoles rurales d’Ancien Régime puis les écoles primaires lassalliennes), dans une phase de consolidation et de dé-personnalisation du pouvoir d’État, s’adaptant à la monarchie constitutionnelle (école mutuelle), puis à la progressive entrée en démocratie politique (avec l’école de Jules Ferry),
- l’école est une instance de socialisation centrale, qui est, de ce fait, particulièrement sensible aux changements les plus importants du point de vue de la configuration et de la conception de l’exercice du pouvoir à l’échelle de la formation sociale.
Depuis qu’elle existe, l’école, comme univers où règne la règle impersonnelle, s’oppose à toutes ces formes de pouvoir qui reposent sur la volonté ou l’inspiration d’une personne.
Dans ce cadre général de la règle impersonnelle,
- l’école est passée historiquement de la fabrication de l’« élève dressé » (construite à partir de la fin du xviie siècle dans les écoles de J.-B. de La Salle et celles de Charles Démia)
- à celle de l’« élève raisonnable et raisonné » (élaborée initialement à partir de 1815 au sein des écoles mutuelles),
- la « raison » étant le pouvoir sur soi-même qui remplace le pouvoir exercé par d’autres, de l’extérieur.
En ce sens, aider l’élève à aller seul vers le savoir, concevoir le rôle d’enseignant comme celui d’un guide pédagogique (facilitator) ou d’une « personne ressource » davantage que d’un instructeur (au double sens du terme), demander à l’élève de contrôler ses pulsions ou ses désirs pour respecter les règles de vie scolaires, c’est faire un pas de plus vers l’élève capable de self-government.
- « Apprendre à apprendre »,
- se mouvoir seul dans le savoir à l’aide de fichiers,
- faire des recherches documentaires,
- savoir faire un exercice seul après la lecture silencieuse d’une consigne,
- consulter le dictionnaire lorsqu’un mot est incompréhensible,
- être capable d’organiser son travail et de le planifier ou apprendre à s’autocorriger :
- autant de pratiques constitutives de la pédagogie moderne,
- celle vers laquelle de nombreux enseignants tendent en discours et/ou en pratiques.
Les cadres d’une recherche
En 1995,
- l’« autonomie » était conçue comme une compétence transversale à l’école primaire.
- Elle est de même fréquemment évoquée à propos des apprentissages scolaires fondamentaux (lecture autonome, production autonome de textes, etc.).
Mais qu’en est-il de cette « autonomie » dans la réalité des représentations et des pratiques pédagogiques ? Tout le monde attribue-t-il la même signification à ce terme ? Tous les enseignants s’entendent-ils pour définir un comportement ou une attitude « autonomes » ? Quels pratiques, techniques ou dispositifs pédagogiques sont-ils mis en place dans le quotidien des classes pour atteindre l’objectif d’« autonomie » de l’élève ?
Pour répondre à ces interrogations, j’ai travaillé sur une série de données tirées d’une même circonscription de l’Académie de Lyon. Ces données sont, outre les entretiens avec des enseignants de 12 écoles primaires (n = 39), les rapports d’inspection (anonymes) concernant l’ensemble des enseignants de la circonscription, des notes ethnographiques sur des périodes d’observation en salle de classe ainsi que les projets des différentes écoles. Qu’il s’agisse des entretiens, des rapports d’inspection ou des notes ethnographiques, j’ai préféré reconstruire les pratiques de classe les plus ordinaires ou les descriptions précises de manières de faire ou de situations de classe plutôt que d’enregistrer des « valeurs » ou des discours généralistes qui relèvent d’oppositions entre idéologies pédagogiques ou entre modèles de société.
- Le terme d’« autonomie » a néanmoins déclenché parfois des propos généraux sur les valeurs de « compétition » ou de « coopération », la « démocratie », les « soixante-huitards » ou l’« adaptabilité » comme valeur critiquable du libéralisme (des enseignants pouvant avoir la « tête » très nettement du côté de l’« autonomie » et un « corps » – des gestes professionnels – plus réservé, et inversement).
Et il est difficile de ne pas établir un lien entre
- le « passage du contrôle à l’autocontrôle » qui constitue, selon Luc Boltanski et Ève Chiapello, « l’un des traits marquants de l’évolution du management au cours des trente dernières années » et des tendances pédagogiques parallèles.
Lorsque ces sociologues expliquent que « les nouveaux dispositifs visent à accroître l’autonomie des personnes et des équipes de façon à les amener à prendre en charge une partie des tâches de contrôle autrefois assumées par les échelons supérieurs ou les services fonctionnels »,
- on pourrait dire que l’autocorrection, l’auto-évaluation, l’autogestion de son temps et de sa charge de travail dans le cadre scolaire relèvent de la même logique.
[…]
La figure idéal-typique de la pédagogie de l’autonomie
La figure idéal-typique que je vais présenter est, en tant que telle,
- rarement incarnée chez des enseignants singuliers.
En effet, hormis quelques rares exceptions qui s’approchent de la pureté de l’idéal-type (obtenue par accentuation des traits et systématisation-articulation d’éléments dispersés),
- les enseignants sont tous plus ou moins pédagogiquement partagés et leurs pratiques sont les produits de métissages ou de bricolages aux dosages très subtils.
Partagés entre des envies d’« autonomie » et des difficultés pratiques à mettre en œuvre ces envies dans les faits ; utilisateurs d’une partie des nouvelles méthodes ou des nouveaux dispositifs à titre de complément, tout en restant profondément attachés à une pratique plus « traditionnelle » ; balançant, selon les années, les niveaux et les types de populations scolaires, entre un pôle et son opposé ;
persuadés que l’autonomie est une nécessité historique et une bonne chose, tout en constatant que seules les nouvelles générations d’enseignants, avec de nouvelles habitudes du métier, sauront mettre en place une telle pédagogie ;
convertis aux nouvelles pratiques alors même qu’ils avaient été les porteurs d’habitudes antinomiques qui auraient pu les conduire vers un conservatisme pédagogique, etc. :
à envisager les choses dans toutes leurs nuances, on peut dire que les enseignants qui adoptent totalement une « pédagogie de l’autonomie » ou, inversement, une « pédagogie frontale et directive » ne sont pas les plus nombreux, et la saisie des réalités pédagogiques à l’état individualisé donne une image plus ambivalente que l’étude qui privilégie la reconstitution idéal-typique (et nécessairement caricaturée) d’univers pédagogiques relativement cohérents.
- Dans le cadre d’une pédagogie de l’autonomie,
- la classe ne doit plus être un bloc monolithique et unifonctionnel.
- Elle doit se diviser en parties différenciées, propres à des activités spécifiques dont les élèves ont appris à connaître le contenu et les règles.
- Chaque sous-espace doit garder trace, dans la mesure du possible, d’une mémoire spécifique et suppose qu’un affichage y soit associé.
- Il s’agit d’un affichage concernant les règles de comportements, les éléments de savoirs et les consignes, ainsi que les productions d’élèves (lorsque cela s’y prête), qui sont propres à chaque sous-espace.
Cette organisation spatiale de la classe en sous-espaces différenciés va permettre d’instaurer une organisation collective où tout le monde ne fait pas la même chose au même moment.
- Les élèves sont donc amenés à être relativement autonomes, car l’enseignant ne peut être partout à la fois. Cette répartition en petits groupes (ce qui ne signifie pas forcément qu’il y ait « travail en groupe »), qui peuvent constituer des « ateliers »,
- permet à l’enseignant de s’occuper des élèves les plus faibles scolairement et, par conséquent, les moins autonomes.
Le modèle de la pluriactivité s’oppose à celui de la « pédagogie frontale » où l’ensemble des élèves écoutent l’enseignant en même temps ou exécutent simultanément le même exercice. De plus, lorsque les élèves ont des modalités de travail diversifiées (travail individuel, en petit groupe, collectif) et des types d’activités variées au cours d’une même demi-journée, l’enseignant évite la monotonie et l’ennui provoqués par le système leçon-exercices individuels (répétitifs) et il maintient leur attention en éveil.
- Pour mettre en place une telle pédagogie et tenir compte des différences de compétences entre élèves (« pédagogie différenciée ») au moment de concevoir les diverses activités et de former les groupes,
- les enseignants doivent s’appuyer sur une bonne connaissance préalable des élèves.
- L’évaluation des connaissances, le diagnostic des compétences sont donc des outils centraux de ce modèle pédagogique.
L’organisation de la classe doit pouvoir éviter le plus possible le symbole même de la pédagogie frontale, à savoir le face-à-face enseignant-élèves, les bureaux des élèves, placés en différentes rangées, étant tous orientés du même côté et faisant face au bureau du maître et au tableau.
Si l’on doit veiller à ce qu’aucun élève ne tourne le dos au tableau, les bureaux des élèves peuvent néanmoins être regroupés par trois ou quatre, les élèves se faisant face deux par deux, et l’enseignant peut alterner les moments d’écoute collective (où tout le monde est à l’unisson et se tourne vers l’enseignant et le tableau) et de travail autonome (individuel ou collectif).
- Ce qui est recherché, c’est aussi un rapport moins « directif » aux élèves.
L’enseignant ne doit pas trop parler, et ne doit pas considérer les élèves comme des réceptacles passifs du savoir déversé dans leurs oreilles ou étalé devant leurs yeux, des simples cires molles dans lesquelles la marque des générations antérieures va pouvoir s’imprimer.
L’élève est supposé actif (ou, en tout cas, doit être placé en situation active), il doit poser des questions, s’interroger, aller chercher un complément d’information dans un livre, un dictionnaire ou un manuel, et l’enseignant doit s’appuyer sur ses capacités, ses connaissances, son intelligence, sa compréhension, son jugement.
L’élève doit « prendre en charge son activité intellectuelle », être placé en situation de réflexion ou de production-création (vs situation d’entraînement systématique et répétitif).
- Parce qu’il est actif, l’élève ne peut plus être l’élève paralysé sur sa chaise, silencieux et discipliné d’autrefois.
- Il doit pouvoir se déplacer au sein de l’espace de la classe, il doit pouvoir parler avec d’autres, et il doit surtout pouvoir se déplacer et parler sans avoir à demander systématiquement l’autorisation de l’enseignant.
- L’autorisation lui est accordée par le système de fonctionnement de la classe, dans la mesure où ces déplacements
- et ces prises de parole suivent les règles communes établies et acceptées par tous en début d’année.
On note au passage que l’élève visé dans un tel modèle pédagogique n’est pas nécessairement l’élève épanoui défendu par une certaine pédagogie romantique et libertaire, qui elle aussi s’attaquait à tous les formalismes arides, à tous les traditionalismes, à la directivité, à l’oppression de l’élève par les maîtres et à l’étouffement de sa créativité et de son imagination par l’inculcation de savoirs.
L’élève n’est pas conçu comme devant trouver les conditions de son épanouissement mais comme un être intelligent, capable de construire ses savoirs et d’être un citoyen responsable : un savant doublé d’un politique.
De même, à l’imposition d’un régime unique d’exercices ou de tâches, se substitue de plus en plus la logique du choix (relatif) de l’élève :
- choix de telle activité (parmi une série d’activités possibles) lors des moments d’accueil,
- choix d’un exercice parmi une série d’exercices possibles disponibles dans un fichier,
- choix de telle poésie à apprendre parmi un ensemble de poésies possibles,
- choix du moment de la récitation de ce même poème, etc.
Donner le choix à l’élève a pour objectif d’obtenir son investissement, sa motivation, son intérêt.
Le raisonnement pédagogique est simple : s’il a fait un choix, l’enfant sera nécessairement davantage disposé à travailler que lorsqu’on lui impose (arbitrairement) les choses.
Permettre le choix constitue une technique d’intéressement ou de concernement de l’enfant, qui ne peut désormais plus dire que les choses qu’il fait ne l’intéressent pas.
En faisant un choix, tout se passe comme si l’enfant signait un contrat qui signifiait son engagement dans la tâche.
- L’élève est « placé au centre du système éducatif ».
Ce slogan pédagogique conduit à
- mettre l’enfant en charge de tâches ou à lui donner accès à des informations ou des savoirs jusque-là « portés » par les seuls enseignants.
Ce n’est pas seulement l’enseignant qui corrige, c’est l’élève qui s’autocorrige. Ce n’est pas exclusivement l’enseignant qui évalue, mais c’est l’élève qui doit s’évaluer et savoir où il en est dans une progression explicite.
- L’enseignant n’est pas le seul garant de l’ordre scolaire, car, plutôt que de voir les sanctions « tomber » de l’extérieur,
- l’élève participe désormais à l’élaboration des règles de vie (codes, lois communes ou règlements) et à leur mise en œuvre.
Il n’est pas le seul à connaître les buts à atteindre, la manière dont vont se dérouler les choses, dont elles vont s’organiser :
l’élève doit savoir exactement ce qu’on attend de lui, connaître les objectifs qui sont visés, les critères d’évaluation qui vont être mis en œuvre ou la manière dont les choses vont se jouer au cours de la journée ou de la semaine (emplois du temps).
L’élève est aussi chargé de tâches assurées auparavant par l’enseignant (organiser le restaurant scolaire, faire l’appel, noter les absents, inscrire la date sur le tableau, s’occuper des informations météorologiques, discuter et fixer les règles de vie de la classe, organiser et animer un conseil de classe, etc.).
L’autonomie repose donc fondamentalement sur trois éléments essentiels :
- transparence : il faut que tout – de l’emploi du temps aux compétences visées en passant par les critères du jugement scolaire – soit dit à l’élève, explicité à son attention ;
- objectivation : il s’agit de s’appuyer sur un ensemble de savoirs, d’informations ou de règles, écrits ou imprimés (manuels, fichiers, tableau noir, dictionnaire, documents divers) ;
- publicisation : il faut que l’élève puisse se reporter à des éléments visibles (savoirs, règles communes, consignes d’un exercice) ; dans ce cadre, on comprend l’insistance des inspecteurs sur l’affichage, qui ne se réduit pas au seul affichage réglementaire d’autrefois, mais qui est une publicisation en direction des élèves et utilisable par eux.
L’école prône le recours à la loi écrite et au savoir écrit, et articule clairement autonomie de l’élève et objectivation-publicisation des savoirs et des règles :
« Les consignes, sur les buts des tâches, doivent être écrites sur le tableau pour aider à construire l’autonomie des élèves ; les légendes écrites doivent être lues à haute voix et questionnées ; les synthèses doivent dégager les savoirs constitutifs d’une séance et les garder en mémoire sous forme de traces écrites […] ; le rapport à la règle, à la loi, doit être vécu au quotidien ; à tout instant de la classe, le retour à l’affichage, qui tient lieu de contrat avec les enfants, vaut d’être effectué comme un moment de rappel des règles dûment acceptées avec les enfants en début d’année » (Rapport d’inspection, enseignant d’une classe de CE2-CM1, 1998).
Dans un tel modèle pédagogique, l’enseignant n’enseigne plus, mais guide.
C’est le point de vue de l’élève qui est mis en avant lorsqu’on parle de le placer « en situation d’apprentissage ».
- L’acte d’enseignement est perçu comme un acte unilatéral, partant de l’enseignant pour arriver à l’élève, alors que c’est l’élève qui doit être au cœur de la pratique.
L’« enseignant » converti en « animateur », en « adulte-ressource » ou en « guide des apprentissages » a désormais la mission d’expliciter les tâches, les cadres, les objectifs, les critères d’évaluation, les consignes des exercices, les règles de vie commune et de veiller à ce que les élèves :
1) les comprennent et
2) les appliquent ou les respectent.
Il circule entre les groupes, régule, explicite et fait reformuler. L’élève doit montrer qu’il a compris et l’enseignant doit s’en assurer (en faisant, par exemple, reformuler les consignes par l’élève avec ses propres mots).
Le savoir n’est plus un savoir tout fait « inculqué » mais co-construit avec les élèves. L’élève est, dit-on, « acteur de ses apprentissages ».
On préfère que l’élève découvre ou constate par lui-même les règles, les phénomènes ou les faits ; qu’il soit dans une démarche de recherche personnelle plutôt que dans l’écoute, l’apprentissage par cœur et la restitution d’un savoir déjà construit.
- On propose que les résumés d’une séquence d’apprentissage, d’un travail collectif, soient formulés par les élèves eux-mêmes
- plutôt qu’assenés arbitrairement par l’enseignant et copiés mécaniquement (« bêtement ») par les élèves.
- L’élève ne travaille plus seulement parce que l’enseignant l’exige mais parce qu’il a passé un « contrat de travail » avec lui et qu’il doit respecter ce contrat (responsabilisation).
De la même façon, les règles ou les lois communes constituent des coproductions enseignants-élèves. Du même coup, lorsqu’il transgresse une loi, l’élève se place hors du cadre qu’il a lui-même contribué à fixer.
- Là encore, la loi, la règle ou le code sont pensés sur le mode de « contrats » passés avec l’ensemble des élèves qui s’engagent à les respecter. Les conseils de classe constitués par des élèves symbolisent ces nouvelles responsabilités dont ils sont désormais chargés.
De manière générale, l’autonomie reposant sur l’usage de dispositifs de savoirs, d’informations ou de règles objectivés (imprimés, manuscrits ou inscrits au tableau), une telle pédagogie suppose de bonnes compétences lectorales.
Pour pouvoir se débrouiller seuls avec ces dispositifs, les élèves doivent être capables de lire (silencieusement) et de comprendre ce qu’ils lisent. Lorsqu’ils n’ont pas encore la maîtrise suffisante des compétences lectorales nécessaires, l’enseignant est là pour lire à haute voix les consignes, pour expliciter verbalement les tâches ou pour vérifier auprès des élèves la bonne compréhension des consignes.
- La lecture silencieuse est la clef de voûte – souvent implicite – de tout l’édifice pédagogique.
Autonomie politique et autonomie cognitive
Même si ces dimensions ne sont pas toujours dissociables dans les faits, on peut distinguer deux pôles où est susceptible de s’exercer l’autonomie de l’élève :
- le pôle politique (vie collective, règles de vie commune et discipline) et
- le pôle cognitif (celui de l’appropriation des savoirs).
Être un élève-citoyen autonome, être un élève-apprenti autonome, voilà les deux grandes orientations que prennent les dispositifs pédagogiques en matière d’autonomie.
Les dispositifs politiques peuvent n’avoir parfois aucun autre objectif que celui de
- la responsabilisation des enfants en dehors de toute visée cognitive (le terme « autonome » est associé alors à ceux de « citoyenneté » et de « responsabilité »).
Les enseignants remarquent assez spontanément que le travail sur ce versant de l’autonomie peut entrer en contradiction avec la fonction de transmission des savoirs à l’école primaire.
Pour entrer sérieusement ou « authentiquement », comme disent parfois les pédagogues modernes (pour souligner que cette démarche ne relève pas de la simple simulation pédagogique de modes de fonctionnement adultes), dans la logique des responsabilités individuelles, de la fixation collective des règles, de la négociation régulière de ces dernières, de la mise en place d’instances démocratiques de discussion de la vie de l’école et de la classe (conseil de classe, conseil d’école, etc.),
- certaines écoles consacrent un temps particulièrement important à l’organisation de la vie collective avec les élèves, temps qui ne peut qu’être déduit de celui consacré à l’appropriation des savoirs et des techniques intellectuelles.
L’école se soucie alors autant de former des futurs citoyens actifs que de transmettre des savoirs disciplinaires.
- Mais les enseignants peuvent, au contraire, inscrire leur démarche dans un modèle plus « cognitif » en plaçant au second rang de leurs priorités la production d’une « responsabilisation » de l’élève dans le collectif.
La capacité d’action « autonome » des élèves a, de toute évidence, partie liée avec l’existence de « règles du jeu » explicites qui les libèrent de la dépendance personnelle exclusive à l’égard de l’enseignant. En effet, un enseignant qui n’expliciterait aucune consigne ni aucune règle, n’offrirait pas les conditions minimales permettant aux élèves de savoir, sans demander, s’ils ont le droit ou non de faire telle ou telle chose. On est alors au degré zéro de l’autonomie de l’élève.
- Mais selon les enseignants, le degré d’explicitation et d’objectivation des règles de vie de la classe est plus ou moins fort.
Faut-il, par exemple, produire une règle et l’afficher à propos du nombre d’élèves qui peuvent se rendre au coin bibliothèque ou aller tailler leur crayon à la poubelle ?
La plupart du temps, ces situations plus spécifiques sont gérées de manière moins formelle que d’autres, ce qui ne veut pas dire qu’aucune règle ne soit formulée à leur sujet. La palette des solutions pédagogiques au problème de l’ordre et de son maintien au sein de la classe apportées par les enseignants va du spontanéisme (ou du pragmatisme) le plus grand au formalisme-juridisme le plus poussé.
- Parfois, le « système » adopté est très souple, peu outillé, géré sans règle écrite, sans instance de négociation et de production des règles.
- Parfois, il est au contraire très codifié et repose sur un travail de négociation, d’explicitation, de publicisation qui aboutit à des solutions mettant l’accent sur l’impeccabilité formelle des procédures (réunions de conseils, élections, votes, dépôts de réclamations écrites, etc.).
- Dans les deux cas, les élèves doivent acquérir des habitudes de vie, mais ce qui distingue les fonctionnements,
- c’est que dans un cas la vie de la classe repose essentiellement sur l’habitude incorporée et la régulation orale, et que dans l’autre cas on fait référence explicitement à la règle, supposée connue de tous, parfois produite collectivement, écrite et affichée, rappelée, etc.
L’importance de la règle dans le dispositif disciplinaire se mesure à la manière dont elle est produite, énoncée, mobilisée et éventuellement modifiée.
Existe-t-il des règles ? Ces règles sont-elles le produit d’une discussion collective ? Existe-t-il une instance spécifique de discussion et d’élaboration de ces règles ? A-t-on formellement voté pour les mettre en place ? A-t-on demandé ou non aux enfants (et éventuellement à leurs parents) de signer le document mentionnant l’ensemble des règles à respecter ? Sont-elles affichées ? S’y réfère-t-on explicitement au moment où une infraction est commise ? Les sanctions sont-elles prévues en cas d’infraction aux règles ? Les élèves sont-ils consultés sur la nature de ces sanctions ? Les élèves peuvent-ils décider en cours d’année du changement des règles ?
- Selon les réponses apportées par les enseignants à ces multiples questions, les dispositifs pédagogiques peuvent varier légèrement ou considérablement.
Lorsque les enseignants se réfèrent explicitement aux règles écrites en cas de transgression des règles,
- le modèle politique adopté est plus formel que celui qui est mis en œuvre dans les cas où le règlement est écrit en début d’année mais n’est pas véritablement constitué comme référence lorsque les problèmes se posent,
- et bien plus formel encore que lorsque aucun règlement n’est élaboré et que la régulation du fonctionnement de la salle de classe se fait oralement, en fonction des contextes et dans l’interaction du maître (qui détient l’autorité) et des élèves.
Le modèle politique plus souple, plus informel, mais aussi plus flou et potentiellement plus arbitraire, sans élaboration collective de règles écrites, sans possibilité de négociation des règles, sans élection, sans procédure de renvoi des cas aux règles écrites, etc., est un modèle qu’on pourrait qualifier de « familial ».
En effet,
la famille est le plus souvent le lieu de l’informel, de l’entre-soi où l’autorité des parents ne repose sur aucun règlement particulier, mais sur la bienveillance (fondée en ce cas sur l’amour) à l’égard des enfants.
Ce modèle familial est celui qui laisse le moins la place à l’autonomie de l’enfant, car celui-ci doit demander fréquemment l’autorisation à l’enseignant de faire les choses, ne maîtrisant pas l’ensemble des règles du jeu et ne pouvant pas vraiment s’orienter par lui-même en toute connaissance de cause.
Si l’école repose historiquement sur un énorme travail d’objectivation et de codification, si elle est bien l’instance de socialisation où l’on a appris historiquement à ne plus obéir à une personne mais à des règles supra-personnelles (qui s’imposent autant aux élèves qu’aux maîtres), les enseignants de la fin du xxe siècle continuent cependant sans cesse à composer, plus ou moins, avec deux logiques antagoniques :
- d’une part, la logique de la souplesse pragmatique et de l’informel (sens pratique des situations et de l’opportunité des décisions) et,
- d’autre part, la logique de la clarté, de la formalité, de l’explicitation et de la fixation (codification des pratiques).
Même les enseignants les plus enclins à codifier – et qui sont du même coup obligés de mettre en place des procédures de rectifications régulières des codes (rediscussion des règles en conseil de classe ou en conseil d’école, ajout de certaines règles en fonction des événements survenus dans la classe ou dans l’école) – ne peuvent pas tout codifier et sont amenés à « faire avec » une multitude d’habitudes incorporées, de normes implicites, d’évidences ou d’allant-de-soi que requiert le fonctionnement ordinaire de la classe.
- Le code apporte son lot de contraintes et ne peut – sauf à prendre le risque de la rigidité la plus opprimante et la plus étouffante, caractéristique des bureaucraties les plus formalistes ou des disciplines militaires les plus tatillonnes – se substituer entièrement aux habitudes incorporées et aux interdits tacites.
D’ailleurs, lorsqu’on leur demande si telle ou telle de leurs pratiques est codifiée, réglée et écrite, les enseignants finissent, à un moment ou à un autre, par dire : « Ça, ils le savent » (sous-entendu : « Inutile de l’écrire, car cela est devenu une évidence de la vie de groupe »).
Dans les deux cas, les avantages et les inconvénients existent :
- limitation de l’arbitraire, mais rigidité possible du côté du système objectivé vs souplesse,
- mais risque d’arbitraire du côté de la décision pragmatiquement ancrée.
Entre ces deux extrêmes,
le modèle politique de la « négociation collective » permanente, vers lequel semblent vouloir tendre idéalement certaines classes, n’est assimilable ni au modèle juridique fort qui privilégie le recours à des règles explicites relativement stables, ni au modèle de la souveraineté enseignante (bienveillante ou pas). Il privilégie la discussion collective sur chaque cas qui se présente.
- Le pôle cognitif de l’autonomie renvoie quant à lui à des pratiques scolaires telles que
- la lecture silencieuse,
- la mise en place de consignes écrites qui doivent être lues avec précision et rigueur,
- l’utilisation de fichiers d’exercice (qui peuvent être autocorrectifs), du dictionnaire (pour chercher le sens de mots inconnus ou vérifier l’orthographe de mots connus) ou de la bibliothèque d’école (à titre de recherche documentaire),
- ou encore l’habitude de ne pas répondre immédiatement aux questions des élèves afin qu’ils ne deviennent pas dépendants de l’enseignant, mais qu’ils fassent l’effort de chercher par eux-mêmes les informations nécessaires à la réalisation de l’exercice.
L’élève autonome est l’élève qui sait faire un exercice seul, sans l’aide du maître, sans poser de questions, qui sait lire silencieusement et résoudre par lui-même un problème, etc.
Les expressions utilisées par les enseignants ou les inspecteurs montrent que « travail autonome » est souvent un strict équivalent de « travail individuel ».
Il en va ainsi par exemple lorsqu’un inspecteur écrit en 1998 dans un rapport :
« L’emploi du temps comprend les études dirigées qui permettent un travail autonome ou par deux autour de la lecture. »
« Travailler en autonomie » signifie alors « travailler seul » et l’autonomie la plus fréquemment pensée à l’école, et plus largement dans le monde social, est fondamentalement une autonomie individuelle.
Par exemple, chacun doit être désormais capable de lire et d’écrire de façon autonome et l’idée d’une autonomie collectivement assurée (dans des familles restreintes ou élargies, dans des réseaux sociaux, etc.) n’a pas cours dans les discours contemporains qui privilégient les compétences individuellement acquises.
- Tout se passe comme si le monde social était un théâtre où ne se jouaient que des face-à-face individus isolés-situations ;
- comme s’il était réductible à une série de comportements individuels autonomes et atomisés.
L’autonomie scolaire suppose de savoir lire pour une raison essentielle : les règles de vie, les affichages didactiques et les ressources sur lesquels les élèves sont censés s’appuyer pour construire leur savoir et gouverner leur action sont de nature écrite.
L’autonomie scolaire n’est pas une « autonomie générale », une capacité générale et transversale à s’adapter à n’importe quel type de situation, mais une autonomie spécifique articulée à une culture écrite scolaire et à des dispositifs objectivés.
Gagner de l’autonomie dans certains domaines de la vie pratique est parfois évoqué par les enseignants (savoir s’habiller seul, lacer ses chaussures, etc.), particulièrement en ce qui concerne les élèves les plus petits (en petites et moyennes sections de maternelle), mais est nettement moins classant que l’autonomie par rapport aux règles disciplinaires et par rapport aux savoirs écrits.
De même, ne pas répondre immédiatement aux sollicitations des élèves lorsqu’ils commencent un exercice, lorsqu’ils doivent réfléchir à un problème ou mener une recherche, c’est les habituer à déchiffrer les consignes ou les énoncés des problèmes seuls, c’est-à-dire à faire face seuls aux informations écrites dont ils disposent.
La lecture silencieuse apparaît ainsi comme la pierre angulaire de l’autonomie scolaire en matière d’accès aux savoirs.
- L’autonomie dans la construction des savoirs passe donc par l’usage, non guidé par l’adulte, d’instruments de travail tels que les fichiers d’exercice, le dictionnaire ou certains manuels.
Une pédagogie qui contourne le dispositif « frontal » de la leçon magistrale (où le maître parle et écrit) pour mettre en place des activités différentes selon les élèves ou les groupes d’élèves et privilégier le travail « autonome » (individuel) sans aide directe, ne peut faire autrement que de s’appuyer sur des dispositifs de savoirs objectivés tels que les fichiers d’exercices.
- Avec des élèves habitués à un tel fonctionnement et sachant lire silencieusement, la classe peut « tourner » sans que l’adulte soit sollicité systématiquement.
Du point de vue des « dépossessions » ordinaires qui caractérisent les pédagogies moins centrées sur l’autonomie de l’enfant, il faut évoquer la non-maîtrise par les élèves de l’emploi du temps journalier, hebdomadaire ou mensuel. L’emploi du temps est alors essentiellement affiché pour l’inspecteur (manière d’afficher sa mise en conformité eu égard aux contraintes horaires du programme scolaire) et des éventuels remplaçants en cas d’absence. Les élèves entrent donc dans un rythme scolaire qui a été pensé en dehors d’eux et sur lequel ils n’ont aucune prise, ni réelle (aucune possibilité de modification) ni symbolique (pas de visualisation de cet emploi du temps qui leur permettrait de se repérer dans le temps).
La pédagogie de l’autonomie revient donc sur cette dépossession. On explicite oralement l’emploi du temps du jour. On écrit au tableau ou on affiche l’emploi du temps du jour ou de la semaine. On le fait écrire aux élèves, en les dotant parfois d’un instrument, le cahier de textes, réservé jusque-là aux plus « grands » (ceux qui entrent au collège).
- On donne la possibilité aux élèves de personnaliser leur emploi du temps en faisant des choix dans une série d’activités.
- On leur confère le droit de modifier l’emploi du temps existant ou de participer à sa constitution lors des conseils d’élèves.
- Une fois encore, l’élève est mis en position d’avoir à maîtriser des choses qui lui échappaient jusque-là et que seuls les enseignants avaient le pouvoir de créer et de modifier.
- On tend alors vers une distribution plus égalitaire des moyens de maîtrise du temps, remettant en question le monopole de l’enseignant.
Dès lors qu’ils sont « installés dans cette attitude » à l’égard de l’emploi du temps scolaire, comme le dit une enseignante, les élèves peuvent demander des explications aux enseignants qui ne respectent pas l’emploi du temps.
Le coût de ce type de « mesure » scolaire réside donc dans la nécessité pour l’enseignant de justifier, d’expliquer ce qui relevait de son arbitraire et allait jusque-là de soi.
Enfin, qui dit maîtrise d’un emploi du temps et, surtout, gestion du temps, dit gestion possible d’une charge de travail.
- Les élèves sont ainsi habitués à gérer, sur une période de temps déterminée, un certain volume de travail.
Plan de travail, contrat de travail, gestion du temps de travail : un vocabulaire et des pratiques peu habituels, plus ordinairement associés au monde du travail, font leur apparition dans les discours des enseignants.
Plutôt que de donner systématiquement des exercices à faire « au coup par coup », les enseignants essaient d’habituer les élèves à prévoir, à s’organiser, à planifier leur propre activité.
De plus, la gestion, le plan et le contrat sont individuels et permettent la mise en place d’une pédagogie différenciée, voire individualisée.
Dépersonnalisation du savoir et du pouvoir
Un élève placé « au centre du système », un élève actif, en recherche, un élève réfléchissant, découvrant par lui-même et s’organisant, opérant des choix, s’auto-évaluant et, parfois, s’autocorrigeant, un élève ayant contribué à la fixation des règles communes et, de ce fait, les respectant, voilà donc l’image de l’élève qui se dégage du langage pédagogique associé à la notion d’autonomie.
- L’action n’est plus pensée comme unique (celle de l’enseignant sur l’élève) ;
- elle est démultipliée, car on reconnaît désormais aux élèves des capacités d’action, de jugement, d’appréciation, d’évaluation ou d’organisation.
D’où la critique de la pédagogie frontale, de la centralité du maître et du cours magistral où l’enseignant est perçu comme se distinguant radicalement des élèves et leur faisant face comme un souverain fait face à ses sujets, comme un savant fait face à des ignorants, comme un être civilisé fait face à des êtres en voie de civilisation (sauvages).
- L’autonomie est un hommage rendu à la dépersonnalisation du pouvoir et du savoir, une forme de dépendance historique spécifique.
- La personne du maître disparaît au profit de dispositifs pédagogiques objectivés.
- La forme scolaire d’exercice de l’autorité à l’école se distingue en ce sens de toutes les formes de pouvoir fondées sur la volonté arbitraire d’une personne.
Respectant les règles (côté politique) et comprenant les consignes et la finalité des tâches scolaires (côté cognitif), l’élève démontre à chaque instant qu’il est parfaitement adapté à l’univers scolaire et son comportement ne réclame aucune intervention extérieure (rappel à l’ordre disciplinaire ou aide cognitive).
On pourrait dire que ce qui est mal vu par l’école, c’est la dépendance inter-personnelle, de même que les libertés prises à l’égard des règles de vie collective (élève indiscipliné) ou des savoirs enseignés (élève indifférent aux savoirs scolaires).
En fait, on demande de plus en plus aux élèves d’intérioriser le regard scolaire (les catégories de jugements scolaires des productions et des comportements, les savoirs scolaires, les règles scolaires, les intérêts cognitifs spécifiquement scolaires), d’en être les porteurs zélés.
L’élève n’est pas présumé « coupable », au sens où il serait a priori soupçonnable de non-intérêt scolaire ou de volonté de contourner ou de transgresser les règles de vie scolaires. Il est, au contraire, pensé comme pouvant être responsable de ses actes, capable d’autodétermination et de choix raisonnables, porteur de motivations (appétences) pour les activités scolaires et de catégories scolaires de perception (compétences).
- Le pouvoir de jugement des performances et des comportements à la fois se déconcentre et se dépersonnalise (le maître n’est plus le seul garant de l’ordre politique et cognitif scolaire), tout en se personnalisant (s’incarnant) en chacun des élèves.
Le savoir comme le pouvoir se dépersonnalisent dans la mesure où ils se détachent de la personne de l’enseignant et de sa subjectivité.
En prenant en charge des tâches (production de règles, sanctions, responsabilités au sein de la classe, gestion de son temps, corrections, évaluations, choix, etc.) qui étaient exclusivement assumées par les adultes,
- les élèves ne peuvent plus désormais attribuer le pouvoir et le savoir à une personne.
Une série de « pouvoirs » enseignants (sur le temps, sur l’organisation matérielle et pédagogique, sur les règles de comportements et l’évaluation des savoirs) sont idéalement distribués à tous, mobilisables par tous, chacun devant montrer qu’il a du « pouvoir » sur la situation scolaire,
- c’est-à-dire, en définitive, qu’il a parfaitement incorporé les règles et habitudes propres à cet univers.
Finalement, lorsque les conditions de fonctionnement d’un tel modèle sont réunies (des élèves socialement préparés à cela par leurs familles, des conditions matérielles-institutionnelles favorables), l’institution scolaire dispose d’un puissant moyen d’implication ou d’intéressement de l’élève.
Obstacles et stigmatisation
La pédagogie visant l’autonomie de l’enfant parvient parfois, par une réflexion et un investissement important en matière d’objectivation des savoirs,
- à surmonter le problème qu’a rencontré historiquement la méthode individuelle d’enseignement avant que ne s’invente la méthode simultanée (notamment dans les écoles lassalliennes).
En effet, dans les petites écoles rurales d’Ancien Régime par exemple,
- le régent chargé d’enseigner pratique un enseignement purement individuel de la lecture, de l’écriture et parfois du calcul dont la rentabilité pédagogique est très faible :
- pendant qu’il fait lire et parfois écrire un élève, les autres jouent, lisent ou se chamaillent.
Rien n’a été prévu et pensé pour faire travailler ceux qui ne sont pas directement sollicités par l’enseignant. C’est la codification de l’ensemble des pratiques scolaires – des savoirs enseignés aux méthodes d’enseignement en passant par les moindres aspects de l’organisation de l’espace et du temps scolaires – qui va rendre possible une systématisation accrue et un enseignement de type simultané.
Comme l’écrit Pierre Lesage :
« Les écoles vouées au mode individuel sont encore, après le milieu du xixe siècle, les plus nombreuses. Toutes les statistiques en font foi. On lit peu, très peu, sans méthode définie et généralement sans manuel ou matériel communs. Chacun apporte son livre, son almanach. Le maître aide à déchiffrer, mais il n’est pas toujours disponible. »
- De toute évidence, la méthode individuelle est une « méthode » qui repose sur un manque de dispositifs objectivés un tant soit peu standardisés.
Et c’est encore grâce à un nouveau travail d’objectivation que l’école peut passer d’une méthode simultanée à une méthode différenciée sans retomber dans les errances (et l’inefficacité pédagogique) de la méthode individuelle. C’est parce qu’on a pensé un dispositif pédagogique différencié complexe, parce que les élèves sont habitués à travailler seuls, grâce à un matériau pédagogique important (fichiers d’exercices, livres, manuels, dictionnaires, feuilles polycopiées, affichages des consignes et de certains énoncés de savoirs, inscription des consignes au tableau, etc.), que
- le maître peut circuler d’un groupe à l’autre ou s’attarder plus longuement auprès des élèves les plus « faibles », sans que son absence n’entraîne l’arrêt immédiat de toute activité pédagogique.
Nous avons vu que, d’une manière générale,
- l’autonomie de l’élève apparaît fondamentalement liée aux consignes écrites, c’est-à-dire à un rapport particulier à la lecture et, au fond, à la lecture silencieuse et solitaire, non guidée. L’autonomie scolaire n’a donc de sens que par rapport à une série de dispositifs pédagogiques objectivés (règles ou informations écrites, manuels, fichiers, dictionnaires, cartes, tableaux, listes, modes d’emploi, ordinateurs) et de techniques pédagogiques (apprentissage de la lecture silencieuse, absence de réponses aux questions posées, systèmes d’autocorrection, imposition de l’usage autonome du dictionnaire, etc.) articulées à ces dispositifs objectivés.
En ce sens,
l’autonomie suppose une dépendance vis-à-vis de dispositifs objectivés qu’il s’agit de s’approprier pour aller seul vers le savoir.
L’ensemble des techniques qui conduisent (contraignent) à l’autonomie est constitutif d’un rapport au pouvoir en même temps que d’un rapport au savoir.
- L’autonomie est donc une forme de dépendance historique spécifique
- et l’école est le lieu – commun et sans doute principal – où tente de s’opérer l’apprentissage progressif de ce nouveau rapport au pouvoir et au savoir.
L’autonomie socialement construite ne signifie aucunement « indépendance absolue » ou « liberté individuelle » face aux « contraintes sociales » (à la « société »).
Or, les situations scolaires évoquées ne sont pas étrangères à des situations de communication extra-scolaires fréquentes du type : savoir se repérer dans une ville à l’aide d’un plan, savoir se diriger dans une gare ou dans un réseau de métro à l’aide de plans, de pancartes, de listes ordonnées de stations, savoir acheter des tickets de métro en se servant d’un distributeur automatique qui oriente le client en donnant à lire des consignes, savoir répondre à un questionnaire administratif, une feuille d’impôts, un formulaire de sécurité sociale, savoir lire les tableaux d’horaires de trains, savoir suivre un règlement ou un mode d’emploi, etc. Nous sommes de plus en plus souvent amenés à faire face à des messages, des consignes, des informations, des demandes ou des conseils écrits, sans destinataire précis, hors de tout face-à-face avec d’autres personnes : avertissements, consignes ou informations affichés sur les autoroutes, sur les panneaux d’informations urbains, dans les gares ou les aéroports, ou bien encore livrés par les machines d’information permettant de réserver des billets de train ou des tickets de bus ou de métro, de s’informer sur des horaires, etc. On pourrait parfaitement montrer, par exemple, comment la thématique aujourd’hui répandue de l’« autonomie de l’usager des bibliothèques » s’articule à des dispositifs objectivés d’informations et de savoirs. Pour rendre autonome l’usager des bibliothèques, il faut travailler la « signalétique » de la bibliothèque, fournir des plans de la bibliothèque, installer des bornes d’orientation à différents endroits du bâtiment, mettre en place des bornes interactives (ordinateurs) de manière à permettre à l’usager de consulter directement les catalogues ou d’accéder à Internet. À la différence d’univers qui fonctionnent à la relation personnelle, ce type d’univers institutionnels repose sur un investissement important en termes de dispositifs de savoirs et d’informations objectivés.
On a affaire idéalement ici à une véritable économie de moyens et d’énergie qui généralise des dispositifs ou des techniques que les enseignants connaissent bien : l’écriture des consignes ou des instructions au tableau noir a évité dans l’histoire au maître bien des paroles, bien des redites, bien des pertes d’énergie. Depuis les débuts de l’école primaire en France (au xviie siècle), on a veillé à ce que les savoirs enseignés, les méthodes d’enseignement et les moindres aspects de l’organisation de l’espace et du temps scolaire fassent l’objet d’un travail d’écriture permettant ainsi une systématisation de l’enseignement et surtout un enseignement simultané. Et c’est parce que tout a été écrit, prévu, contrôlé, codifié d’avance (syllabaires, tableaux de lecture, d’écriture et d’arithmétique, tableaux de sentences morales ou manuels scolaires) que des maîtres bien formés peuvent en partie s’effacer au profit de fonctionnements scolaires très stricts.
Et il est intéressant d’observer les effets de ces transformations dans les formes d’exercice du pouvoir qui accompagnent cette disparition du contact interpersonnel : le savoir (lorsqu’il est question de savoir) se dépersonnalise, mais c’est le cas aussi du pouvoir. Comment, en effet, protester devant une machine ou face à un message affiché ? On peut même apprendre à faire docilement la queue avec des tickets numérotés pris en entrant dans les halls des services administratifs ou dans certains rayons de grands magasins, de même que nous sommes désormais habitués à occuper des places de train ou d’avion numérotées.
- De tels dispositifs dépersonnalisés permettent d’éviter les conflits inter-personnels en contournant les jugements subjectifs ; ils substituent un système objectif d’attribution de « tours » ou de « places » à des négociations intersubjectives incertaines, aléatoires et potentiellement conflictuelles.
En tant que lieu d’apprentissage de l’autonomie, l’école se heurte néanmoins à deux grands types d’obstacles pour atteindre ses objectifs : l’un est lié aux coûts (temporels et financiers) de ce type de pédagogie et l’autre dépend des propriétés dispositionnelles des élèves.
- Tout d’abord, l’énergie passée à l’investissement initial ne permet que très rarement de faire d’énormes gains d’énergie par la suite et l’enseignant n’a guère l’occasion d’être ce simple « guide » ou ce simple « facilitateur » rêvé par les pédagogues, qui s’appuierait sur une autonomie largement pré-existante.
- L’un des puissants obstacles pratiques à la mise en place d’une pédagogie de l’autonomie est son caractère particulièrement chronophage et/ou financièrement très coûteux.
En effet, les enseignants témoignent du fait que cette démarche implique un lourd travail de préparation pédagogique de manière à créer les outils que les élèves vont pouvoir utiliser de manière autonome. Reposant sur un fort investissement en matière de dispositifs de savoirs et d’informations objectivés (fichiers ou affichages compensant la non-présence enseignante), ce type de pédagogie suppose l’achat de fichiers (souvent très coûteux relativement aux moyens des classes), la photocopie de fichiers existants (coûteuse en argent et en temps de photocopie) ou la création personnelle de fichiers (coûteuse en temps).
De même, l’investissement que demande une pédagogie nécessairement différenciée est grand : il faut déployer une énergie très importante pour prévoir des exercices différents destinés à des élèves de niveaux différents.
- Comme dans le mythe de Sisyphe, le problème que rencontre l’enseignant dans l’accumulation d’un stock de dispositifs pédagogiques (affichages didactiques, fichiers d’exercices ou coins différenciés), c’est que, non seulement en début de carrière mais aussi à l’occasion de chaque changement de classe, il faut – problème de manque d’habitude en moins – tout recommencer à zéro.
- Inutile de préciser que les premières années très mouvementées des jeunes professeurs d’école, qui changent chaque année de classe et/ou d’école, ne sont jamais propices à la constitution d’un tel patrimoine pédagogique objectivé et, du même coup, des habitudes qui y sont attachées.
Mais ces pédagogies de l’autonomie reposent surtout sur une loi tacite que l’on pourrait formuler de la manière suivante :
« Que celui qui entre à l’école porte en lui les dispositions à agir et à penser dans le sens scolairement attendu. »
Or, nombreux sont les élèves jugés « peu ou pas autonomes » par les enseignants qui utilisent même parfois l’expression « élève non autonome » comme un strict équivalent d’« élève en échec scolaire ».
Lorsque l’« autonomie » devient une catégorie publique de perception positive des comportements et des individus, elle est du même coup productrice de stigmates : ceux qui ne parviennent pas à « se débrouiller » seuls dans les cadres (scolaires ou autres) qu’on leur impose sont souvent « assistés » par d’autres personnes (parfois même des « assistantes sociales ») et vite considérés comme des « assistés ».
Il n’y a donc rien de plus contraignant que l’injonction généralisée à l’autonomie, qui, paradoxalement, semble à première vue s’opposer à toute forme de dépendance et de contrainte.
L’étude des effets réels des dispositifs socialisateurs visant à façonner des types d’hommes autonomes ne serait pas complète si elle faisait l’économie de l’examen des dispositions incorporées – adéquates ou inadéquates – des socialisés.
- Contrairement aux discours sociologiques contemporains qui évoquent des injonctions un peu générales à « être autonome », le sociologue devrait toujours préciser la nature et l’objet de l’autonomie (autonome comment et par rapport à quoi ?),
- ainsi que l’inégale probabilité, parmi les différentes catégories de la population, de posséder les dispositions sociales (mentales et comportementales) favorables à cette autonomie.
Et puisqu’il est bien question aussi d’inégalités, le sociologue ne doit pas non plus manquer de mettre au jour les nouvelles formes de stigmatisations sociales (personnes autonomes/personnes non autonomes) produites par ces nouveaux dispositifs de savoirs (ou d’informations) et d’exercice du pouvoir. »
– Lahire, B. (2007). 12. Fabriquer un type d’homme « autonome » : analyse des dispositifs scolaires. Dans : , B. Lahire, L’esprit sociologique (pp. 322-347). La Découverte.

« « Un peuple est d’autant plus démocratique que la délibération, que la réflexion, que l’esprit critique jouent un rôle plus considérable dans la marche des affaires publiques.
Il l’est d’autant moins que l’inconscience, les habitudes inavouées, les sentiments obscurs, les préjugés en un mot soustraits à l’examen, y sont au contraire prépondérants. » – É. Durkheim, Leçons de sociologie. Physique des mœurs et du droit, 1890-1900.
« La sociologie conquiert lentement son droit de cité dans l’enseignement. » – C. Bouglé, Qu’est-ce que la sociologie ?, 1925.
Alors que le combat pédagogique le plus urgent pour les sciences sociales paraît se situer au niveau du lycée où leur légitimité, à côté des « sciences » et des « humanités », semble pouvoir être remise en question, on peut se demander s’il est bien raisonnable (rationnel et stratégique) de s’interroger sur la possibilité d’un enseignement des sciences sociales (sociologie et anthropologie notamment) dès l’école primaire.
- N’est-il pas utopique de s’« attaquer » au primaire, alors même qu’à l’université les sciences qualifiées, dans la plus grande tradition mythique, de « dures » renvoient encore les sciences du social au statut flou mais dévalorisant de sciences « molles » ?
Mais il est parfois des utopies réalistes. Ces utopies nécessitent, tout d’abord, la production d’arguments pour convaincre de l’importance de l’enseignement précoce des sciences sociales pour la vie collective et le développement mental et comportemental des enfants. Ce travail d’argumentation doit être accompli avec le plus grand sérieux, car il permet de répondre en partie à la question fondamentale que devrait se poser tout chercheur en sciences sociales : « Pourquoi des sciences sociales ? » ou encore « À quoi servent les sciences sociales ? ».
Dans ce dernier chapitre, je soutiendrai donc que
l’enseignement pédagogiquement adapté des sciences sociales à l’école primaire – comme celui de l’histoire ou la géographie, dont on n’oserait plus remettre aujourd’hui en cause la présence légitime au sein du cursus primaire malgré leur statut de savoirs savants – constitue une réponse adéquate (et plutôt meilleure que d’autres) aux exigences modernes de formation scolaire des citoyens.
[…]
La peur que certains éprouvent à l’idée de voir entrer dans le cursus officiel des thèmes « idéologiques » (controversés ou polémiques) ou simplement « sociaux », conduit paradoxalement
- à laisser les élèves démunis face à tous les pourvoyeurs (producteurs ou diffuseurs) d’idéologie qui se sont pourtant multipliés au cours des dernières décennies dans nos sociétés fortement scolarisées.
Le rôle des spécialistes de la communication politique (mais il faudrait plutôt parler de « manipulation politique ») ou du marketing, des publicistes, des demi-savants, des rhéteurs plus ou moins habiles, bref, de tous les sophistes des temps modernes, n’a cessé de croître, et il serait urgent de transmettre, le plus rationnellement possible et auprès du plus grand nombre, les moyens de déchiffrer et de contester les discours d’illusion tenus sur le monde social.
- Mauvais calcul républicain qui conduirait, par volonté de maintien d’une pseudo-neutralité scolaire, à souhaiter garder hors des murs de l’école les « problèmes » ou « faits » sociaux et idéologiques qui se posent et s’imposent.
Pourquoi ne pas enseigner les outils et les manières de penser que les sciences sociales ont constitués efficacement depuis plus de cent ans plutôt que de laisser les futurs citoyens construire (ou pas) leur savoir sur le monde social au sein de leur structure familiale ou dans les cadres traditionnels de la socialisation (enseignement religieux, socialisation politique et syndicale, etc.) ?
- Et l’on jugera ici qui, du « retour à l’enseignement de la morale », régulièrement proposé en matière de « formation à la citoyenneté », ou de l’introduction pédagogiquement adaptée d’un certain nombre d’attitudes et d’outils inventés par les sciences sociales, est le plus adapté aux exigences des temps modernes…
Alors que nous sommes désormais capables d’enseigner l’attitude scientifique à l’égard du monde physique et naturel, nous laissons tranquillement se développer des dispositions magiques et pré-rationnelles vis-à-vis du monde social.
- Norbert Elias a bien montré que, au cours de l’histoire, les hommes ont progressivement conquis une attitude de distanciation, tout d’abord par rapport aux phénomènes naturels puis, plus difficilement, à l’égard des phénomènes sociaux.
- En effet, les hommes des sociétés pré-scientifiques ont été matériellement et cognitivement impuissants face aux « caprices de la nature ».
La science, elle, s’inscrit dans un processus de distanciation et de contrôle des affects et, par conséquent, dans un processus de civilisation.
En donnant les moyens de ne pas prendre ses désirs pour la réalité, de voir les choses de manière moins directement attachée à la position de celui qui voit, l’attitude scientifique permet de sortir progressivement de l’implication (involvement) de l’homme vis-à-vis de la réalité :
« Les membres des sociétés où règne la science ne sont généralement pas conscients du haut degré de distanciation, de maîtrise de soi et de neutralité affective requis pour reconnaître que des événements qui entraînent pour vous plaisir ou souffrance – et surtout de la souffrance – peuvent être le résultat tout à fait non intentionnel de causes inanimées, de mécanismes naturels sans but ou de ce que nous appelons le “hasard”. »
- Mais ce que les hommes ont réussi vis-à-vis de la nature avec force et efficacité, ils n’ont toujours pas su complètement le rééditer concernant le monde social.
- Elias note, à juste titre, un affaiblissement de l’attitude distanciée lorsqu’on passe du rapport à la nature au rapport au monde social.
- Il y a là un défi que l’École serait aujourd’hui en mesure de relever.
3) Par leur contenu et leur forme, ces sciences sociales ne sont-elles pas intrinsèquement vouées à n’intervenir qu’au niveau d’une formation supérieure ?
Si l’on pense immédiatement théories, concepts ou « grands auteurs », il est bien évident que sociologie et anthropologie ne sont pas transmissibles dans le cadre de l’école primaire.
Il va, par conséquent, de soi que c’est l’adaptation raisonnée d’un certain nombre d’outils et d’acquis fondamentaux de ces sciences qu’il s’agit d’enseigner et non une culture savante-universitaire :
- les commentaires savants sur la sociologie compréhensive de Max Weber ou l’anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss n’ont, en effet, rien à faire à pareil niveau du système scolaire.
La traduction de « savoirs savants » en « savoirs scolaires » ayant réussi à l’école primaire pour des sciences de l’homme proches de l’anthropologie et de la sociologie (l’histoire et la géographie) comme pour des sciences encore plus abstraites et formelles (les mathématiques), on ne voit pas ce qui empêcherait sociologues et anthropologues d’opérer le même travail.
En revanche, que penser de programmes et instructions officiels qui exigent d’enseigner les « institutions de la République » et leur fonctionnement : « – la République, ses symboles et sa devise ; – le président de la République ; son élection au suffrage universel ; – les parlementaires ; l’élaboration et le rôle de la loi ; – la justice ; – les élus locaux, en particulier le maire de la commune ; – un exemple de service public » ?
- Tout se passe comme si l’imagination pédagogique en la matière oscillait entre la leçon de morale et le cours de sciences politiques sur les institutions de la République…
4) N’est-il pas trop difficile, pour des enfants entre 6 et 11 ans, de se construire au sein de cultures (nationale, régionale, familiale, scolaire, etc.) et d’être habitués, dans le même temps, à prendre distance ou à développer une certaine réflexivité par rapport à ces mêmes ancrages culturels ?
Il est courant de concevoir les instruments de réflexivité comme des outils qui n’interviennent que « dans un second temps », après une phase d’apprentissage, d’inculcation ou d’incorporation nécessairement pré-réflexive.
Il serait ainsi impossible d’apprendre la théorie de la marche en même temps que l’on apprend à marcher (c’est le meilleur moyen, dit-on généralement, pour tomber…).
La réflexivité viendrait seulement après que l’apprentissage « à l’aveugle » (non conscient) a été mis en place.
- Il est vrai que, au cours de son processus de socialisation, l’enfant n’a pas la possibilité d’intérioriser sa culture et d’apprendre dans le même mouvement son caractère arbitraire d’un point de vue culturel, historique ou civilisationnel.
Il faut bien, en effet, qu’il commence à voir le monde à partir d’un « point de vue » quelconque pour que l’on puisse commencer à lui faire appréhender la diversité des « points de vue » ; il est nécessaire qu’il construise sa personnalité à partir d’un point particulier du monde social, du temps et de l’espace, c’est-à-dire qu’il s’inscrive dans une culture, un lieu et un temps donnés, pour qu’il soit possible de lui faire comprendre la « relativité » de sa situation culturelle, temporelle et spatiale.
Mais cela signifie-t-il qu’il faille attendre le lycée pour commencer à acquérir l’habitude d’une certaine décentration par rapport à son (ou plutôt ses) milieu(x) de vie, le raisonnement comparatif ou la pensée relationnelle en matière de faits sociaux ? Attendre le lycée pour constater que les habitudes non scientifiques de pensée sur le monde social empêchent très sérieusement – et comment pourrait-il en aller autrement après tant d’années passées à ne rien construire en la matière ? – l’installation de nouvelles habitudes de pensée attachées aux sciences du monde social ?
Si l’on peut facilement admettre le fait que l’enfant doit d’abord « savoir parler » avant d’apprendre à lire, à écrire et à constituer la langue en objet d’étude, il n’en reste pas moins que le système scolaire français enseigne aujourd’hui, et ce dès l’âge de 6 ans, la lecture, l’écriture et des rudiments de grammaire française.
La réflexivité linguistique serait-elle moins abstraite que la réflexivité à l’égard du monde social ?
À bien y réfléchir, on pourrait être conduit à penser que c’est la constitution de la langue comme objet d’étude et de réflexion qui s’avère un exercice bien plus étrange encore pour les enfants.
La construction de soi à travers diverses instances de socialisation ne serait donc pas incompatible avec l’aptitude acquise dès l’école primaire à considérer le monde social à partir d’une pensée moins magique et plus scientifique.
- L’idée selon laquelle enseigner réflexivité et recul dans le temps même de la formation morale et culturelle de l’enfant constituerait une opération psychologiquement déstabilisatrice est, au fond, la manifestation d’un profond ethnocentrisme.
Penser qu’il faut construire ses « repères », ses « marques », son « identité », avant même de pouvoir commencer à prendre conscience de la diversité sociale (culturelle, civilisationnelle, politique, etc.) est, en effet, le meilleur moyen de conduire à toutes les formes d’ethnocentrisme, consistant à « répudier purement et simplement les formes culturelles : morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions ».
- L’état actuel du monde social exigerait davantage d’imagination et devrait, notamment, amener à penser que l’identité individuelle et la personnalité de l’enfant ne peuvent plus désormais se construire hors de la réflexivité que leur offrent les sciences du monde social.
L’accoutumance aux différentes formes de l’enquête
Comme je l’ai dit précédemment,
l’objectif d’un enseignement des sciences sociales (sociologie et anthropologie) à l’école primaire ne devrait pas être essentiellement celui de diffuser une connaissance de nature encyclopédique.
- Il ne s’agit pas, dans mon esprit, d’enseigner des « théories », des « méthodes » ou des « auteurs »,
- mais de transmettre des habitudes intellectuelles fondamentalement liées à ces disciplines.
Comment transmettre de telles habitudes intellectuelles à l’école primaire sinon par l’étude de « cas », d’« exemples » visibles de différences culturelles (e. g. comparer les différences alimentaires d’une société à l’autre en ramenant ces différences aux conditions d’existence des populations, au climat, au type d’agriculture, etc.), ainsi que par la participation active des élèves à de vraies enquêtes empiriques.
De même que les élèves prennent l’habitude de faire quotidiennement des relevés de température pour objectiver et prendre ainsi conscience des phénomènes météorologiques, ils pourraient être entraînés à l’observation et à l’objectivation du monde social. Si l’expérimentation est au fondement des sciences de la matière et de la nature, l’esprit d’enquête est, lui, à la base de toute science du monde social.
L’objectivation ethnographique
Une des premières qualités que le « regard sociologique » suppose, est une capacité de description et de narration de ce qu’il est possible d’observer directement (paysages, lieux, décors, objets, personnages, manières de dire ou de faire), c’est-à-dire lorsque nous sommes armés de nos sens et de nos catégories de perception du monde social.
La description et la narration étant au programme de l’école primaire, il ne serait pas impensable d’orienter parfois ces tâches vers l’étude des comportements réellement observés (plutôt qu’imaginaires) : comportements des élèves dans la cour de récréation (les filles et les garçons jouent-ils aux mêmes jeux ? les élèves de CP jouent-ils aux mêmes jeux que ceux de CM2 ?), scènes de films disponibles en cassettes vidéo (et que l’on peut voir et revoir autant de fois qu’il est nécessaire), etc.
- Dépourvu de catégories lexicales, l’œil de l’observateur ne peut trouver les moyens de se fixer avec précision sur les réalités observées.
- Ainsi, la qualité d’une narration ou d’une description dépend, en partie, de la richesse lexicale possédée.
- La description et la narration de scènes réellement observées (et non d’un fait ou d’éléments imaginaires) sont donc l’occasion d’apprendre à nommer les choses, à discriminer les situations, à désigner des gestes, des mimiques ou des attitudes.
- C’est aussi l’occasion de montrer que les comportements individuels ne se comprennent pas de manière isolée, mais toujours « en rapport à », « en réaction vis-à-vis de », « en interaction avec » d’autres éléments du contexte (autres individus, objets, paroles ou gestes).
De ce point de vue, les enseignants (et les manuels scolaires) pourraient s’inspirer des exigences de la littérature naturaliste qui vise à comprendre l’homme (et sa psychologie) en le rapportant à ses milieux d’appartenance.
L’objectivation « statistique »
S’adaptant à la réalité sociale contemporaine, l’école primaire a déjà intégré dans ses activités de production écrite « la réponse à un questionnaire ».
- Les élèves pourraient tout aussi bien être encouragés à créer collectivement des questionnaires sur des thèmes qu’ils auraient choisis.
- Ils pourraient, de la même façon, faire passer ces questionnaires et aboutir, en fin de compte, à certains comptages simples (la notion de proportion étant abordée dès le cours moyen) pour apprendre l’esprit d’enquête et acquérir le sens et l’intérêt des enquêtes sur les (relativement) grands nombres.
- On pourrait imaginer, par exemple, que les élèves d’une classe conçoivent une enquête par questionnaires sur l’ensemble des élèves de leur école (e. g. sur les goûts musicaux des élèves ; sur la possession ou non de différentes catégories d’animaux domestiques ; sur leur opinion quant à certains aspects de la vie collective, etc.).
L’entretien sociologique : un exercice démocratique
À bien considérer la pratique des chercheurs en sciences sociales, on peut tout à fait soutenir que l’entretien de type sociologique (qui s’oppose aux entretiens bureaucratique, policier, d’embauche, etc.),
- qui cherche à comprendre et non à juger, qui oblige à se mettre à la place de la personne interviewée,
- qui suppose d’écouter attentivement ce que l’interlocuteur a à dire,
- voire de l’aider à le dire,
- et non de lui imposer ses propres catégories sociales de jugement ou de l’interrompre sans arrêt, etc., constitue un véritable exercice démocratique.
Il s’agit d’une technique qui permet réellement d’« atteindre », en acte, le classique (mais flou) « respect des autres ».
Apprendre à être attentif, à développer une écoute patiente, compréhensive et curieuse, à relancer une discussion au bon moment, voilà un moyen concret d’acquérir certaines valeurs qui, laissées à l’état de slogans démocratiques, relèvent du simple (et inutile) « prêchi-prêcha ».
La nécessité historique de l’enseignement des sciences du monde social
- J’ai tenté d’expliciter ce qui fait, selon moi, l’intérêt et même la nécessité historique de l’enseignement des sciences du monde social dès l’école primaire.
Ces sciences, et notamment parmi elles la sociologie et l’anthropologie, se sont historiquement construites contre les naturalisations des produits de l’histoire, contre toutes les formes d’ethnocentrisme fondées sur l’ignorance du point de vue (particulier) que l’on porte sur le monde, contre les mensonges délibérés ou involontaires sur le monde social.
- Pour cette raison, elles me paraissent d’une importance primordiale dans le cadre de la Cité démocratique moderne.
- Elles se sont peu à peu, au cours de leur histoire, imposé à elles-mêmes des contraintes souvent sévères en matière de recherche empirique de la vérité, dans la précision et la rigueur apportées à l’administration de la preuve, et se distinguent par là même de toutes les formes d’interprétation hasardeuses du monde.
Passant de la philosophie sociale, qui pouvait disserter de manière générale et peu contrôlée, à la connaissance théoriquement-méthodologiquement armée et empiriquement fondée du monde social, sociologues et anthropologues ont ainsi inventé une forme rationnelle de connaissance sur le monde social qui peut légitimement prétendre à une certaine vérité scientifique (même si celle-ci, comme dans d’autres sciences, n’est jamais définitivement établie).
- Lorsqu’elles sont fondées sur l’enquête empirique (quelle qu’en soit la nature), les sciences sociales peuvent ainsi utilement, dans une démocratie, constituer un contrepoids critique à l’ensemble des discours tenus sur le monde social, des plus professionnels (discours politiques, religieux ou journalistiques) aux plus ordinaires.
Au moment où l’on évoque publiquement de plus en plus fréquemment
la nécessité de former à la citoyenneté, et où l’on n’envisage généralement de répondre à cette exigence que par l’enseignement de la morale ou de l’éducation civique,
- il est étrange de ne pas voir éclore l’idée selon laquelle ces sciences du monde social pourraient être au cœur de cette formation :
le relativisme anthropologique (qui n’a strictement rien à voir avec un ultra-relativisme « égalisateur » ou un indifférentisme éthique), la prise de conscience de l’existence d’une multiplicité de « points de vue » liée aux différences sociales, culturelles, géographiques, etc., la connaissance de certains « mécanismes » et processus sociaux (et non la seule visite guidée des institutions officielles de la République…), tout cela pourrait utilement contribuer à former des citoyens qui seraient un peu plus sujets de leurs actions dans un monde social dé-naturalisé, rendu un peu moins opaque, un peu moins étrange et un peu moins immaîtrisable. »
– Lahire, B. (2007). 14. Vers une utopie réaliste : enseigner les sciences du monde social dès l’école primaire. Dans : , B. Lahire, L’esprit sociologique (pp. 388-402). La Découverte.
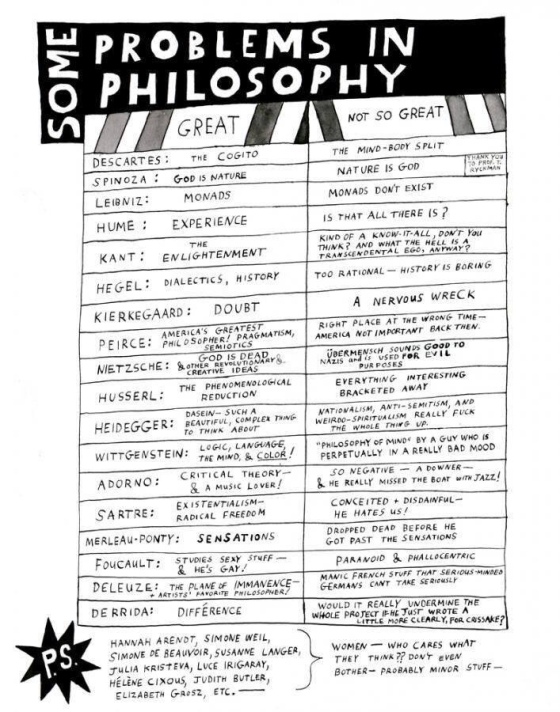
« […]
Une trilogie contre la domination de l’école
C’est face à la perception des limites de l’institution scolaire à la fin des années 1960 et au début des années 1970 que la trilogie « formel, non formel, informel » apparaît au sein d’organisations internationales comme la Banque mondiale ou l’UNESCO dans une perspective qui, si elle s’applique aussi aux pays occidentaux, vise d’abord à prendre en compte la diversité internationale des situations éducatives et tout particulièrement au sein de ce que l’on appelle alors les pays en voie de développement.
Une trilogie pensée d’abord pour les pays en voie de développement
Une des sources de la mise en évidence d’une éducation informelle renvoie à la spécificité des situations éducatives vécues par des pays de culture différente qui pour la plupart ont été dominés par les pays occidentaux à travers différentes formes de colonisation. C’est en s’intéressant aux difficultés de la scolarisation dans ces pays que la notion d’éducation informelle a été utilisée, seule ou en relation avec celle d’éducation non formelle. Une référence de base en termes de typologie est celle de P. H. Coombs & M. Ahmed (1974) souvent reprise et citée. Il semble qu’ils fixent très largement le vocabulaire et son usage, mais il faut tenir compte du contexte dans lequel ils utilisent ces expressions. Il s’agit d’une étude réalisée pour la Banque mondiale concernant le développement rural.
- Ils y soutiennent la thèse d’un double déficit en matière d’éducation formelle mais aussi non formelle.
- Y dominerait l’éducation informelle, mais celle-ci ne peut satisfaire totalement les besoins du développement rural.
- L’éducation formelle est analysée comme peu valide pour cela.
- Ils y proposent une stratégie qui s’appuie sur l’éducation non formelle.
- Ce faisant ils sont conduits à définir ces différentes notions et d’une certaine façon à stabiliser le vocabulaire, au moins dans le cadre des études liées au développement et à la scolarisation dans le cadre des organismes internationaux.
Cette façon d’analyser l’éducation selon trois modalités est d’abord considérée comme basée sur l’équivalence d’éducation avec apprentissage (learning) et non avec scolarisation (schooling). Il s’agit de prendre en compte où et comment l’apprentissage se fait, ce qui, selon les auteurs, définit une vue fonctionnelle de l’éducation (Coombs & Ahmed, 1974, p. 232).
- Il est intéressant de noter au passage que ce texte récuse avant même qu’elle n’apparaisse l’opposition entre éducation et apprentissage.
- Les auteurs parlent d’éducation (formelle, non-formelle, informelle), mais prennent en compte l’apprentissage.
- L’éducation est implicitement définie comme toute situation (quel que soit son statut) qui permet un apprentissage,
- il s’agit des deux faces d’une même réalité.
Il en ressort pour P. H. Coombs & M. Ahmed que :
« l’éducation (apprentissage) est de manière inhérente un processus de toute la vie [lifelong process], commençant dans l’enfance [infancy] et se poursuivant à travers l’âge adulte. Il est également clair que la grande masse de celle-ci est pour chaque personne acquise durant le cours de sa vie en dehors de l’école (éducation formelle) et en dehors des autres processus éducatifs organisés (éducation non-formelle). Les gens apprennent d’abord à partir des expériences quotidiennes et de la multitude de forces éducatives présentes dans leur environnement – de la famille et des voisins, du travail et du jeu, des activités religieuses, du marché, des journaux, livres, émissions et médias. Pour cette étude, nous appelons cette importante modalité d’apprentissage éducation informelle (à ne pas confondre avec non-formel) » (Ibid., p. 232).
Cette attention portée à la fonction décisive des apprentissages informels fait écho aux écrits d’I. Illich (1971) de la même période :
« C’est sorti de l’école, ou en dehors, que tout le monde apprend à vivre, apprend à parler, à penser, à aimer, à sentir, à jouer, à jurer, à se débrouiller, à travailler » (Illich, 2004, p. 245).
Chez Illich, la valeur formative de l’expérience quotidienne a pour contrepoint la critique de l’institution scolaire qui dépossèderait les acteurs de leur formation, qui « filtre l’éducation » (Ibid., p. 135).
« Déscolariser la société » comme le propose le titre anglais d’Une société sans école, c’est faire confiance aux ressources formatives des groupes locaux et les encourager à développer leurs propres « trames éducatives », c’est s’appuyer sur la participation de tous : « Nous ne tenons pas notre savoir de l’instruction imposée. Ce serait plutôt l’effet d’une participation sans contrainte, d’un rapport avec un milieu qui ait un sens » (Ibid., p. 257).
Cette vision résolument politique interroge la « contre-productivité » des institutions dans la société industrielle.
C’est dans ce même contexte que P. H. Coombs, auteur en 1968 d’un livre intitulé « La crise mondiale de l’éducation » (Coombs, 1968) utilise la trilogie et valorise l’idée d’une éducation informelle qui échappe à l’institution. On trouve certes des occurrences antérieures en relation avec l’idée d’éducation des adultes mettant également en valeur l’importance de l’expérience. Chez P. H. Coombs, il s’agit de situer des logiques d’action présentes et futures, et non de construire une théorie éducative. Reste que l’analyse est précise et conduit à conférer une place à chaque modalité éducative.
- En effet, malgré sa désignation négative, l’éducation informelle apparaît bien comme la première modalité éducative, celle par laquelle tout commence et qui domine les logiques d’apprentissage tout au long de la vie.
- Les éducations formelles ou non-formelles renvoient à une logique de substitution (on aurait envie de dire dans ce contexte de subsidiarité) à l’éducation informelle quand celle-ci ne peut permettre certains apprentissages.
- Elles fournissent ce que l’environnement local et le cours de la vie ne peuvent permettre d’atteindre.
Cette conception sous-tend une genèse de la formalisation. L’école ou d’autres systèmes éducatifs organisés se développent pour suppléer l’éducation par le milieu. Ainsi de l’école par rapport à la lecture et l’écriture ou des modalités non-formelles d’alphabétisation. C’est en effet dans ce dernier domaine que la notion d’éducation non-formelle s’est développée.
- Dans ce triptyque, le non formel, qui mérite bien mal son nom, constitue un véritable champ de formalisation de l’informel. Celui-ci est dans ce cas envisagé comme un « réservoir éducatif ».
Bien entendu P. H. Coombs, comme nombre de ceux qui feront référence à cette trilogie, est sensible à l’idée d’hybridation entre les différents types.
- Le système éducatif tout au long de la vie articule les trois modalités.
- La recherche porte spécifiquement sur le non-formel qui permet d’atteindre des objectifs que l’informel ne rencontre pas, sans s’enfermer dans les contraintes d’un système éducatif formel peu adapté aux adultes et à leurs problèmes quotidiens.
P. H. Coombs ne voit pas l’informel comme une spécificité des sociétés rurales ou traditionnelles. Au contraire sa vision le conduit à penser que les occasions d’apprentissage informel sont plus importantes dans les centres urbains avec la sollicitation des médias et la diversité de la population. Cela justifie d’autant plus une stratégie d’éducation non-formelle en milieu rural.
Il pose avec rigueur une analyse qui, au-delà de termes qui peuvent être porteurs d’ambiguïté, distingue nettement les trois niveaux, tout en concevant qu’ils puissent être constamment entrelacés. Il s’agit avant tout de trois niveaux d’analyse, pas nécessairement de réalités que l’on peut rencontrer à l’état brut.
Le sceau des organisations internationales
Cette analyse a longtemps servi et sert toujours de référence, au moins à travers les auteurs qui en ont repris les termes, même si ce n’est pas exactement dans la même logique. Selon les auteurs, ce modèle peut servir à penser l’éducation non-formelle (La Belle, 1982) ou les problèmes relatifs à la scolarisation, plus rarement l’éducation informelle en tant que telle.
- On peut noter que celle-ci est souvent traduite à cette époque en français par « éducation diffuse », expression présente dans des rapports de l’UNESCO (1972), tout particulièrement dans le rapport d’E. Faure et al. (1972)
Apprendre à être qui distingue trois niveaux d’éducation.
Le premier est celui de « l’éducation diffuse » définie comme « le processus permanent grâce auquel tout individu adopte des attitudes et des valeurs, acquiert des connaissances grâce à son expérience quotidienne, aux influences de son milieu et à l’action de toutes les institutions qui l’incitent à en modifier le cours ».
Le second niveau est celui de l’éducation « extrascolaire », qui correspond à « toutes les activités organisées d’éducation qui visent des clientèles particulières en fonction de leurs besoins et de leurs aspirations », et le troisième l’éducation scolaire, définie, dans une logique paradoxale visant à conserver toute son importance à l’école, comme le préalable à l’éducation extrascolaire et diffuse.
L’éducation permanente intègre ces trois niveaux.
- L’expression d’« éducation diffuse », abandonnée depuis, mériterait d’être réhabilitée pour éviter la négativité de d’informel.
Il reste qu’elle est loin de rendre compte de la diversité de ce qu’éducation informelle recouvre mais qui reste peu pensé.
- En effet, le paradoxe de ces analyses, à quelques exceptions près, est de laisser en friche ce qui est réellement appris dans l’informel ou de renvoyer à des auteurs qui ont étudié les formes de socialisation des jeunes dans les sociétés traditionnelles sans se référer à cette notion.
Elle apparaît comme quelque chose en creux, permettant de penser les intérêts et les limites des deux autres modes. Ainsi en est-il de P. H. Coombs qui sur les limites de l’éducation informelle en milieu rural propose le développement d’une éducation non formelle. Sa proposition de trilogie est proche de propositions émanant à la même époque de différentes organisations internationales, au-delà de l’UNESCO.
Ainsi un rapport de l’OCDE (1973) distingue l’apprentissage « fortuit » qui « se poursuit dans le cadre de la vie, du travail et des loisirs », et l’apprentissage orienté vers un objectif précis. Le Conseil de l’Europe propose également durant la même période (1971) un rapport intitulé Éducation permanente :
- fondement d’une politique éducative intégrée qui articule l’éducation permanente autour de trois mots-clefs :
- égalisation,
- globalisation,
- participation.
- Dans ce rapport signé par Bertrand Schwartz, la notion de « globalisation » du processus éducatif met en avant le rôle de l’expérience quotidienne, lieu d’ancrage de la motivation des individus à apprendre.
La participation active de l’apprenant au processus de formation doit faire l’objet d’un premier apprentissage.
L’idée d’éducation permanente impose d’intégrer dans un ensemble cohérent des formes d’apprentissage diverses : « L’école est sans doute un moment nécessaire et inévitable de la vie de chacun. Mais cette institution, dont l’esprit et le fonctionnement sont devenus désuets, recevra une signification et un contenu entièrement différents dès qu’elle se trouvera insérée, à sa place, dans un processus global de formation, d’extension et d’approfondissement de la personnalité. Ce processus qui accompagne la vie – et dans une certaine mesure, s’identifie à la vie – n’a d’autre terme que le stade final de l’existence. » (Lengrand, 1955 cité par Pineau, 1977, p. 74).
Ces idées trouvent leurs prolongements entre autres dans les programmes actuels de l’Union européenne tel le Mémorandum 2000 sur l’éducation et la formation tout au long de la vie.
Dans ce cadre, le rapport intitulé Réaliser un espace européen de l’éducation et de la formation tout au long de la vie considère que
- « la formation tout au long de la vie devrait […] couvrir toute forme d’éducation, qu’elle soit formelle, non formelle ou informelle. » (Union européenne, 2001, p. 4).
Elle est définie comme « toute activité d’apprentissage entreprise à tout moment de la vie, dans le but d’améliorer les connaissances, les qualifications et les compétences, dans une perspective personnelle, civique, sociale, et/ou liée à l’emploi. » (Ibid., p. 11). Ces apprentissages, est-il rappelé, sont « soit formels, non formels ou informels. »
Le document comporte un glossaire qui définit ces trois termes. L’apprentissage informel y est présenté comme « Apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs.
- Il n’est pas structuré (en termes d’objectifs, de temps ou de ressources) et n’est généralement pas validé par un titre. L’apprentissage informel peut avoir un caractère intentionnel, mais, dans la plupart des cas, il est non intentionnel (ou fortuit/aléatoire) » (Ibid., p. 38).
- La notion d’apprentissage non-formel est plus ambiguë : « Apprentissage qui n’est pas dispensé par un établissement d’enseignement ou de formation. Il est cependant structuré (en termes d’objectifs, de temps ou de ressources).
- L’apprentissage non formel est intentionnel de la part de l’apprenant. » (Ibid.).
- On perçoit ici un double glissement, le premier d’une centration sur les pays en voie de développement aux pays les plus développés dans le cadre d’une concurrence entre Europe, États-Unis et Asie, le second de l’éducation à l’apprentissage comme nous l’avons évoqué ci-dessus.
La notion de non formel, passant de l’éducation à l’apprentissage, devient encore plus difficile à saisir. Il est de moins en moins certain qu’elle puisse nourrir les recherches contemporaines, du fait, sans doute, de « l’entre-deux dans lequel l’éducation non formelle est tenue, véritable auberge espagnole de l’éducation, symptomatique de son existence sans épaisseur, voire de son inexistence. » (Poizat, 2003, p. 205)
De l’informel dans le formel
De nouveaux usages semblent aujourd’hui renvoyer davantage à une opposition entre informel et formel ou scolaire, pour aborder la question d’une éducation scolaire qui respecte les savoirs locaux.
- Il s’agit, paradoxalement, d’intégrer au mode formel des éléments issus des apprentissages informels.
Ainsi oppose-t‑on la transmission des savoirs occidentaux à travers l’école à celle d’un savoir culturel local qui demeure dans nombre de cas informel (Kopong, 1995, p. 641).
Cet apprentissage s’appuie sur la participation, l’observation et l’imitation. Il permet la reproduction des savoirs et savoir-faire traditionnels et renvoie à l’identité culturelle des groupes.
- Il s’agit donc tout à la fois d’une modalité d’apprentissage et de contenus liés à la spécificité même d’un groupe culturel.
« La plupart des petites cultures autochtones s’appuient sur des processus informels, l’apprentissage se déroulant dans le contexte des activités quotidiennes. Il s’agit, pour une grande part, d’un processus inconscient d’observation, d’imitation et de jeu de rôles, par opposition à l’instruction verbale et formelle des sociétés modernes industrialisées. » (Teasdale, 2004, p. 74).
Dans le cadre de réformes de programmes qui valorisent la présence de contenus locaux comme en Indonésie, différentes tentatives d’intégration ont été menées, au risque assumé de formaliser les modalités de transmission culturelles ainsi visées :
« La prise en compte de l’éducation informelle est sans doute la clef de voûte de toute adaptation culturelle d’un système éducatif. » (Dasen, 2004).
Différents exemples montrent comment
« les groupes aborigènes d’Australie ont repensé le processus de scolarisation de manière très significative, en réunissant une synthèse entre leur modèle d’éducation traditionnelle, diffuse, et les approches structurées, plus formelles, des sociétés industrielles. » (Teasdale, 2004, p. 65).
- Ainsi voit-on se dessiner progressivement des configurations dans lesquelles l’informel vient dynamiser le formel ou lui servir de « réservoir d’expérience »,
- configurations variables selon les contextes locaux et le type de structuration du secteur formel.
Mais dans les deux cas nous nous trouvons face à la pauvreté d’une opposition (ou d’une trilogie) qui ne rend pas compte de la diversité de la réalité des situations locales.
D’une part, les sociétés traditionnelles connaissent des systèmes formels d’éducation, qu’il s’agisse des écoles sanskrites (Mishra & Vajpayee, 2004), coraniques (Akkari, 2004) ou de la formation des griots en Afrique de l’Ouest.
Dans ce dernier cas S. Toulou (2005, p. 99) souligne qu’il « y a un processus didactique qui est mis sur pied par les garants de la tradition en vue de favoriser la transmission de ce savoir aux futurs griots. ».
- L’opposition entre l’informel traditionnel et le formel renvoyant à l’école occidentale ne tient pas,
- pas plus que le renvoi au non-formel des formes non occidentales.
La plupart des sociétés connaissent des modalités d’éducation plus ou moins formelles. L’école occidentale n’a pas seule le privilège de la forme.
D’autres formes ont été produites dans l’histoire qu’il s’agisse d’une éducation très spécialisée destinée à des individus au rôle spécifique et prestigieux comme les griots ou d’une éducation visant tous les croyants dès leur plus jeune âge, à un âge où nombre d’enfants des pays occidentaux ne connaissaient pas encore une forme strictement scolaire, comme dans le cas de l’école coranique.
Pour reprendre le titre de l’ouvrage dirigé par O. Maulini et C. Montandon (2005) il faut bien parler de variétés et variations en ce qui concerne les formes de l’éducation.
- De plus l’intégration de l’éducation informelle dans de nouvelles stratégies scolaires qui cherchent à respecter les cultures de peuples minoritaires et indigènes conduit à une formalisation de celle-ci.
Entre la forme scolaire définie par G. Vincent (1980 & 1994) et l’informel il y a place pour d’autres formes qui sont maltraitées par la notion de non formel qui affiche un certain mépris pour les formes autres que la forme scolaire occidentale.
- Aussi ambiguë soit-elle la notion de semi-formelle aurait été préférable. Elle est peu présente dans la littérature.
M. Brossard (2001) y fait référence dans une acception proche du non-formel :
« de nombreux apprentissages effectués à l’école maternelle occupent cette position intermédiaire entre les apprentissages spontanés de la vie quotidienne et les apprentissages provoqués propres aux situations scolaires ultérieures ».
H. Nocon & M. Cole (2005, p. 101) dans un article sur les programmes destinés aux enfants de l’école élémentaire après les heures scolaires, l’équivalent de nos centres de loisirs, introduisent également cette expression, mais le fait qu’elle soit entre guillemets, traduit son absence de légitimité :
« Le rôle complémentaire à la scolarité formelle de l’éducation informelle est également apparu dans le domaine “semi-formel” des programmes organisés pour le périscolaire (after-school) ».
Si les développements relatifs à l’informel et au non-formel doivent être replacés dans leur contexte pour en comprendre la logique,
- c’est-à-dire la volonté de saisir les dynamiques post-coloniales complexes à l’œuvre dans les pays non-occidentaux,
- c’est bien la notion de forme(s) prise comme marquage d’une diversité qui permet de dépasser les impasses terminologiques que nous avons rencontrées.
Et sans doute cette notion doit-elle s’appliquer de façon différenciée au processus (l’apprentissage comme learning) et aux produits (le savoir ou l’apprentissage comme résultat).
Il semble trop commun de rabattre l’un sur l’autre, de considérer qu’aux apprentissages informels ne peuvent correspondre que les savoirs dits informels. Processus et résultats ont, sans doute, une dynamique propre (Maulini & Montandon, 2005). C’est pourquoi nous nous limiterons dans ce texte aux processus. Les résultats et les connaissances dans leurs différences relèveraient d’une autre analyse.
Il n’est pas certain que la notion d’informel puisse s’appliquer aux savoirs et aux connaissances comme elle s’applique au processus, qu’à un processus d’apprentissage informel correspond un « savoir informel ». De plus nous nous trouvons ici face à une diversité de divisions (théorique/pratique, scientifique/spontané, scolaire/quotidien) qui demanderai(en)t à être analysée(s) pour elle-même.
Reste à creuser encore, en particulier en ce qui concerne les processus d’apprentissage, ce qui est informel ou peu formalisé et qui semble l’essentiel de ce qui est appris. Qu’en savons-nous ? Aller trop vite du côté des formes et de leur diversité peut conduire à répéter l’attraction du chercheur par le pôle le plus formel.
[…] »
– Brougère, G. & Bézille, H. (2007). De l’usage de la notion d’informel dans le champ de l’éducation. Revue française de pédagogie, 158(1), 117-160.

« L’attitude des chercheurs français à l’égard des États-Unis oscille souvent entre un scepticisme teinté de mépris et une fascination pour leur modernité supposée.
- Il s’agit, dans les deux cas, d’une ignorance mal assumée.
Les chercheurs en pédagogie et les historiens de l’éducation s’en tiennent trop souvent aux apparences, eux aussi, en ne réservant qu’un mince intérêt aux travaux de leurs collègues américains.
Or non seulement l’éducation aux États-Unis a une histoire originale et pluriséculaire, mais la réflexion et les travaux auxquels elle a donné lieu depuis plus d’un siècle sont dignes de toute notre attention. Les États-Unis, en effet, ont été « le premier pays à créer un système d’éducation publique et gratuite, ouvert à tous, et se sont efforcés au fil du temps de scolariser une proportion toujours plus grande d’enfants ».
- Leurs structures scolaires, décentralisées et enracinées localement, sont organisées sur différents niveaux, ce qui engendre une grande souplesse de fonctionnement (mais prive le système de toute unité).
L’historiographie américaine de l’éducation, quant à elle, se distingue par sa maturité et son dynamisme.
- Comme en France, de grands historiens ont imprimé leur marque sur un matériau divers et riche ; comme en France, le champ possède ses objets de prédilection, ses interrogations propres, son vocabulaire, ses traditions, ses écoles, ses débats, ses querelles de clocher, ses monstres sacrés, ses mythes et ses lacunes.
Cet article se propose d’offrir au lecteur français un panorama de la recherche contemporaine aux États-Unis en matière d’histoire de l’éducation, dans l’esprit de ce que Pierre Caspard a fait pour la France.
Cet exposé est guidé par un souci d’utilité : s’il pouvait inciter les chercheurs en sciences de l’éducation et les historiens français à s’ouvrir aux thématiques américaines, pour s’en inspirer, pour les dépasser ou simplement pour mieux les connaître, il aurait atteint son but.
Ces quelques pages, nous l’espérons, donneront au lecteur la certitude que l’historiographie américaine de l’éducation n’est ni impérialiste, ni simpliste, ni hors de portée, et qu’il serait très dommageable que préjugés et fantasmes éloignent les chercheurs français de recherches dont la richesse est à même de féconder les leurs.
[…] »
– Jablonka, I. (2001). Les historiens américains aux prises avec leur école: L’évolution récente de l’historiographie de l’éducation aux États-Unis (1961-2001). Histoire de l’éducation, 89(1), 1.

« […]
On comprend donc que la justice soit mieux assurée si l’on élargit la conception technique des tests en envisageant simultanément, en plus des problèmes posés par leur construction, ceux concernant leur capacité prédictive et les critères utilisés au regard de certains groupes sociaux.
En plus de ces considérations épistémologiques, deux postulats sont généralement admis pour défendre les évaluations et les comparaisons par les tests.
- Dans le premier cas, on considère que l’adaptation de la performance des élèves à celle exigée par les tests est le meilleur moyen de réaliser les programmes et d’instruire les élèves.
Toutefois, il est facile de constater, au regard des expériences anglo-saxonnes ou américaines, que l’imposition de standards conduit à des dérives dans les pratiques pédagogiques teaching to the test et qu’ils n’améliorent pas la qualité du contenu des apprentissages, les effets positifs de ces évaluations étant en définitive très limités (Kosol 1991, Sacks 1999, Normand 2001).
Le second postulat selon lequel les tests favoriseraient l’équité n’est guère plus convaincant.
En effet, ils ne permettent pas d’éliminer les biais concernant la validité des critères à l’encontre de certains groupes sociaux.
Pire, avec le renforcement des procédures d’évaluation, les différences de performances parmi les groupes auraient tendance à persister, voire à augmenter Apple 1993, Madaus 1994.
- Les tests utilisés risquent alors d’exacerber les questions d’injustice en les masquant derrière une défense techniciste.
- Celle-ci vise à concilier des principes d’efficacité avec un idéal d’égalité de résultats remplaçant l’idéal d’égalité des chances et présenté comme un passage nécessaire de l’utopie au réalisme Derouet 2000,2003.
Mais cette nouvelle philosophie politique risque de donner plus d’importance aux exigences de qualité et d’efficacité au moment où les débats sur la justesse technique des instruments d’évaluation l’emportent sur l’examen de la justice des objectifs politiques de l’école.
Conclusion
À la lumière des développements précédents, il demeure une question essentielle :
- à quoi servent en définitive les comparaisons internationales de résultats ?
En dépit de ses limites épistémologiques, il s’agit d’un processus technique qui possède un intérêt pour ses promoteurs :
- il permet de transformer les qualités et les capacités hétérogènes des élèves en une même mesure,
- qui est utilisée ensuite pour informer les usagers et les administrateurs de l’éducation, établir des classements entre pays et juger d’une compétition internationale,
- justifier des décisions politiques concernant l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des systèmes éducatifs.
- La comparaison statistique réduit et simplifie le traitement de l’information grâce à des chiffres que les individus et les institutions parviennent plus facilement à manipuler Desrosières 2003.
- Tout en facilitant la prise de décision, elle permet de réduire l’incertitude, d’imposer un contrôle et de fournir une légitimité incontestée grâce à des catégories auxquelles les acteurs de l’éducation n’ont plus qu’à se conformer.
- Les comparaisons sont essentielles pour les organisations internationales qui utilisent des modèles de décision et souhaitent donner consistance et objectivité à des savoirs et des pratiques éducatives très éloignées sur le plan culturel et géographique.
- Une fois ces catégories statistiques élaborées, elles sont routinisées dans des instances et des lieux de décision, des lois ou des règlements, des recommandations faites aux États Desrosières 2000, Thévenot, 1997.
- Les comparaisons deviennent alors des formes publiques de la connaissance qui tendent à relativiser les particularismes culturels et les savoirs locaux au nom d’une méthode scientifique rigoureuse générant une information distanciée et officielle.
Un autre aspect, tout aussi important, est que ces comparaisons internationales mettent en rapport des statisticiens, des évaluateurs, des chercheurs, des administrateurs ou des représentants des gouvernements et des grandes organisations internationales, dans des lieux ou le long de réseaux permettant la confrontation et l’échange d’expériences, la mise en place de projets communs, la définition de nouvelles procédures et de nouveaux instruments.
Ces espaces d’intéressement donnent une place centrale à l’expertise dans la définition de problématiques essentielles au devenir des systèmes éducatifs au niveau européen et international (Dutercq 2001, Derouet & Normand 2003).
S’y trouve, en effet, défini un référentiel qui s’appuie sur une vision commune et partagée :
- le capital humain est un facteur essentiel à une économie fondée sur la connaissance dont il faut chercher à améliorer l’efficacité et la rentabilité.
Cependant, outre son économisme, cette proposition tend à relayer une conception objectiviste de l’éducation dont on commence à évaluer les effets pervers sur le management des écoles et les pratiques pédagogiques Normand 2003.
- En fait, cette confiance excessive dans les conclusions d’une expertise tend à confisquer le débat démocratique en empêchant une ré?exion collective sur le projet politique de l’école Charlier 2003.
Cette dérive rend de plus en plus nécessaire la création de lieux de concertation publique à l’échelon européen ou international où s’exprimerait la diversité des intérêts dans le respect de principes universels concernant l’éducation et qui fourniraient l’occasion de promouvoir une véritable démocratie technique afin de mettre à l’épreuve les postulats ou les affirmations les plus contestables. »
– Normand, R. (2003). Les comparaisons internationales de résultats : problèmes épistémologiques et questions de justice. Éducation et sociétés, no 12(2), 73-89.

« […]
Et le bonheur dans tout ça ?
Robert Gordon a omis un élément d’analyse : le bonheur !
- Une étude récente montre que plus une population exprime un sentiment subjectif de bien-être, plus sa productivité est élevée. Mais l’inverse n’est pas vrai.
Centrés sur les pays européens, ces travaux soulignent combien le lien entre sentiment de bonheur et performance économique est particulièrement élevé en France et en Allemagne, et un peu moins au Royaume-Uni, au Portugal ou en Espagne.
Voir « Happiness Matters : the Role of Well-Being in Productivity« , par Charles Henri DiMaria, Chiara Peroni et Francesco Sarracino, MPRA Paper n° 56983, 27 juin 2014.
[…] »
– Chavagneux, C. (2014). Les six vents contraires qui freinent la croissance. Alternatives Économiques, 338(9), 64.

Lectures supplémentaires / complémentaires :
- Hermon, E. (1997). De l’éducation à la paix à l’éducation mondiale. Revue des sciences de l’éducation, 23 (1), 77–90.
- Sensevy, G. (2011). Le sens du savoir: Éléments pour une théorie de l’action conjointe en didactique. De Boeck Supérieur.
- Sensevy, G. (2011). Chapitre 5. Intentions professorales et construction du jeu. Dans : , G. Sensevy, Le sens du savoir: Éléments pour une théorie de l’action conjointe en didactique (pp. 179-180). De Boeck Supérieur.
- Sensevy, G. (2011). Chapitre 9. Dispositifs didactiques et reconstruction de la forme scolaire. Dans : , G. Sensevy, Le sens du savoir: Éléments pour une théorie de l’action conjointe en didactique (pp. 291-640). De Boeck Supérieur.
- Charlier, J. (2003). L’influence des organisations internationales sur les politiques d’éducation: La douce violence de la “Méthode ouverte de coordination” et de ses équivalents. Éducation et sociétés, no 12(2), 5-11.
- Vinokur, A. (2003). De la scolarisation de masse à la formation tout au long de la vie : essai sur les enjeux économiques des doctrines éducatives des organisations internationales. Éducation et sociétés, no 12(2), 91-104.
- Akkari, A. & Payet, J. (2010). Transformations des systèmes éducatifs dans les pays du Sud: Entre globalisation et diversification. De Boeck Supérieur.
- Zajda, J. (2010). Décentralisation et privatisation dans l’éducation : le rôle de l’État. Dans : Abdeljalil Akkari éd., Transformations des systèmes éducatifs dans les pays du Sud: Entre globalisation et diversification (pp. 35-61). De Boeck Supérieur.
- Dormeier Freire, A. & Lacopini, L. (2010). Quelle éducation pour qui ? Privatisation et évolutions des inégalités sociales au Viêt Nam. Dans : Abdeljalil Akkari éd., Transformations des systèmes éducatifs dans les pays du Sud: Entre globalisation et diversification (pp. 63-87). De Boeck Supérieur.
- Akkari, A. & Pompeu da Silva, C. (2010). La qualité de l’éducation de base au Brésil : entre politiques éducatives et engagement des enseignantes. Dans : Abdeljalil Akkari éd., Transformations des systèmes éducatifs dans les pays du Sud: Entre globalisation et diversification (pp. 89-118). De Boeck Supérieur.
- Sanou, F. & Charmillot, M. (2010). L’éducation supérieure dans les politiques éducatives en Afrique subsaharienne. Le cas du Burkina Faso. Dans : Abdeljalil Akkari éd., Transformations des systèmes éducatifs dans les pays du Sud: Entre globalisation et diversification (pp. 119-145). De Boeck Supérieur.
- Tupin, F. (2010). Le système éducatif de l’île Maurice : entre globalisation et amélioration de la qualité de l’éducation. Dans : Abdeljalil Akkari éd., Transformations des systèmes éducatifs dans les pays du Sud: Entre globalisation et diversification (pp. 147-167). De Boeck Supérieur.
- Rougemont, H. (2010). Des obstacles à la mise en œuvre d’une éducation interculturelle et bilingue en contexte péruvien. Une analyse à trois niveaux. Dans : Abdeljalil Akkari éd., Transformations des systèmes éducatifs dans les pays du Sud: Entre globalisation et diversification (pp. 169-196). De Boeck Supérieur.
- Alby, S. & Ho-A-Sim, J. (2010). Limites de la prise en compte de la diversité des publics scolaires en Guyane. Dans : Abdeljalil Akkari éd., Transformations des systèmes éducatifs dans les pays du Sud: Entre globalisation et diversification (pp. 197-218). De Boeck Supérieur.
- Franchi, V. & Payet, J. (2010). « Vu d’en bas ». La transformation de l’école sud-africaine, à l’aune des expériences subjectives. Dans : Abdeljalil Akkari éd., Transformations des systèmes éducatifs dans les pays du Sud: Entre globalisation et diversification (pp. 219-248). De Boeck Supérieur.
- Lange, M. & Henaff, N. (2010). Accès à l’éducation et pauvreté au Viêt Nam. Dans : Abdeljalil Akkari éd., Transformations des systèmes éducatifs dans les pays du Sud: Entre globalisation et diversification (pp. 249-277). De Boeck Supérieur.
- Lauwerier, T. (2010). Éducation non formelle, alphabétisation et communautés locales en Afrique de l’Ouest francophone. Dans : Abdeljalil Akkari éd., Transformations des systèmes éducatifs dans les pays du Sud: Entre globalisation et diversification (pp. 279-300). De Boeck Supérieur.
- Charlier, J. & Croché, S. (2003). Le processus de Bologne, ses acteurs et leurs complices. Éducation et sociétés, no 12(2), 13-34.
- Cussó, R. (2003). Les statistiques de l’éducation de l’UNESCO : restructuration et changement politique. Éducation et sociétés, no 12(2), 57-72.
- Duru-Bellat, M., Farges, G., van Zanten, A. (2018). Sociologie de l’école: 5e édition. Armand Colin.
- Auray, N. (2003). Apprendre la sociologie au lycée. une évaluation des connaissances des élèves en classe de première économique et sociale. Éducation et sociétés, no 12(2), 175-178.
- Octobre, S., Détrez, C., Mercklé, P. & Berthomier, N. (2010). Chapitre III. « Dis-moi ce que tu fais, je te dirai à qui tu ressembles ». Pluralité des transmissions : parents, fratrie, copains, école. Dans : , S. Octobre, C. Détrez, P. Mercklé & N. Berthomier (Dir), L’enfance des loisirs: Trajectoires communes et parcours individuels de la fin de l’enfance à la grande adolescence (pp. 153-247). Ministère de la Culture – DEPS.
- Yebbou, J. (2015). Autonomie et évaluation des élèves. Administration & Éducation, 147(3), 119-123.
- Minder, M. (2008). Champs d’action pédagogique: Une encyclopédie des domaines de l’éducation. De Boeck Supérieur.
- Esmenjaud-Genestoux, F. (2008). Les responsabilités de l’élève et sa conquête de l’autonomie dans l’étude des mathématiques: Approche didactique d’un cas de rééducation mathématique. Les Sciences de l’éducation – Pour l’Ère nouvelle, vol. 41(1), 33-64.
- Romby, A. (2003). Les technologies, des vecteurs de changement : Le cas des technologies de l’information et de la communication dans les lycées de Picardie : le projet Éducapôle. Éducation et sociétés, no 12(2), 143-157.
- AEDE Collectif, En avant pour les droits de l’enfant ! ERES, « Enfance & parentalité », 2015, 776 pages.
- Bouvier, A. (2012). La gouvernance des systèmes éducatifs. Presses Universitaires de France.
- des économistes, L., Orsenna, E. (2014). Un monde de ressources rares. Éditions Perrin.
- des économistes, L. & Orsenna, E. (2014). 2– Le capital humain,clé du développement partagé. Dans : , L. des économistes & E. Orsenna (Dir), Un monde de ressources rares (pp. 101-110). Éditions Perrin.
- Méard, J., Bertone, S. (1998). L’autonomie de l’élève et l’intégration des règles en éducation physique. Presses Universitaires de France.
- Méard, J. & Bertone, S. (1998). Introduction. Dans : , J. Méard & S. Bertone (Dir), L’autonomie de l’élève et l’intégration des règles en éducation physique (pp. 11-18). Presses Universitaires de France.
- Méard, J. & Bertone, S. (1998). 2. L’autonomie dans les apprentissages. Dans : , J. Méard & S. Bertone (Dir), L’autonomie de l’élève et l’intégration des règles en éducation physique (pp. 42-107). Presses Universitaires de France.